Villa Noailles à Hyères/un fantasme mondain/François Carrassan
du château Saint-Bernard (50 ans) à la Villa Noailles (50 ans), ça ne fait pas 100 ans mais deux fois 50 (JCG)
HYERES / VILLA NOAILLES / 26 AVRIL 2003 /
Inauguration de la Villa Noailles restaurée par Jean-Jacques AILLAGON, Ministre de la Culture, en compagnie d’Hubert FALCO, Secrétaire d’Etat aux personnes âgées, Président de TPM et Maire de Toulon, et de Léopold RITONDALE, Maire de la Ville d’Hyères /
La Villa Noailles avait 80 ans et la Ville d’Hyères en était propriétaire depuis 30 ans. Savoir que dans cet intervalle la Villa avait accumulé les aléas de la vie : construction / célébrité / scandale / séparation / mondanités / déclin / abandon / vente / squat / ruine. Jusqu’à ce que la Ville d’Hyères se décide à la restaurer. Une aventure dont j’aurai un temps été un des acteurs.
Mais aujourd’hui, vingt ans plus tard, le récit que la Villa fait d’elle-même me paraît s’être éloigné de son histoire véritable en préférant se raconter des histoires. En révisant le réel. En idéalisant les figures de ses commanditaires et leur vouant un culte quasi-religieux. On lit aujourd’hui dans un magazine que son directeur est « le fils spirituel de Marie-Laure ». Tant qu’on y est, pourquoi pas la réincarnation ? Mais à sa place je me méfierai, quand on sait comment tout a fini. (F.C.)
Dans les parages du centenaire de la Villa Noailles (la première construction date de 1925), l’excellente biographie que LAURENCE BENAÏM a consacré en 2001 à Marie-Laure de Noailles : « la vicomtesse du bizarre », vient d’être rééditée (Tallandier, 2023 / 12 €). Une biographie qui a le mérite de ne rien dissimuler d’une vie plutôt tumultueuse qui commence dans la distinction d’une aristocrate de la haute et qui finit, façon « mère Ubu », avec les boulomanes d’Hyères ou les soixante-huitards de l’Odéon. C’est la pente des choses. Un peu comme pour la Villa elle-même qui sitôt construite connut un bref âge d’or et puis qui, à partir de 1932, entra dans un lent mais fatal déclin. Jusqu’à l’abandon. Jusqu’à sa mise en vente, à la mort de la vicomtesse, en 1970. Où l’on voit que cette villa des Noailles, aujourd’hui bizarrement célébrée, fut liquidée en moins de 50 ans. Et où il faut bien se dire que, sans la Ville d’Hyères qui fit le choix de l’acheter en 1973 et, plus tard, de la restaurer, il n’en serait rien resté. (F.C.)
Photo de Man Ray
CENT ANS, ET ALORS ?
Notes pour le centenaire de la Villa Noailles
Pour tenter de définir son objet, si cela se peut
______________
- Cent ans depuis quand ?
- Acquisition du terrain le 21 janvier 1923 ;
- Première lettre connue de Noailles à Mallet-Stevens datée du 25 juin 1923 ;
- Premiers plans descriptifs en janvier 1924 ;
- Commencement du chantier en mai 1924 ;
- Premier séjour des Noailles en novembre 1925.
- Que faire d’un tel centenaire ?
Pourquoi pas l’occasion, au-delà des fantasmes et des clichés dont le lieu continue d’être l’objet, de dire le vrai, le vrai de son histoire et de ses acteurs ?
Le vrai d’un centenaire qui est en réalité double, au sens où il n’est que la réunion de deux cinquantenaires séparés.
Un cinquantenaire de 1923 à 1973, celui de la Villa Noailles propriété privée des Noailles, qui va de sa construction à son abandon.
Et un cinquantenaire de 1973 à 2023, celui de la Villa Noailles vendue à la Ville d’Hyères et devenue propriété publique, qui va de sa restauration à sa réutilisation.
Et ce n’est pas la même histoire.
- La figure aléatoire des Noailles devrait-elle être à nouveau fêtée au cœur de ce centenaire ? Un gros ouvrage commandité en 20181 a déjà tenté de les immortaliser en « mécènes du XXème siècle ». Mais, dénué de sens critique, il en est ressorti une hagiographie à la gloire d’un couple riche et oisif, impatient de s’amuser, en lequel les auteurs s’émerveillent de voir d’innocents mécènes tous azimuts. Mais c’est un conte de fée pour la veillée des chaumières.
Surtout que la Villa d’Hyères deviendrait vite le lieu de leur naufrage.
- Mais le plus drôle est que nos hagiographes de service, tout à leur idée fixe, vont laisser entendre que la vente de la Villa à la Ville en 1973, c’est encore du mécénat. Prétextant qu’elle fut vendue au prix des Domaines. Or c’est faux, selon l’acte de vente lui-même et le fait que le Conseil Municipal dut autoriser l’augmentation de ce prix. Mais ils insistent. Le sens de cette vente n’est pas dans la vente elle-même, car il faut comprendre qu’avec elle le vicomte lègue en réalité « un héritage spirituel ». Et ils osent même le coup du legs « aux générations futures ». « Spirituel » en plus, ce qui ne coûte pas cher. Drôles d’historiens ! Tout ça pour maquiller la vente d’une maison abandonnée. Avec pour finir une chute à l’effet comique garanti : « Et si le vicomte n’effectue certes pas un don, il est possible d’y voir un acte de transmission, si ce n’est un dernier acte de mécénat.2 » Du mécénat payant en quelque sorte…
- En vérité la villa fut mise en vente au lendemain de la mort de la vicomtesse en 1970. France Soir3 titra : Le château de Marie-Laure est à vendre. Car, y lisait-on, le vicomte ne tient pas à conserver cette demeure. C’était « le royaume de sa femme ». Depuis les années d’après-guerre, quand les moeurs s’y relâchèrent, loin du temps si bref où l’avant-garde artistique y était accueillie, jusqu’au scandale de L’Âge d’Or. Et puis cela faisait 40 ans que le couple s’y était séparé. La maison fut donc vidée de ses meubles, objets et œuvres d’art, et vendue dans un état de délabrement avancé. Quelle transmission !
- Une seule sculpture ne fut pas emportée : le Monument au chat d’Oscar Dominguez. Du fait certain qu’elle pesait 3 tonnes, mais aussi parce que son auteur, dans les années 1950, fut l’amant officiel de la vicomtesse avec laquelle ils formèrent un couple détonnant digne d’une performance surréaliste4.
La ville en devint donc propriétaire et dut l’extraire de la Villa au moment du premier chantier de sa restauration, vers 1988. Elle fut ainsi coffrée et stockée dans une cour municipale dans l’attente d’un lieu à sa mesure. Chose (enfin) faite en 2020, où elle a été installée au cœur du jardin de La Banque / Musée des cultures et du paysage.
Créée en 1953, on pourrait fêter ses 70 ans en 2023.
- Mais alors pourquoi ne pas faire de la maison elle-même l’objet d’un tel centenaire ? La première maison construite d’un jeune architecte moderne et raffiné, jusque-là architecte-décorateur de cinéma, Rob Mallet-Stevens. Promis à un brillant avenir, il a été recommandé pour son goût et son imagination au vicomte.
Oui mais voilà, si le vicomte voulait un architecte, il ne voulait pas d’architecture. L’architecte, c’était pour l’image et le standing, et il serait à ses ordres. Le malentendu fut immédiat. Le vicomte fit ainsi démolir en plein chantier une tour qui figurait l’axe central à partir duquel les cubes de la façade devaient se développer. Mallet-Stevens, désemparé, lui écrivit : « Je vous en supplie n’y touchons pas ; j’ai fait des croquis pour m’imaginer la maison sans la tour et l’on obtient alors un ensemble sans relief, sans silhouette et sans expression.5 » Un jugement sans appel qui pourrait surprendre l’actuel directeur de la Villa émerveillé par « ce lieu magique, extraordinaire de beauté, dont Robert Mallet-Stevens a si bien su ciseler les façades.6 »
Mais rien n’y fit. Mallet-Stevens dut s’incliner. C’était sa première commande. Malgré quoi des éléments significatifs de son vocabulaire purent s’exprimer et quelques gestes remarquables être produits7. Noter ici qu’au-delà du programme initial, les Noailles se sentant à l’étroit, la maison ne cessa de s’agrandir et s’étendit jusqu’en 1932 au gré du terrain, sans plan et sans Mallet-Stevens.
Si bien qu’à l’arrivée, la Villa Noailles reste le nom d’un ensemble hétéroclite, incohérent, sans la moindre unité architecturale.
Rien à voir avec la Villa dont Paul Cavrois, à Croix, confierait la réalisation à Mallet-Stevens en 1929. Premier chef d’œuvre de l’architecte qui, laissé libre de son génie et de son geste, réalisa « une œuvre d’art totale ». On ne peut pas tout avoir.
- Mais un autre moment de ce centenaire mériterait d’être retenu, par lequel s’ouvre son second cinquantenaire, quand la ville d’Hyères est devenue propriétaire de la Villa actant la chute de la maison historique des Noailles au bout de cinquante ans. Une autre histoire commence dont l’enjeu majeur va être la restauration de ladite maison vendue en piteux état.
Car, après un premier chantier partiel et sans lendemain (1988-1989), la Ville va prendre la décision de devenir le maître d’ouvrage de la restauration de l’ensemble du bâtiment menaçant ruine. Un geste politique radical en faveur d’un chantier qui va s’étendre de 1995 à 2003. J’ai été un acteur de cette restauration. Chargé par le maire d’alors, Léopold Ritondale, de mener toutes les actions utiles à sa réussite, avec le soutien officiel des institutions, et de les défendre devant le Conseil Municipal.
Pour mémoire, cette mission a été remplie.
Les partenaires institutionnels mobilisés, un plan de financement public (Etat/Drac, Région, Département, Ville) a été validé et le chantier de la restauration est allé à son terme.
Un projet de réutilisation de la Villa restaurée a dû être défini. Pour le porter, l’Association « Villa Noailles » a été constituée avec Didier Grumbach, son premier président. Le Festival des Jeunes Stylistes (créé à Hyères en 1985) sera le moteur du projet qui reposera sur l’Alliance de l’Architecture, de la Photographie, du Design et des Arts de la Mode. Voté par le Conseil Municipal et approuvé par tous les partenaires.
Quant au directeur de la Villa, son choix a été arrêté au Palais Royal par François Barré alors Directeur de l’Architecture et du Patrimoine. Didier Grumbach m’accompagnait et a été témoin de mon intervention quand j’ai présenté le candidat de la ville, face à un concurrent. C’est ainsi que la candidature de Jean-Pierre Blanc a été retenue. C’était le 22 avril 1999.
Le projet allait pouvoir se réaliser et une nouvelle aventure se vivre à la Villa Noailles.
Jean-Jacques Aillagon, Ministre de la Culture, est venu en 2003 applaudir cet exploit de la ville d’Hyères. Juste l’année du transfert bureaucratique de la Villa Noailles à la communauté d’agglomération TPM, quand la ville en perdrait la maîtrise.
- Aucune histoire n’a jamais coulé à la façon rêvée d’un fleuve tranquille. Celle de la Villa Noailles, avec ses hasards et ses ruptures, comme les autres. Son centenaire, en quête d’un objet culturellement crédible, pourrait être ainsi l’occasion d’un exercice de lucidité. Utile à l’intelligence de son action présente. En sachant qu’on ne peut entrer deux fois dans le même fleuve. Que la Villa de Charles et Marie-Laure a cessé d’exister pour toujours. Que sa restauration n’est pas une résurrection. Et qu’il est vain de faire croire qu’on y serait revenu à la case départ pour y perpétuer une « œuvre » qui, sauf abus de langage, n’a jamais existé.
François Carrassan / 2022
Notes /
- Charles et Marie-Laure de Noailles, Mécènes du XXème siècle, Bernard Chauveau, 2018
- Ibid, pp. 323-324
- France Soir, 13 février 1970
- Laurence Benaïm, Marie-Laure de Noailles / Vicomtesse du bizarre, Grasset, 2001, pp. 465-476
- Cécile Briolle, Rob Mallet-Stevens, Editions Parenthèses, 1990, p. 41
- Charles et Marie-Laure de Noailles, op. cit., p.8
- François Carrassan, Une petite maison dans le midi, Editions de L’Yeuse, 2003, pp. 7-13
de la dernière fête au château Saint-Bernard en 1932 avec Bunuel, Giacometti et la girafe surréaliste, disparue dans la nuit, jamais retrouvée aux bimbos gonflables Diesel, vandalisées lors du 37e Festival de mode, de photographie et d'accessoires du 13 au 16 octobre 2022, à la villa Noailles
/https%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-utyiEh0PkGg%2FT3nF6lft3fI%2FAAAAAAAACy0%2F4HdX2GUVgpw%2Fs640%2Fvilla-noailles-hyeres1.jpg)
ARTPLAFOX: La vila Noailles Robert Mallet Stevens 1923 1924
" La Villa de Noailles " Robert Mallet Stevens 1923 : La villa Noailles figure parmi les toutes premières constructions destyle moderne réalisées en France. Dessinée en décembre 1923 et habit...
l'album photo de cet article montre l'état de délabrement de la Villa Noailles avant réhabilitation
Me souvenant de ma visite de la Villa Noailles en pleine dégradation, sous la conduite éclairée de François Carrassan, ce devait être vers 1986-1987, et pensant au combat que fut sa réhabilitation avec de l'argent public, avant son invasion par le monde de la mode, pensant aux livres écrits depuis sur cette villa et son architecte, Mallet-Stevens, je ne peux que partager cette interrogation de François Carrassan sur l'imposture qui est à l'oeuvre dans ce lieu aujourd'hui tant dans le récit qui en est fait, révisionniste à souhait, que dans l'usage dominant du lieu, réservé aux "mondains" d'aujourd'hui, dont l'inculture insolente fait plaisir à être démasquée.
JCG, alias l'assaisonneur ou grossel
Avec le souvenir de mon engagement pour la restauration de la Villa Noailles, on me demande parfois ce que je pense de l’actuelle exposition permanente qui s’y tient et s’intitule
Charles et Marie-Laure de Noailles / une vie de mécènes
Je fais alors observer que son titre est mensonger et qu’il est paradoxal de vanter le mécénat des Noailles dans un lieu qu’ils ont abandonné et qui a été sauvé de la ruine par l’argent public.
Sans savoir qui a validé ce projet ni sur la base de quelle expertise, voici donc ces notes qui invitent à un curieux constat :
UN FANTASME MONDAIN
1. L’exposition est principalement faite d’images, de reproductions, de fac similés, de photocopies en quantité. On se croirait dans un centre de documentation pédagogique.
Malgré le design appliqué de la présentation, cela saute aux yeux. L’amateur d’art voit qu’il n’y a pas grand-chose à voir et bien trop à lire. « Une coquille vide », comme on l’entend dire.
Sauf les Noailles photographiés ici et là en compagnie de telles ou telles personnalités. On pense aux trombinoscopes des magazines people qui montrent des happy few posant entre eux lors de soirées réservées. Souriants et contents de leur sort. Mais un mécène n’est pas une œuvre d’art.
2. L’exposition se tient dans la partie dite primitive de la villa, celle dont on est sûr que l’architecte en fut Rob. Mallet-Stevens, celle qui fut construite en 1924 et agrandie en 1927.
C’était une petite maison d’habitation avec de petites pièces en petit nombre, et tout y paraît aujourd’hui d’autant plus petit qu’on en a fait sans adaptation un espace ouvert au public et ainsi très vite saturé. A l’évidence, la contradiction des usages n’a pas été surmontée.
Reste que l’architecte, dans l’exposition, occupe la place du pauvre, à l’écart et à l’étroit, dans un recoin d’à peine 5 m2… Rien sur son rôle dans l’histoire de l’architecture, alors même que cette maison délibérément moderne constitue un manifeste radical. Rien sur ce geste qui intègre la maison aux ruines médiévales alentour et lui donne son esprit malgré Charles de Noailles qui, peu porté sur l’architecture, l’aura empêché d’aller au bout de son projet. Rien sur l’UAM, l’Union des Artistes Modernes, qu’il allait fonder en 1929.
3. Le titre de l’exposition laisse croire que Charles et Marie-Laure de Noailles formèrent un couple uni dans le même amour désintéressé de l’art et qu’ils menèrent côte à côte une vie de mécènes, jour après jour au service de l’art…
Or, s’ils se marièrent bien en 1923, recevant en cadeau le terrain de leur future maison d’Hyères, le couple ne dura guère, perdu entre les tendances de l’un et les attirances de l’autre, et connut assez vite une séparation de fait.
En 1933, Marie-Laure rejoint Igor Markévitch en Suisse. Charles, lui, a cessé à cette époque de s’intéresser à la chose moderne et sa femme s’occupera seule de la maison d’Hyères après la guerre. Il se retirera ainsi à Grasse dans une bastide du XVIIIème siècle, acquise en 1923, où il s’adonnera à l’horticulture.
Cette réalité, ici absente, ne correspond évidemment pas à l’intention de l’exposition.
4. Quant au lieu même de l’exposition, la propre villa des mécènes à l’affiche, son histoire n’est que partiellement évoquée et seulement sur la période qui convient au concept de l’exposition.
Car si cette maison fut effectivement ouverte à la création artistique, cela ne dura guère. Dès 1933 la vicomtesse écrivait en effet : « Nous démodernisons la maison. » C’est que le « couple » avait été refroidi par le scandale de L’âge d’or survenu en 1930, principalement le vicomte qui avait payé le film de Luis Buñuel et, naïvement, n’avait rien vu venir…
C’est vrai aussi que leur « aventure moderne » doit beaucoup au fait qu’ils étaient alors, comme l’écrira Charles, jeunes et impatients et qu’il fallait selon lui que tout soit amusant. Leur fortune héritée faciliterait les choses.
Et quand il invita Man Ray à venir tourner à Hyères en 1928, un tel geste, apparemment en faveur du cinéma naissant, reposait aussi sur le désir manifeste de faire voir sa maison.
Ainsi cette aventure, portée par la volonté évidente de se distinguer, n’excéda pas dix ans. Et, comme pour l’accompagner sur sa pente, la maison elle-même empiriquement bâtie se dégrada lentement, se fissura et prit l’eau. Un processus qui s’accéléra après la guerre quand le bâtiment cessa peu à peu d’être entretenu.
Et c’est durant ces années 50-60 que Marie-Laure de Noailles en fit sa demeure. Une demeure improbable où, dans une ambiance passablement décadente, elle entretenait une faune hétéroclite dont la rumeur locale se plaisait à imaginer les galipettes sexuelles.
Toujours est-il qu’aussitôt après sa mort, en 1970, le vicomte mit la maison en vente dans un très piteux état et fit en sorte que la ville d’Hyères pût l’acheter. Marché conclu en 1973. « C’était à ses yeux le royaume de sa femme », comme l’écrivait alors France Soir. Mais son image avait quand même dû se dégrader pour que, plus tard, quand la Ville entreprit de restaurer la maison, ses descendants ne souhaitent pas qu’on l’appelle « Villa Noailles »…
5. Car c’est bien la Ville d’Hyères qui allait entreprendre sa restauration avec le soutien de l’Etat. Et c’est bien avec le seul argent public qu’on paierait son long et coûteux chantier.
Aussi n’est-ce pas le moindre paradoxe de cette exposition, d’être consacrée à l’éloge illimité du mécénat des Noailles dans un lieu qu’ils ont abandonné à sa ruine. Un point de l’histoire ici passé sous silence.
6. Nul doute cependant que ce « couple » d’aristocrates décalés, au temps de sa jeunesse libre et argentée, en rupture avec la bien-pensance et son milieu d’origine, aura attiré l’attention et soutenu quelques artistes « émergents ».
Aucun doute non plus sur la générosité de Charles de Noailles dont Luis Buñuel témoignait volontiers et avec lequel il resta en relation bien après l’âge d’or de leur (més)aventure commune.
Mais rien qui permette sérieusement de voir au cœur du « couple » le projet construit de mener une vie de mécènes au nom d’on ne sait quelle exigence artistique, comme tente de le faire croire la page imprimée à l’usage des visiteurs de l’exposition.
7. Une vie de mécènes, c’est en effet le titre de ce document indigeste qui apparaît comme le support théorique de l’exposition. Un discours d’autojustification prétentieux qui se résume à un postulat, sans cesse répété, celui de « l’extraordinaire mécénat» des Noailles. Un mécénat non stop de 1923 à 1970, selon l’auteur…
(Même si cette déclaration est contredite par le texte d’introduction à l’exposition qui parle du « ralentissement » de ce mécénat après 1930…)
8. Et, dans ce drôle de galimatias, on peut lire pêle-mêle :
que les Noailles ont élargi la définition du mécénat; qu’ils ont saisi que la modernité c’est le collage (…), un partage entre plusieurs influences; que Marie-Laure de Noailles opère plus ou moins consciemment une confrontation quasi-systématique entre basse et haute culture; que Charles de Noailles saisit intuitivement que les révolutions intellectuelles à venir ne se construiront pas seulement sur l’héritage surréaliste… qu’ils sont au cœur de la modernité. Ou plus exactement des modernités; qu’ils ont choisi de vivre non pas au cœur de l’avant-garde, mais des avant-gardes (c’est moi qui souligne). Probablement l’auteur est-il égaré par son admiration pour ces illustres personnages, mais dans un « Centre d’art » il est regrettable de voir une telle confusion intellectuelle se donner libre cours.
Est-ce l’effet de l’absence d’un conservateur et d’un véritable projet scientifique et culturel ?
9. De fait l’exposition a un petit côté grotte de Lourdes. On pourrait s’y croire dans un sanctuaire réservé au culte de Charles et Marie-Laure de Noailles. Où le moindre souvenir, survalorisé, a pris la dimension d’une relique.
10. Culturellement, on pourrait s’inquiéter :
d’un tel défaut de distance critique. d’une adhésion si totale à une histoire à ce point « arrangée » et présentée au visiteur comme une vérité admirable et définitive. d’une telle tendance à la vénération comme on en voit dans les fan-clubs, où tout ce qui touche à votre idole, par le seul fait d’y toucher, devient infiniment précieux. 11. L’exposition a donc échafaudé un conte bleu. Tout y est sucré, propre et lisse. Charles et Marie-Laure veillent sur l’art. Les touristes sont invités à se recueillir.
12. On mesure comme on est loin de la vérité du commencement. Quand on sait qu’en ce lieu très privé fut autrefois fêtée une sorte d’insoumission et que la maison brilla rien que pour le plaisir passager des Noailles et de leurs invités jouant à une autre manière de passer le temps.
Charles de Noailles, à la fin de sa vie, avait pourtant tout dit de cette époque disparue : « Nous aimions nous amuser avec des gens intelligents et de valeur.
François Carrassan / Mai 2015
/https%3A%2F%2Ffrancoiscarrassan.files.wordpress.com%2F2015%2F07%2Fimg391.jpg%3Fw%3D309%26h%3D365)
Villa Noailles / Exposition permanente
Avec le souvenir de mon engagement pour la restauration de la Villa Noailles, on me demande parfois ce que je pense de l'actuelle exposition permanente qui s'y tient et s'intitule Charles et Marie-...
https://francoiscarrassan.wordpress.com/2015/07/22/villa-noailles-exposition-permanente/
le flot-flow
le pog de montségur, rocher demain bûcher; photo Annie Bergougnous du 8 janvier 2023 / de quel feu brûle le volcan éteint en face du pog de Montségur le 8 janvier 2023 / photo Annie Bergougnous
/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FfdHiXzIXqVM%2Fhqdefault.jpg)
Transmission de la Méditation par Père Séraphim - Jean Yves Leloup
Uploaded by Seraphim Pastor on 2019-07-25.
méditer comme une montagne, comme l'océan, comme un coquelicot, comme une tourterelle
/https%3A%2F%2Fi0.wp.com%2Faidee-bernard.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2Fpages-livres_jupe-copie.jpg%3Ffit%3D1080%2C751%26ssl%3D1)
La jupe de correspondance - Aïdée Bernard Création papier
Livre jupe, La jupe de correspondance,œeuvre papier d'Aïdée Bernard, folio d'or au concours de livre d'artiste d'Albi, acquis par la médiathèque d'Albi.
la jupe de correspondance, j'en ai une chez moi
/https%3A%2F%2Fi0.wp.com%2Faidee-bernard.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2Fvernissage.jpg%3Ffit%3D800%2C533%26ssl%3D1)
Le livre sillage, livre poème - Aïdée Bernard Création papier
Le livre sillage, livre poème en papier de fibres de folle avoine et peuplier, d'après le poème de Jena-Claude Grosse, Dans le sillage de Baïkala.
la vague sillage, j'en ai une chez moi
/https%3A%2F%2Fi0.wp.com%2Faidee-bernard.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2FIMG_7322-e1511425816919.jpeg%3Ffit%3D533%2C800%26ssl%3D1)
La subway dress, paper dress - Aïdée Bernard Création papier
La subway dress, paper dress en hommage à Maryline Monroe, création en papier de plantes d'Aïdée Bernard sur une invitation des Cahiers de l'Égaré.
la dendrochronologie ou lire un tronc d'arbre Placez-vous face à l'arbre et mesurez sa circonférence à 1.40 m de hauteur. Divisez le chiffre en centimètres obtenu par π (égal à 3.1416 environ) puis multipliez le résultat par le facteur multiplicateur qui correspond à l'arbre. Exemple : Pour un chêne qui mesure 2.45 m, on obtient 245 : 3.1416 = 77.99 x 3 = 233 ans / la forêt, vulve végétale, y pénétrer avec respect / Le bain de forêt est une activité qui offre une forme de thérapie douce, par la forêt (sylvothérapie) qui nous vient du Japon sous le nom de « Shinrin-Yoku » depuis les années 80. / la parole de l'eau, création d'Aïdée Bernard, installée dans une chapelle de l'Aude / un kakémono d'Aïdée Bernard
/https%3A%2F%2Fapi-cdn.arte.tv%2Fimg%2Fv2%2Fimage%2FBnGJ5hFqinL9ajSeBqBZBR%2F1920x1080%3Ftype%3DTEXT%26watermark%3Dtrue)
Mademoiselle Chambon - Regarder le film complet | ARTE
Jean, maçon, mari et père exemplaire, s'éprend de l'institutrice de son fils... Un amour impossible, filmé avec délicatesse par Stéphane Brizé ("La loi du marché") et porté par un remarqua...
https://www.arte.tv/fr/videos/043033-000-A/mademoiselle-chambon
ou un amour consommé et brisé portera ses fruits, je suis sûr que mademoiselle Chambon (titre impossible aujourd'hui) donnera naissance à un vigoureux futur maçon; Véronique l'annoncera-t-elle à Jean ?
/https%3A%2F%2Fapi-cdn.arte.tv%2Fimg%2Fv2%2Fimage%2FEscWH83YHvTqWdNz5bmTgf%2F1920x1080%3Ftype%3DTEXT%26watermark%3Dtrue)
Matador - Regarder le film complet | ARTE
Un professeur de tauromachie sadique et un jeune homme troublé croisent la route d'une séduisante meurtrière... Avec Antonio Banderas, une fable érotique et macabre, orchestrée avec panache et...
savourer pour elle-même la scène finale de 1 H 35 à 1 H 39
jusqu'à l'os
tu crois marcher sur le sol solide, tu marches dans les espaces-temps einsteinien / tu te crois d'os, t'es fluide / tu te crois résistant, t'es collabo / tu te crois communiste anti-fasciste, tu participes au stalinisme des purges, des procès, du goulag, des déplacements de populations, de la terreur / tu veux faire entendre la spirale des silences de Sebald et tu déclenches bruits et fureurs, polémiques, avant de te retirer avec ton enfant mort / est-ce le monde, l'atmosphère du temps qui est secouée par les turbulences de la guerre en cours dont on se demande où elle a cours ou ces turbulences sont-elles les remous remontant de nos abysses ? image : BRENDAN MONROE – ISLANDS COMIC ZINE Art // octobre 18th, 2011
Prévert et sa petite fille / le radeau de la méduse d'après l'esthétique de la résistance de Peter Weiss et Sylvain Creuzevault = spectacle-monde qui tourne et va tourner / les acteurs et leur rêve de Kristian Lupa = les émigrants, spectacle annulé par la Comédie de Genève / deux spectacles-mondes, deux sorts opposés / le rêve yeux ouverts de l'âne Diego de Kheira Belahouel = la voie
il y a des blessures en lien avec l'histoire au présent, celle qui se joue et dont on sait que c'est l'histoire, qui ne cessent de nous travailler jusqu'à l'os
-------------------------------
désolé si je déçois
mais le mouvement pour le retrait de la réforme des retraites à 64 ans ne me semble pas un moment historique
manifester 14 ou 15 fois en soumettant le retrait à un vote à l'assemblée nationale, attendre plus d'un mois entre le 1° mai et le 6 juin, c'est clairement faire le choix de l'acceptation et de la démobilisation;
aucun mot d'ordre genre préparons la grève générale jusqu'au retrait,
aucun appel à constituer des comités d'action, à inventer des formes
(décentraliser au lieu de tout centrer sur Paris ou sur le blocage des raffineries, pour affaiblir la répression qui ne pourrait s'exercer dans tout le pays);
bref, les organisations syndicales (les directions-les appareils) n'ont pas facilité l'auto-organisation d'une puissante grève générale jusqu'au retrait
et à la base, très peu d'initiatives, d'actions de blocages
plus essentiel, combattre pour freiner l'exploitation du travail des salariés par le capitalisme néo-libéral sans poser la question de l'exploitation forcenée de la planète au moyen du travail des salariés, exploitation qui mène à l'effondrement, révèle une fois de plus l'aveuglement collectif (hypnose collective) sur ce système de prédation qui conduit au suicide collectif de l'humanité
pour peut-être changer de paradigme, nécessité enfin de mettre radicalement en cause nos modes de consommation, de divertissement, nos addictions audiovisuelles, internautiques qui font de nous en tant que consommateurs des collaborateurs, des soumis volontaires du système d'exploitation et de domination
----------------------------
par contre le mouvement des GJ fut un mouvement historique, plus par les ronds-points et AG que par les manifestations aux Champs-Elysées, davantage que Nuit debout;
des graines ont été semées dont certaines germinent et donneront des fruits par rhizomes
-----------------------------
ainsi pour moi, qui arrive en Algérie en septembre 62, qui en repart en février 64 et qui a vécu de près, le putsch des généraux en 61, qui a vu De Gaulle passer de l'Algérie française à l'Algérie indépendante entre 1960 et 1962, la fin de la guerre d'Algérie (1959-1964) est une blessure toujours vive en lien avec un double sentiment, de trahison et de gâchis ;
depuis l'indépendance, l'Algérie a vécu des événements terribles (la décennie noire) qui bien sûr interrogent, mettent mal à l'aise
enfin, l'échec du Hirak laisse un goût amer
----------------------------
si j'étais arrivé avant, j'aurais été confronté à la question de la torture;
il y a des tortionnaires qui vivent toujours avec le souvenir de cette pratique; comment vivent-ils leur soumission aux ordres ?
----------------------------
blessure qu'on essaie de calmer en s'informant, en lisant, en choisissant, en débattant, en créant
ainsi le bocal agité algéro-varois de 3 jours en juin 2002 au Revest
ainsi l'accueil du spectacle El Halia de Louis Arti aux Comoni
ainsi ma réaction récente devant la toile Djamila Boupacha d'Alain Le Cozannet à l'espace Saint-Nazaire à Sanary
ainsi une soirée récente où l'Algérie, Camus, une 3° voie, nous occupa pendant 5 H
-------------------------------
ces blessures vives indiquent que l'histoire n'est pas déterminée
on sent qu'il aurait suffi de peu pour qu'une autre voie s'ouvre
ces blessures, malgré la durabilité des sentiments de trahison, de gâchis, ouvrent sur l'espoir que ça peut changer et ça change
60 ans pour que l'État français reconnaisse sa responsabilité et celle de l'armée dans l'usage systémique de la torture et du viol
-----------------------------------------
https://www.facebook.com/jeanyves.clement.5/videos/1625002551321269
-------------------------------------------
Partir
Sachant seulement un matin qu'il faut partir
Ignorant tout de ce que sera l'avenir
Partir au loin pour un ailleurs.
Partir
Pour d'autres cieux, d'autres soleils, d'autres matins
Partir comme une ombre brisée sur le chemin
Partir en y laissant son coeur.
Partir
Quitter sa ville, son village, sa maison
Quitter sa terre, ses racines, ses chansons
Partir pour un monde meilleur.
Partir
Fuyant l'enfer, l'intolérable, la folie
Pour garder comme un semblant de sens à sa vie
Partir en y laissant son coeur.
Partir
Le coeur à l'agonie, le coeur brisé
En infidèle, en clandestin, en accusé
Partir avant le petit jour.
Partir
Pour que l'espoir encor' survive dans nos coeurs
Pour juste un peu de liberté et de chaleur
Peut-être encore un peu d'amour.
Partir
Quitter sa ville, son village, sa maison
Quitter sa terre, ses racines, ses chansons
Partir pour un monde meilleur.
Partir
Pour que l'espoir encor' survive dans nos coeurs
Pour juste un peu de liberté et de chaleur
Partir au loin pour un ailleurs
Partir pour oublier la peur.
Partir.
Alain Barrière 1980
------------------------------------
si je tente d'inventorier mes blessures en lien avec l'histoire, j'en trouve 4
- blessure reconstituée, j'avais 2-3 ans, le sabordage de la flotte à Toulon, le 27 novembre 1942; la flotte aurait pu s'échapper
- mai 68, à la fois au Quesnoy dans le Nord, élu membre du comité de grève de la ville, et à Nanterre dans le sillage de Cohn-Bendit et les autres membres du mouvement du 22 mars; le pouvoir aurait pu changer de camp, des possibles étaient disponibles; les négociations de Grenelle ont sauvé le capitalisme
- 11 septembre 2001, l'invention de la nouvelle forme de l'axe du Mal par l'impérialisme américain
----------------------------------
aujourd'hui, ces blessures qui font tourner le regard vers le monde, me semblent ne pas devoir être surestimées; l'essentiel des blessures qui nous tiennent debout sont très lointaines, familiales, inter-générationnelles, archétypales et travailler sur soi, prendre conscience de comment on fonctionne me semble plus décisif que de tenter vouloir changer le monde, à l'image de nos tumultes intérieurs
j'entends parler de résistants, il y a donc des collabos; tous ces mots produisent de la séparation, du conflit; idem avec lutte des classes ou ultra-riches et pauvres; quand on emploie le langage de la séparation, évidemment, on est du bon côté, du côté de la justice, du droit, de l'humanisme, des grandes valeurs
/https%3A%2F%2Fwww.parismatch.com%2Flmnr%2Fvar%2Fpm%2Fpublic%2Fmedia%2Fimage%2F2022%2F03%2F03%2F12%2FEugenie-Bachelot-Prevert-Jacques-Prevert-mon-grand-pere.png%3FVersionId%3Dmui9UIm13BPa6SN7z9wAMmBEi6EgcZil)
Eugénie Bachelot-Prévert : "Jacques Prévert, mon grand-père"
Il y a quarante ans disparaissait Jacques Prévert... 472 établissements scolaires portent son nom, quatrième après saint Joseph, Jules Ferry et Notre-Dame ! Ses poèmes sont traduits en 40 la...
/image%2F0555840%2F20200110%2Fob_11b7dd_chasseurs-de-mutins-dc3a9tective.png)
La chasse à l'enfant/Jacques Prévert - bric à bracs d'ailleurs et d'ici
3 chasseurs de mutins d'après Détective La chasse à l'enfant, Jacques Prévert En 1934, au pénitencier de Belle-Ile-en-Mer, un enfant ose mordre dans un bout de fromage avant de manger sa soupe...
https://www.bricabracs.fr/2020/01/la-chasse-a-l-enfant/jacques-prevert.html
/https%3A%2F%2Fwww.comedie.ch%2Fmedia%2Fcomediedegeneve%2F149181-20230411_emigrants_lupa_rep_comedie_dougados_magali_015-1.jpg)
La spirale des silences, de W. G. Sebald à Krystian Lupa - Comédie de Genève | théâtre
Arielle Meyer MacLeod présente "Les Émigrants", un spectacle de Krystian Lupa à voir à la Comédie de Genève du 01 au 17 juin 2023
https://www.comedie.ch/fr/la-spirale-des-silences-de-w-g-sebald-a-krystian-lupa
/https%3A%2F%2Fwww.mediapart.fr%2Fassets%2Ffront%2Fimages%2Fsocial%2Fog_image%2Fbillet_blog.png)
La triste et lamentable annulation du spectacle de Krystian Lupa
Après la création à Genève, le Festival d'Avignon s'appétait à accueillir " Les émigrants " d'après W.G Sebald,le nouveau spectacle de l'immense artiste polonais Krystian Lupa. Il n'en sera...
article de Jean-Pierre Thibaudat
/https%3A%2F%2Fblogs.letemps.ch%2Fmatthieu-beguelin%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F424%2F2023%2F06%2FLupa.jpg)
Retour sur un gâchis: qu'ils crèvent les artistes!
La décision d'annuler la création du spectacle " Les Émigrants " de Krystian Lupa prise par la direction sortante de la Comédie de Genève est l'occasion de bien des fantasmes. Les termes ...
un point de vue
Interview de Joëlle Gayot :
Mis en cause pour ses méthodes de travail à la Comédie de Genève, le Polonais réagit, dans un entretien au « Monde ». S’il reconnaît avoir « déraillé », il pointe le « forcing scandaleux » des équipes techniques.
Après avoir été déprogrammé de la Comédie de Genève en raison de manquements du metteur en scène aux règles du théâtre suisse, Les Emigrants, spectacle du Polonais Krystian Lupa, ne sera pas non plus joué à Avignon. L’annonce en a été faite mercredi 7 juin par Tiago Rodrigues, le nouveau directeur du festival. Nous avons joint l’artiste polonais à Cracovie.
Quelle est votre réaction après ces deux annulations successives ?
Je suis très surpris. Je n’avais jamais connu, jusqu’ici, une telle situation. A Genève, j’ai été confronté à la révolte d’une équipe technique qui a conduit la direction du théâtre à retirer le spectacle de son affiche.
Je tiens à rappeler le contexte. En Suisse, nous avions perdu une semaine de travail, car j’avais attrapé le Covid, début avril, de manière très violente. Pour ces raisons, la fin des répétitions s’annonçait très stressante. Nous avons commencé les répétitions techniques tardivement, or Les Emigrants est un spectacle extrêmement compliqué sur ce plan. Au tout début de ces ultimes séances de travail, j’ai tenu à prévenir tout le monde : en raison du manque de temps, une période difficile nous attendait. J’ai donc dit que j’essaierais de mener les répétitions de la façon la plus apaisée qui soit. Je me connais bien : non seulement je suis moi-même quelqu’un de très émotionnel, mais nous opérons, avec les comédiens, sur les émotions. Je me suis excusé à l’avance pour d’éventuels débordements dont je savais qu’ils pouvaient surgir. C’est ce qui a eu lieu, à deux reprises. Lorsque je suis dans un élan avec les acteurs et dans un état d’accélération intime, je cultive le fou intérieur en moi pour m’en servir et accéder à d’autres zones de pensée.
C’est dans ce contexte particulier que je me suis heurté aux équipes techniques. Celles de la lumière, qui, parce qu’elles me soumettaient des réglages à l’inverse de ce que je réclamais avec insistance, m’ont précipité dans une sorte de schizophrénie. J’ai déraillé. J’en ai honte. Puis j’ai aussi eu des problèmes avec le régisseur son, chez qui j’ai senti d’emblée le refus d’adapter sa méthode à la mienne. Je ne m’en cache pas, ces dernières répétitions techniques m’épuisaient, mais je n’étais pas agressif. Ce n’est pas mon ego surdimensionné qui est la source de ce conflit, mais l’ego surdimensionné de cette équipe.
Après ces événements, vécus comme un traumatisme par le théâtre de Genève, par les comédiens et, sans doute, par vous-même, diriez-vous que deux mondes incompatibles se sont rencontrés ? Celui des techniciens suisses et de leurs valeurs, et le vôtre, avec les exigences artistiques qui vous appartiennent ?
Il est certain qu’il s’agit du contraste de deux mondes. Je pense que l’équipe technique, qui ne voulait rien changer à ses façons de travailler, a fait le forcing auprès des directeurs de la Comédie de Genève, malgré les tentatives de ces derniers de calmer les choses. Je trouve ce forcing scandaleux. Pas par rapport à moi, mais par rapport aux acteurs. En cherchant à me punir ou à me contraindre à adopter leurs méthodes, ces techniciens n’ont absolument pas pris en considération l’immense travail accompli par les autres partenaires. Ils auraient dû trouver le moyen de s’en prendre à moi, et à moi seulement, sans affecter l’ensemble de la troupe artistique.
Pensez-vous que ce qui vient de se passer peut influer, demain, sur vos marges de manœuvre dans une salle de répétition ?
Il y a eu, voici deux ans, en Pologne, une discussion générale sur la violence au théâtre. J’ai appris que certains cherchaient des reproches à me faire. Je l’ai très mal vécu, mais j’ai profité de ce débat public pour me remettre en question. Dans ce travail que je mène un peu « à la sauvage », il a pu m’arriver d’aller trop loin. Au nom des rêves qui m’animent, je me suis permis d’exprimer mes émotions ou de formuler mon opinion de façon extrême, sans me rendre compte que mon attitude pouvait provoquer de la souffrance. J’ai toujours été partisan de la plus grande sincérité. Je l’exige de moi-même et je l’attends des autres. Mais je suis sans doute quelqu’un de fort, ce que tout le monde n’est pas. Lorsque j’ai eu compris ça, j’ai fait plus attention. Comment peut-on dire la vérité sans blesser ceux qui nous font face ? Cette réflexion est nécessaire.
Cette prise de conscience a permis au travail sur Imagine – spectacle que j’ai créé en avril 2022 mais dont les répétitions, à Varsovie, avaient démarré fin 2021 – de se dérouler dans une incroyable harmonie, avec l’équipe technique comme avec les acteurs. Nous en étions extrêmement heureux, nous avons tous senti que cette voie était la bonne. Arrivant à Genève, je voulais revivre la même harmonie, mais je n’ai pas réussi. Je crois qu’après avoir attrapé le Covid je suis tombé dans un état psychique critique. Le temps me manquait, mes nerfs étaient en morceaux alors qu’il faut une discipline stable et une bonne condition psychique. Des éléments qui ne dépendent pas seulement de moi, mais aussi de l’ambiance générale. Or j’ai ressenti, et les acteurs également, une animosité immédiate à mon égard de la part de l’équipe technique genevoise.
Cette création des « Emigrants », d’après le récit de W. G. Sebald, occupe-t-elle une place singulière dans votre parcours ?
Il y avait dans ce spectacle quelque chose d’important, d’infiniment personnel et de très nouveau. Raisons qui expliquent, aussi, cette montée de pression émotionnelle. Je ne voulais surtout pas gâcher ce rêve. Avec les comédiens, nous étions parvenus à quelque chose d’assez exceptionnel. Il s’agit pour moi du spectacle le plus important depuis Factory 2, que j’ai créé en 2008 à Cracovie et joué à Paris en 2010.
Qu’est-ce qui l’emporte en vous aujourd’hui : la colère, le chagrin, l’incompréhension, le remords ?
J’ai 79 ans, je suis trop vieux pour être en colère. Etant donné mon âge, il me semble que je mérite un peu d’indulgence. Je suis rentré chez moi à Cracovie et je me sens abandonné. Mon enfant est mort. J’ai perdu un enfant.
(alors là, sur les réseaux sociaux, haro sur le vieux Lupa qui ose dire ça) JCG
Traduction assurée par Agnieszka Zgieb, dont Imagine, un livre d’entretiens avec des acteurs et Krystian Lupa, doit sortir en juillet aux éditions Deuxième époque.
À partir des années 90, des milliers d'emplois inutiles ont squatté les crédits des Théâtres du Service Public. Des milliers d'emplois fixes de médiateurs culturels et autres accompagnateurs administratifs, ont détourné l'argent public pour remplir des bureaux !... Et nous, artistes, intermittents, avons alors alors entendu l'éternel refrain : "Il n'y a plus d'argent". Oui, il n'y a plus d'argent pour la création car il a été détourné. Et aujourd'hui, les emplois fixes avec le syndicats dont c'est évidemment le rôle de protéger l'emploi, ont détruire la "fragilité" des artistes, des intermittents qui, pour ce que nous savons de l'histoire de Lupa, ont soutenu cet immense créateur jusqu'au bout ! Je viens de voir les 5 heures de Sylvain Creuzevault/Peter Weiss où l'on voit combien les époques fascisantes détruisent, en plus de tout le reste… la création, les œuvres d'art, les créateurs artistique. À suivre en résistance ! Moni Grégo.
Les Émigrants de Krystian Lupa
Entretiens avec les acteurs suisses et français par Arielle Meyer-Macleod de la Comédie de Genève. via Agnieszka Zgieb
PIERRE BANDERET (LE NARRATEUR)
Krystian Lupa génère par la parole un processus infini de dépliage qui implique que, moi aussi, je dois me déplier. Pour être disponible à recevoir ce qu’il m’offre.
Sa lecture du texte – cultivée, érudite et ample – est avant tout de l’ordre du sensible. Il ne parle pas comme un professeur, mais comme un médium qui jette une lumière entre le texte et ce qu’on peut y voir. Il n’explique pas les choses, il me les donne. Un cadeau qui n’est pas toujours facile à ouvrir d’ailleurs – il faut, là aussi, le déplier, et fouiller dedans.
Il mâche et marche le discours autour des Émigrants en se laissant porter par ses impulsions, avec une grande curiosité et beaucoup de joie, comme s’il allait chercher tous les possibles – pas forcément pour les jouer – mais pour nous remplir d’images dont il attend que nous les remâchions, les intégrions et nous inscrivions dedans.
Cela crée une sorte de précipitation, comme on dit en chimie – des vibrations. L’air devient plus dense.
J’ai rencontré un metteur en scène qui m’emmène ailleurs, vraiment, qui ouvre quelque chose en moi. Après presque 50 ans de carrière, je suis heureux de vivre ça. J’en sors comme agrandi.
MANUEL VALLADE (PAUL BEREYTER)
Son approche des Émigrants est étrangement très physique, alors même que nous avons passé des semaines assis autour de la table. Lorsqu’une idée surgit, sa joie est palpable et s’exprime physiquement– il a l’œil qui frise, il rougit, indiquant que quelque chose vibre là, à cet instant, qu’une piste intéressante à creuser ensemble vient d’émerger de son imaginaire toujours en mouvement.
Ce travail nous emmène vers des zones inexplorées pour créer d’abord un paysage intérieur d’où naissent non des personnages, mais des situations, des rapports, des états. Ensuite seulement surgit la parole, dans le creux de laquelle se dessine alors un personnage fait surtout de ce qu’il ne peut pas dire, de tous ces mots qui, comme dans la vie, sont empêchés.
Lupa a un rêve, d’une puissance extraordinaire, et nous fait confiance pour le réaliser à partir de qui nous sommes, de la façon dont nous allons nous l’approprier et le faire vivre.
Notre imaginaire s’ouvre et il nous incombe de le maintenir en mouvement, pour que jamais il ne se fige – c’est en cela que ce travail est physique, au sens de sensible, organique, et très concret.
MÉLODIE RICHARD (HELEN)
Le travail avec Krystian Lupa agit comme une drogue, clairement. Une drogue qu’il nous apprend à fabriquer nous-mêmes. Si on a déjà en soi un désir d’intensité, une propension à l’amour fou, travailler avec lui est un cadeau, parce qu’il nous donne la possibilité d’être en permanence dans cet état d’amour fou, pas pour lui – il garde une grande distance avec nous – mais pour le mystère dans lequel il nous plonge.
Il nous fait goûter à cette drogue, nous emporte dans son tourbillon, mais c'est une initiation pour nous permettre d’être autonomes, et d’ouvrir notre propre laboratoire clandestin.
MONICA BUDDE (LUCY LANDAU)
Je pourrais répondre que je ne sais pas comment ça agit, ce qui serait une réponse juste. Mais ça agit évidemment. Incroyablement. Comme si Krystian Lupa nous demandait de faire pousser un arbre, très grand, en creusant d’abord un trou, très profond – Krystian n’a pas peur des abîmes – et on crée des racines aussi étendues que l’arbre est haut. Le tronc surgit, des branches apparaissent, et le rêve serait que le spectateur puisse percevoir le frémissement du vent dans les feuilles.
Georges Büchner, dans Woyzeck, dit : « chaque être humain est un abîme, on a le vertige quand on le regarde ». Krystian regarde dans cet abîme. Et c’est très joyeux. En physique quantique, on sait que le regard qu’on porte sur la chose non seulement l’influence mais possiblement la crée. D’une certaine manière, Krystian Lupa fait cela, exactement – du théâtre quantique.
LAURENCE ROCHAIX (TANTE FINI)
Je me sens remplie d’une nourriture qu’il me faut digérer et qui me fait grandir. On avance sur des sables mouvants, comme sur le fil du rasoir, sans bien savoir où l’on va, en faisant confiance au processus, en essayant de rester en équilibre sur cette crête et ne pas tomber du mauvais côté.
J’y pense tout le temps, au réveil, dans la journée, je vis avec ce projet, je m’abandonne à cet univers, avec beaucoup d’humilité et de plaisir.
PIERRE-FRANÇOIS GAREL (AMBROS JEUNE)
Krystian Lupa nous invite à faire comme lui : déverser notre inconscient de notre tête, notre cœur, notre corps, pour l’offrir à son oreille à lui et à celle de nos partenaires au plateau.
Il active en lui un état animal d’où surgissent des intuitions créatives, et nous contamine, nous fait accéder à un état où tout ce qui nous entoure, partout, tout le temps, ouvre notre imaginaire. Comme si nous n’avions plus qu’à nous baisser, à cueillir ce que nous sentons et le faire vibrionner.
Alors, d’un seul coup, on s’offre, comme les enfants qu’on a été, avec la possibilité de rêver follement.
JACQUES MICHEL (AMBROS VIEUX ET KASIMIR)
C’est une expérience unique, jamais je n’ai travaillé de cette façon, jamais je n’ai été à quinze jours d’une première en ne sachant pas vraiment ce qui va se passer au plateau.
Une expérience d’autant plus unique que Lupa ne parle ni français, ni anglais – bien qu’il en comprenne plus que ce qu’il laisse entendre. II a lu Sebald en polonais alors que nous l’avons lu en français – deux traductions différentes depuis l’allemand, langue originale du texte. Il écrit les scènes du spectacle en polonais, qui sont ensuite traduites en français. Il y a là comme une mise en abyme.
Je n’ai donc pas mes repères habituels – ceux du texte et de la langue – mais des clefs formidables pour construire le « paysage intérieur » que Lupa cherche. Il m’a parlé d’Ambros comme d’une figure de la souffrance, un personnage qui porte le stigmate profond de l’homosexualité, un homme au soir de la vie qui sait qu’il n’a plus le temps, qu’il ne pourra pas réparer et que les blessures demeurent.
Ces pensées produisent un écho en moi. Elles font remonter les pleurs, les chagrins, les peines, les morts, les insatisfactions – tout ce qui sommeille en chacun de nous. Et ça me bouleverse.
PHILIPPE VUILLEUMIER (LE DR ABRAMSKY)
J’ai le sentiment que tout ce que j’entends agit au niveau de mes cellules, comme si elles étaient pleines d’atmosphères, de sensations, de situations. A chaque instant, les détails qui m’entourent créent des échos en moi, dans un état de pleine conscience, comme en suspens.
Je n’ai répété qu’une seule fois sur le plateau pour l’instant, mais je me sens en confiance, comme porté par tout ce que j’ai entendu, au point que si on me disait maintenant, Philippe, ce soir on joue, je n’aurais pas peur.
Lupa me met en contact avec les ruines qui se trouvent sur scène. Ce sont ces ruines qui parlent à travers moi, ce n’est pas moi qui parle devant les ruines. Je suis le porte-parole, le porte-paysage de ces ruines. Une sorte de medium
C’est une expérience magnifique.
AURÉLIEN GSCHWIND (COSMO)
Krystian Lupa nous livre son propre monologue intérieur et parle la langue des personnages. Il nous transmet son désir, qui commence à s’incarner lorsque notre propre vie vient se déposer sur son imaginaire à lui
A l’inverse du processus habituel, dans lequel on travaille les scènes encore et encore, Lupa repousse le moment du plateau comme pour le préserver et le rendre encore plus précieux et magique. Cela crée une tension, à la fois une frustration et une énergie, un désir qui n’est jamais désamorcé par le fait de refaire, et qui reste très vivant.
J’ai l’impression que la liberté va naître de ce « grand maintenant », comme il dit, qu’est la représentation. Comme si nous étions en train de préparer une improvisation magistrale qui aura lieu le soir de la première.
PHOTO Natan Berkowicz
/https%3A%2F%2Fi.vimeocdn.com%2Fvideo%2F909333254-991b2694332e1ec6498d00334dcb09dbd114db9693c5a128982fc45be1e63490-d_1280)
Krystian Lupa Les acteurs et leur rêve
"KRYSTIAN LUPA, LES ACTEURS ET LEUR RÊVE" CONCEPTION Agnieszka Zgieb RÉALISATION Denis Guéguin MUSIQUE Bogumił Misala DESSINS Krystian Lupa Lors du confinement, en avril et en mai 2020, les ...
"KRYSTIAN LUPA, LES ACTEURS ET LEUR RÊVE" CONCEPTION Agnieszka Zgieb RÉALISATION Denis Guéguin MUSIQUE Bogumił Misala DESSINS Krystian Lupa Lors du confinement, en avril et en mai 2020, les comédiens français en collaboration avec les acteurs polonais, ainsi que le vidéaste Denis Guéguin ont participé au défi lancé par Agnieszka Zgieb. Durée du film, composé de 20 formes brèves : 48 minutes / Format : smartphone Film réalisé par le vidéaste Denis Guéguin avec la participation des acteurs à l’aide de leurs smartphones pour le son et l’image, basé sur les extraits du livre d’Agnieszka Zgieb "Krystian Lupa, les acteurs et leur rêve", A travers les témoignages intimes du metteur en scène polonais et de ses acteurs, ce film propose un voyage unique à travers son univers théâtral et graphique. Tous les textes sont issus du livre "Krystian Lupa, les acteurs et leur rêve". deuxiemeepoque.fr/index.php?id_product=38&controller=product&id_lang=3 Tous les dessins sont issus de l’ouvrage "Krystian Lupa". deuxiemeepoque.fr/index.php?id_product=24&controller=product&id_lang=3 Avec par ordre d’apparition : Laurent Ziserman, Bénédicte Cerutti, Thierry Bosc, Bénédicte Choisnet, Marta Zięba, Mina Kavani, Vincent Ozanon, Victoire Du Bois, Irina Solano, Sandra Korzeniak, Aline Le Berre, Clara Ponsot, Frédéric Pellegeay, Maja Milewska, Bernard Vergne, Adam Szczyszczaj, Krystian Lupa, Andrzej Kłak, Mélodie Richard, Mathurin Voltz, Magdalena Malina, Marc Susini, Wojciech Ziemiański, Anne Sée, Matthieu Sampeur, l’équipe artistique du spectacle « Capri l’ile des fugitifs », Agnieszka Zgieb, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Michał Czachor, Andrzej Kłak, Vova Makovskyi, Paweł Tomaszewski, Julian Świeżewski. Copyright Agnieszka Zgieb ⸺ Denis Guéguin 2020
Chères toutes et chers tous,
Je vous informe que le livre Imagine de Krystian Lupa que j’ai dirigé et traduit sort aujourd’hui de chez l’imprimeur !
À partir des paroles de la célèbre chanson de John Lennon qui fut, pour la génération hippie, comme un nouvel évangile porteur de la promesse d’un monde différent — soit une humanité sans guerres ni frontières, sans haine, sans religion — Krystian Lupa et ses acteurs donnent à penser quant à la viabilité de l’utopie, sur une planète où la spiritualité a été commercialisée ou dévoyée en politiques identitaires, où les valeurs humanistes, les droits de l’homme, l’égalité et la liberté individuelle sont sans cesse bafoués, et où l’omniprésence de la destruction semble s’être substituée à l’idée même d’un développement positif de l’être humain.
Imagine nous convie à un surprenant voyage intime au sein du labyrinthe intérieur de l’être humain, et interroge, en nous, les aspirations utopiques à un monde plus libre, à une humanité meilleure.
La RTS a eu connaissance d'un document de neuf pages rédigé par l'équipe technique de La Comédie qui revient sur les faits concernant la création du spectacle "Les Emigrants" de Krystian Lupa et dont le déroulement s’étale de mars à mai 2023.
En voici quelques extraits:
"M. Lupa demande un micro pour s’exprimer, afin d’appareiller sa voix très puissante, compréhensible en tout point de la salle, dans laquelle il règne un silence absolu lorsqu’il parle. Sa voix rempli l’espace à un niveau très fort pendant toute la durée de la répétition, et il nous est refusé d’en baisser le niveau. M. Lupa s’exprimant en polonais, un deuxième micro est fourni à la traductrice qui s’efforce de traduire le discours extrêmement prolixe et ininterrompu du metteur en scène, qui la plupart du temps ne prend pas la peine de laisser l’espace nécessaire à la traduction et qui parle par-dessus celle-ci. Il nous devient très difficile de comprendre le discours qui s’énonce au plateau et il est toujours très fatigant à écouter et à transformer en actions claires.
De plus, la traductrice ne possédant pas du tout le langage technique, les maigres informations captées s’avèrent souvent imprécises ou totalement confuses pour tous les corps de métier. Il règne donc une ambiance sonore écrasante où seule la voix de M. Lupa est autorisée. Lors de nos rares interventions, M. Lupa nous coupe la parole et impose toujours le même niveau sonore."
"Les 8 heures de répétitions quotidiennes sont donc, jusqu’à quelques jours de la première (...), constituées de 5 à 7,5 heures de monologue de M. Lupa, entrecoupées de 5 à 20 minutes consécutives maximum de jeu des comédiens."
"A la seconde où le résultat visuel ou sonore diverge de sa vision, M. Lupa interrompt la répétition par des cris de colère et d’indignation, et repart dans une diatribe qui laisse les régisseuses-eurs sidérés et tétanisés."
"M. Lupa n’a jamais assumé sa part de responsabilité dans l’impasse dans laquelle se trouvait la création. Nous subissions son courroux et son dénigrement et régulièrement, il commençait la journée de travail nous menaçant que s’il y avait des erreurs, il annulerait la première, voire le spectacle, puisqu’il était selon lui impossible de travailler ainsi!"
"Que M. Lupa ait une manière totalement à lui de diriger ses comédiennes-iens, c’est son droit le plus strict. Mais nous ne sommes pas des comédiens, nos outils ne sont pas nos corps, nos voix."
"Toutes les créations de M. Lupa mettent les équipes techniques sous une pression énorme. Pour encaisser cette pression, les directions des théâtres ont eu recours à un turn-over des équipes très important. Les régisseurs étaient régulièrement remplacés une fois épuisés, déprimés, voire hospitalisés. Des équipes ont été entièrement remplacées suite à leur refus de continuer, y compris en Pologne.
C’est plutôt la position des directions de théâtre qui a permis, à un prix humain exorbitant, de faire aboutir ces créations. Ces éléments nous ont été relatés par la collaboratrice même et traductrice de longue date de M. Lupa, mais aussi par ses collaborateurs artistiques."
"Nous avons reçu de nombreux témoignages venant de Pologne où 'il est un abuseur connu bien que personne n’ait eu le courage de s’opposer à lui… Mais la communauté du théâtre est au début d’un processus de contre-attaque'..."
Eva Doumbia se coltine à cette affaire, avec une grande honnêteté
(pour moi, JCG, toute réaction renvoie celui qui réagit, qui juge, à lui-même; croyant parler de l'autre, il parle de lui-même; prendre conscience de l'effet-miroir peut contribuer à passer du combat contre ceci ou cela, qu'on croit juste, nécessaire, en acceptation de tout ce qui existe, sans tri, sans jugement)
"J’ai lu ce matin le témoignage des techniciens de la Comédie de Genève concernant la création de Krystian Lupa et ça m’a touchée et déplacée, et surtout attristée. Comme quand on assiste à un conflit entre deux personnes que l’on estime et dont on pensait qu’elles allaient s’entendre. Malgré l’affection et l’admiration que j’éprouve pour ce metteur en scène, je reconnais que les faits qui sont décrits ne sont pas défendables.
En lisant et parce que je connais Lupa et Piotr je pense à ces calques que l’on pose sur des dessins et qui ne correspondent pas.
Cette affaire provoque disputes passionnées parce qu’elle met le doigt sur les relations de pouvoir qu’il faut dénoncer et supprimer au théâtre.
Mais aussi, elle pose la question des affects dans nos métiers. Et c’est très important.
J’ai lu ici et là que si les acteur.ices et la traductrice défendaient Krystian et voulaient aller jusqu’au bout du processus créatif c’est qu’ils et elles étaient sous emprise.
Elle, Agnieska serait comme atteinte du syndrome de Stockholm. Je ne le crois pas.
Au printemps 2003, je suis allée avec d’autres metteurs/ses en scène en formation à Cracovie au Stary Theatr, et j’ai été éblouie. Je reste impressionnée (au sens propre) par ces moments de recherche. Je ne vais pas raconter ici parce que tout a été écrit sur l’univers et la méthode de Lupa. À ce moment-là, et je crois que c’est important, les plus pragmatiques d’entre nous disaient que c’était inapplicable en France car personne chez nous n’avait 8 mois pour faire une création. La démarche créative de Lupa nécessite de sortir du temps compartimenté. J’avais lu quelque part, (je crois chez Thibaudat d’ailleurs), un texte qui parlait de ce que ses spectacles étaient des expérience d’étirement du temps. Peut-être ce n’est pas pour rien si cette histoire se passe au pays des horloges.
Le travail d’entrainement qu’il propose aux interprètes leur permet d’être toujours en improvisation, ouvert.es au moment. Cela a quelque chose du rituel et nécessite un guide. Comme dans les cérémonies.
Sans doute, peut-être, Krystian et Piotr ont été méprisants, et ils n’ont pas calculé le temps et la présence de ceux qui n’étaient pas acteur.ices. C'est une faute que de ne pas embarquer l'ensemble de l'équipe de création. Cela doit changer.
Moi, je n’ai pas souvenir d’avoir vu en 2003 un tyran maltraitant les techniciens et les interprètes, mais peut-être j’étais aveuglée. Ce dont je me souviens, c’est d’avoir été embarquée dans un monde poétique, infiniment littéraire, d’une grande spiritualité et surtout qui posait chaque jour la question qui pour moi est la plus essentielle au théâtre : qu’est ce que c’est qu’être humain ? Cette idée du corps rêvant, du fou intérieur. Quelque chose de la transe qui m’était familier.
Il y avait déjà des gens, acteur.ices, certains de ses élèves polonais qui étaient réfractaires et le disaient manipulateur. (D’ailleurs, il l’a évoqué dans Le Monde ou Libé et dit que mortifié, il en a pris acte.)
Moi j’ai aimé vivre ce moment.
C’était il y a 20 ans, je n’étais pas « gourou-isable ». Je ne l’ai jamais été. Même si je parle de rituel. C’était il y a 20 ans. On pourrait se dire que sans doute il a changé, qu’il est devenu cette mauvaise personne. Je ne le crois pas. Je veux dire que ce qui est décrit par les techniciens était sans doute là, si les circonstances le faisait émerger. Car je crois que tout est question de circonstances.
D’alchimie.
Parmi les descriptions d’une ambiance merdique, de faits de violence verbale, de tensions permanentes, je sens dans le témoignage de Benjamin Vick, l’ingénieur son qui a écrit, que dès le départ il y a eu rejet de la méthode de création. L’auteur du post parle de monologues incessants qui durent des mois.
Evidemment, si on ne sait pas à quoi ça correspond, on a tous les éléments qui constituent le pire du patriarcat. Un homme d’un certain âge qui monopolise l’espace verbal et physique.
Tout ce que personnellement je ne supporte pas. Contre lequel je me bats.
Là, je sais, parce que j'en ai été témoin, et l'ai vécu qu'il s'agit d'autre chose. De ce guide dont je parle plus haut. C'est pour cette raison que j'ai écrit que le dogmatisme était une très mauvaise chose. Lupa a sans doute perdu pied, mais n'est pas un patriarche tyrannique.
Les technicien.ne.s parlent aussi d’alcool et de cris.
C'est très important.
Car là, vient la question des affects. Cette question des affects dont on parle si peu, qui est si présente pourtant.
Le costumier ivre dont parle le texte des technicien.nes, c’est Piotr, le compagnon de Lupa. C'est un des plus grands acteurs que j'ai jamais vu; C'est aussi une personne attachante. Mais je crois qu'il souffre d'addictions et est bipolaire.
Je crois qu’on connait tous et toutes des artistes, des hommes et des femmes, dans tous les mondes professionnels d’ailleurs qui ne gèrent pas les croisements entre vie affective et travail.
Ça m’est arrivé. Plusieurs fois. Je travaille avec mon conjoint, je dirige mon fils dans Le iench. Je collabore avec mes meilleurs ami.e.s. J’ai travaillé longtemps avec mon frère, dont je porte le deuil depuis 4 ans. Il était bipolaire, alcoolique et toxicomane. Et c’était une belle personne, un artiste doué. Et oui, il lui est arrivé plusieurs fois de venir ivre et défoncé en répétition et oui, ça me tiraillait. Et oui je l’ai souvent protégé. Et je me suis fâchée longtemps avec lui. Puis réconciliée. C’était difficile parce que je l’aimais, essayais de le, de nous sauver. Et ce qui n’était pas acceptable c’était que les collaborateurs/trices assistaient à cela, et souvent n’osaient pas le dire, parce que c’était mon frère. Celui de la metteuse en scène.
Parfois mon compagnon, qui compose les musiques de mes spectacles et moi nous disputons sur des questions artistiques devant le reste de l'équipe, qui assiste à quelque chose d'obscène, parce que le ton dénote une intimité qui ne leur appartient pas. J’en suis désolée, mais je ne regrette rien. C'est aussi la vie. Les erreurs, les éléments auxquels on est soumis, les choix qu'on n'arrive pas à faire.
Mais j’ai aussi été soumise dans le travail à des affects envers des personnes qui m’étaient beaucoup moins proches, parfois j’en ai été dévastée.
On a tous et toutes été, ou on le sera tous et toutes un jour, en contradiction avec nos idéaux parce qu'on aime telle ou telle personne qui se comporte de telle ou telle manière.
Ce que j’écris n’excuse pas les insultes, ni la violences, ni aucun débordement.
D’ailleurs moi, je ne pratique pas la violence dans le travail. Ni nulle part.
Mais je me dis que s’identifier à ceux que l’on dénonce est une manière de lutter contre tout ça, les dominations, la violence.
Tenter de comprendre comment un homme, mon père biologique en est arrivé à me frapper alors que j'étais un bébé m'a permis de survivre à la folie, d'écrire, de créer. Comprendre comment ça marche, en soi, chez soi, le partager pour avancer.
Je suis convaincue que Lupa va apprendre. On peut changer en bien même quand on est très vieux.
Et je finirai ce long post (trop long/moi-même je l’aurais jamais lu jusqu’au bout), je finirai donc avec une conviction sur l’âgisme.
J’ai pas attendu d’être un peu vieille moi-même pour penser qu’il faut respecter les ancien.ne.s. J’apprends à chaque visite de Maryse Condé, et j’ai appris de Lupa, de Marie Claire Doumbia aussi (elle n’est pas aussi vieille). Je prends conseil auprès d’Alain Fourneau des Bernardines quand j'ai un problème de théâtre ou de mes amies plus âgées que moi lorsque j'ai des problèmes dans mon couple.
Ce sont des femmes plus âgées qui m'ont appris à allaiter; et d'autres encore auprès de qui je me confie lorsque je suis angoissée pour la scolarité de mon enfant. J’étais en conflit avec mon père (l'autre, le deuxième) mais il savait répondre à mes interrogations existentielles (croire ou pas en Dieu). La sagesse de mon vieil oncle Sériba me manque à Abidjan, mais j’ai encore celle de Tonton Ladji au Mali. Les livres qui m'accompagnent sont écrits par des personnes nées au début du siècle dernier ou même au 19ème.
J'essaie de transmettre ce que je sais aux élèves que je suis
Nous ne sommes pas des poulpes et c’est tant mieux.
Edward Bond, un autre vieux que j’admire a écrit dans « Olly’s Prison » : « Nous apprenons en vieillissant »." Eva Doumbia
Et parce que l'art, comme l'histoire, n'ont pas le monopole des voies et voix autres, trois liens mettant en avant les voies et voix d'intranquillité de
- Christiane Singer
- Christian Bobin
/idata%2F0246844%2Fimages-blog%2FChristiane-Singer.jpg)
Derniers fragments d'un long voyage de Christiane Singer - Les Cahiers de l'Égaré
Cette note de lecture date du 24 mars 2008 soit un an après le départ à 64 ans d'un cancer de Christiane Singer (1943-2007). Depuis quelques semaines Christiane Singer est revenue dans ma vie. Sans
/https%3A%2F%2Fimages3.noterik.com%2Fdomain%2Feuscreenxl%2Fuser%2Feu_rtbf%2Fvideo%2FEUS_CC5BF3049ED6E2826A47734884A28755%2Fimage.jpg)
Noms de dieux: Christiane Singer
Provider: RTBF, Title: Noms de dieux: Christiane Singer, Title French: Noms de dieux: Christiane Singer, Topic: Religion and belief, Type: VIDEO
https://www.euscreen.eu/item.html?id=EUS_CC5BF3049ED6E2826A47734884A28755
magistrale émission qui pour moi mérite qu'on y revienne souvent
/image%2F0551669%2F20221126%2Fob_b724db_317271206-10220834749914400-2283132921.jpg)
la merveille et l'obscur / Christian Bobin - Blog de Jean-Claude Grosse
documentaire de 2006, rendu public en jannvier 2023 N° d'avril 2023 de la Revue des deux mondes cadeau CHRISTIAN BOBIN (décédé le 22 novembre 2022) Dernière conversation en Saône-et-Loire pro...
https://les4saisons.over-blog.com/2019/07/la-merveille-et-l-obscur/christian-bobin.html
le phallus ? et le néant ?
voilà un article comportant 35 liens
il y aura très peu de lecteurs ouvrant les liens
mais au moins je pose la tentation
les liens en lien avec mes blogs sont sous le signe de Freud et Lacan (ce fut une partie de ma formation universitaire) que tente de déconstruire Sophie Robert
aujourd'hui, je suis sorti de cette matrice ou de ce paradigme
je pense qu'il faut plus recevoir que voir
voir en voyant la lumière qui éclaire par derrière ou sur le côté ou par en dessous...
place au miracle et au mystère de la naissance, de la vie, de la mort, des origines, des chemins, des fins
de la faim sans fin par tous les moyens
à la fin sans faim
mise entre parenthèses des prétendus savoirs
les mondes de chacun, de chaque espèce nous sont opaques et inaccessibles; et sans doute notre propre monde (conscience et inconscient, individuel, transgénérationnel, collectif)
JCG
/http%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FcCXA-gKOO4k%2Fhqdefault.jpg)
Long métrage documentaire classé art et essai, sorti en salles en 2019 Un film documentaire de Sophie ROBERT Bible graphique : Maxime GRIDELET Portraits crayonnés : Alice LAVERTY Musique origina...
le phallus et le néant par Sophie Robert (durée 2 H)
/https%3A%2F%2Fwww.scienceshumaines.com%2Fimages%2Fsciences-humaines-2022-1200.jpg)
Sophie Robert : La psychanalyse doit débattre de l'autisme
En présentant les positions de plusieurs psychanalystes à propos de l'autisme, un documentaire, Le Mur, fait polémique. S'estimant piégés, trois des interviewés ont engagé une action...
------------------------------------
/https%3A%2F%2Fapi-cdn.arte.tv%2Fimg%2Fv2%2Fimage%2FajFMrFfxoH8WwFXrJUXQ56%2F1920x1080%3Ftype%3DTEXT%26watermark%3Dtrue)
Un ange à ma table - Regarder le film complet | ARTE
Née dans un village perdu de Nouvelle-Zélande, Janet Frame est une petite fille timide. Mais elle a un rêve : devenir écrivain... Le film qui a révélé au monde le talent de Jane Campion - et...
https://www.arte.tv/fr/videos/003984-000-A/un-ange-a-ma-table
/https%3A%2F%2Fapi-cdn.arte.tv%2Fimg%2Fv2%2Fimage%2FzT5sc96PoHTVvxhQXAfj99%2F1920x1080%3Ftype%3DTEXT%26watermark%3Dtrue)
Jane Campion - La femme cinéma - Regarder le documentaire complet | ARTE
Par sa consoeur Julie Bertuccelli, un vibrant portrait de la réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion, première femme à avoir obtenu la Palme d'or (pour "La leçon de piano", en 1993). En 1997...
https://www.arte.tv/fr/videos/096284-000-A/jane-campion-la-femme-cinema/
/https%3A%2F%2Fwww.radiofrance.fr%2Fs3%2Fcruiser-production%2F2023%2F03%2F6478d965-71bd-4baa-92c8-990f17bc8429%2F400x400_sc_hysterie.jpg)
Pour LSD, Pauline Chanu part à la recherche des persistances de l'hystérie. Une histoire longue et violente qui commence à l'Antiquité et continue de nourrir la misogynie et de hanter la médec...
4 émissions de 50' chacune
Le scandale de la psychanalyse/Paul Mathis - bric à bracs d'ailleurs et d'ici
DE LA TERREUR OU LE SCANDALE DE LA PSYCHANALYSE Nous vivons, nous sommes dans un monde de terreur. A ce thème proposé par Jean-Claude Grosse, pour envisager de m'en dégager, j'ai eu tendance à ...
Du corps, signifiant premier/Paul Mathis - bric à bracs d'ailleurs et d'ici
Du corps, signifiant premier par Paul Mathis Note: Cet exposé a été présenté lors d'une table ronde (avec performances d'artistes italiens) consacrée au corps, à la Maison des Comoni au ...
Freud/Galilée (1) par Paul Mathis - bric à bracs d'ailleurs et d'ici
FREUD, GALILEE vers d'autres références éthiques En contraste peut-être avec les exposés précédents, je vous inviterai à sortir de notre région pour un voyage vers l'Italie, vers l'Allemag...
Éthique et politique (1) par Paul Mathis - bric à bracs d'ailleurs et d'ici
Éthique et politique " C'est l'histoire vraie de tous les crimes de la famille, à commencer par celui de Grand-Père Abraham... tous les crimes, y compris les nôtres, tu saisis ? " Eugène O'Nei...
/idata%2F0242346%2F%2F67.jpg)
Du double meurtre des sœurs Papin (Lacan, Mathis) - bric à bracs d'ailleurs et d'ici
Du double meurtre commis par les sœurs Papin par Paul Mathis Note: Cet exposé a été présenté lors de la création en mars 1995, à la Maison des Comoni au Revest-les-Eaux, du spectacle : Et p...
À l'écoute de la bêtise/Paul Mathis - bric à bracs d'ailleurs et d'ici
D'autres agoras de Paul Mathis sont disponibles sur ce blog, catégorie: Paul Mathis. À l'écoute de la bêtise Tel est le titre surprenant peut-être qui vous a été donné. Il est issu d'une ...
/image%2F0551669%2F20200711%2Fob_4fd77b_falaises-couv.jpg)
Faire son deuil de quoi ?/Paul Mathis - Blog de Jean-Claude Grosse
PAUL MATHIS FAIRE SON DEUIL DE QUOI ? J'ai aperçu en télévision, ce qui reste des ossements de Pétrarque. Image rapide qui ne m'a pas permis de m'attarder, plus anatomiquement sur ces derniers ...
/idata%2F0002777%2F%2FH85-C.JPG)
L'enfant, son origine, son horizon par Paul Mathis (1) - Blog de Jean-Claude Grosse
L'enfant, son origine, son horizon par Paul Mathis -1- Deux points de mire, le point d'origine et le point d'horizon sont l'objet d'un questionnement implacable posé par l'enfant, auquel l'adulte ne
/idata%2F0002777%2Fcyril%2Fsigmund_freud-loc.jpg)
Freud/Lacan - Blog de Jean-Claude Grosse
samedi 28 novembre 2009 de 14 à 16 H pause philo à la médiathèque d'Hyères : Jacques Lacan, sa conception de l'inconscient par Jean-Claude Grosse et Marie-Paule Candillier, psychanalyste Pour ...
https://les4saisons.over-blog.com/article-freud-lacan-mediatheque-d-hyeres-28-novembre-39882536.html
/idata%2F0002777%2Fcyril%2Fsigmund_freud-loc.jpg)
Sur Freud, Lacan et la psychanalyse/JCG-MPC - Blog de Jean-Claude Grosse
Jacques Lacan, sa conception de l'inconscient par Jean-Claude Grosse et Marie-Paule Candillier, psychanalyste Pour commencer, rappeler la disparition de Lévi-Strauss qui aurait eu 101 ans ce 28 ...
/http%3A%2F%2Ffarm4.static.flickr.com%2F3370%2F3549476848_dd8d00d34a.jpg)
Sur l'analyse (en Lacanie) - Blog de Jean-Claude Grosse
Après la pause philo du 28 novembre 2009 sur la psychanalyse et Lacan à la médiathèque de Hyères 30 personnes se sont retrouvées dans l'auditorium de la médiathèque. La pause philo fut ...
https://les4saisons.over-blog.com/article-sur-l-analyse-en-lacanie-40629299.html
/image%2F0551669%2F20170625%2Fob_401d00_epe2.jpg)
Qu'est-ce qu'une femme ?/L'Autre jouissance/Lol V. Stein - Blog de Jean-Claude Grosse
pour l'amour de l'amour, extases d'après Ernest Pignon Ernest Qu'est-ce qu'être une femme au-delà des semblants, de l'apparence, de la mode ? Freud a découvert en écoutant ses analysantes que ...
https://les4saisons.over-blog.com/qu-est-ce-qu-une-femme-/l-autre-jouissance/lol-v.-stein
/idata%2F0002777%2Fcyril%2FHF.jpg)
Homme, Femme ?/ Mode d'emploi ! - Blog de Jean-Claude Grosse
Patrick Roux, consultant au CPCT-M, interviendra sous le titre : "La princesse du désert". Afin d'introduire le travail de réflexion de cet Après-Midi "Homme, Femme ? Mode d'emploi !", il nous ...
/image%2F0551669%2F20200711%2Fob_e6d0a1_et-l-amour-mon-amour3-1024x876.jpg)
Jacques-Alain Miller: l'amour en questions - Blog de Jean-Claude Grosse
Jacques-Alain Miller: interview à Psychologies Magazine sur la question de l'amour. Remarquablement éclairant. Jean-François Cottes Interview de Jacques - Alain Miller Psychologies Magazine, oct...
/idata%2F0002777%2Fphotos-blog%2F14-03-10--206-.jpg)
Héritons-nous de valises à la naissance ?/JCG-MPC - Blog de Jean-Claude Grosse
Pause-philo: Héritons-nous de valises à la naissance ? La pause-philo du 20 mars 2010 au Comédia à Toulon, consacrée aux valises dont nous héritons à la naissance a été bien suivie, riche ...
/image%2F0551669%2F20200711%2Fob_2f14e6_non-c-est-non.jpg)
Violences intimes/violences collectives/M.P.Candillier - Blog de Jean-Claude Grosse
Violences intimes, violences collectives Selon l'approche analytique Pause philo du 18-02-12 MOULIN DES CONTES d'Hyères Marie-Paule CANDILLIER Guerres, génocides, massacres collectifs sont toujours
/image%2F0551669%2F20200711%2Fob_d9189d_et-le-viol-devint-un-crime.jpg)
Écrire le viol / Rennie Yotova - Blog de Jean-Claude Grosse
couverture et table des matières de Elle s'appelait Agnès Écrire le viol Rennie Yotova Non Lieu 2007 Tentant d'écrire avec une quinzaine d'autres auteurs de théâtre, membres des EAT (écrivai...
https://les4saisons.over-blog.com/article-ecrire-le-viol-rennie-yotova-110603792.html
/image%2F0551669%2F20191112%2Fob_0e634c_agnes-marin-816369.jpg)
Elle s'appelait Agnès, il s'appelle Matthieu - Blog de Jean-Claude Grosse
Agnès Marin, inhumée au Père Lachaise, le jour de ses 14 ans, le 26 novembre 2011, le collège-lycée du Cévenol aujourd'hui fermé, collège des Justes pendant la 2° guerre et 2° chance pour...
https://les4saisons.over-blog.com/2016/02/elle-s-appelait-agnes.html
/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2Fer6-qL9_15w%2Fhqdefault.jpg)
Affaire Duhamel, un si long silence
Pendant des années, tous ceux qui savaient se sont tus... Des histoires de pouvoir, et surtout de silence. Début janvier 2021, c'est la déflagration, même si aujourd'hui, les faits sont en thé...
/image%2F0551669%2F20200711%2Fob_9ae948_ecwe00130034-1.jpg)
Narcissisme et société/Michel Pouquet - Blog de Jean-Claude Grosse
NARCISSISME ET SOCIETE Un psychanalyste ne peut vous rencontrer sans prendre préalablement quelques précautions. Il est nécessaire de vous rappeler ce qu'est un analyste, et pourquoi il s'adress...
Heurs et malheurs de l'idéologie (1)/Michel Pouquet - bric à bracs d'ailleurs et d'ici
sous le regard de l'analyste... HEURS ET MALHEURS DE L'IDEOLOGIE Je précise bien : sous le regard de l'analyste. L'idéologie, d'autres peuvent vous en parler, d'une autre façon que moi, avec des...
/idata%2F0242346%2Fhitlerimage1-1.jpg)
Pathologie des leaders/Michel Pouquet - bric à bracs d'ailleurs et d'ici
Il y a 6 ans, le 16 mai 2001, se tenait une agora à la Maison des Comoni au Revest sur Heurs et malheurs de l'idéologie avec Michel Pouquet. Elle est en ligne dans son intégralité sur ce blog. ...
L'enseignant et le psychanalyste/Michel Pouquet - bric à bracs d'ailleurs et d'ici
L'ENSEIGNANT ET LE PSYCHANALYSTE "il y a trois tâches impossibles : éduquer, gouverner, et psychanalyser" FREUD Je ne saurais trouver mieux pour entamer cette rencontre avec vous, que cette citation
/idata%2F0242346%2F%2FH85-C.JPG)
L'inquiétante puissance des mères (Michel Pouquet) - bric à bracs d'ailleurs et d'ici
L'INQUIÉTANTE PUISSANCE DES MÈRES Partons du commencement... Voyez l'image du petit enfant dans les bras de sa mère, si petit, à côté d'elle ; totalement dépendant, incapable de rien faire p...
/idata%2F0242346%2F%2Fpere-fils.JPG)
L'indispensable place de ce pauvre homme de père (Michel Pouquet) - bric à bracs d'ailleurs et d'ici
L'INDISPENSABLE PLACE DE CE PAUVRE HOMME DE PÈRE... "L'inquiétante puissance des mères", certains parmi vous s'en souviennent peut-être. Les autres vont l'entre-apercevoir, par l'histoire de GE...
/idata%2F0242346%2Fpouquet.jpg)
À quoi sert un père ?/Michel Pouquet - bric à bracs d'ailleurs et d'ici
À quoi sert un père? Après l'agora du 11 janvier 2006 au CDDP de Toulon, Michel Pouquet, un habitué des agoras du Revest, est intervenu à deux reprises, une fois à L'École des Parents à Tou...
/image%2F0555840%2F20170721%2Fob_9dd910_l-amour-est-nu.jpg)
Ce qu'aimer veut dire/Michel Pouquet - bric à bracs d'ailleurs et d'ici
Michel Pouquet, Paul Mathis, Joël Poulain, Philippe Granarolo, quelques-uns des intervenants des 100 agoras organisés à la Maison des Comoni au Revest article repris sur le site site de l'entrai...
/image%2F0555840%2F20200511%2Fob_5f8a93_baiser-de-bonzais.jpg)
Peut-on rencontrer l'autre ?/J.C. Grosse - bric à bracs d'ailleurs et d'ici
le baiser des bonsaïs (un siècle d'acrobaties pour atteindre ce résultat) le baiser comme don, l'épousée La rencontre d'autrui Pour Sartre, autrui n'est pas seulement celui que je vois, il est...
/image%2F0552430%2F20171227%2Fob_58514f_couv-marilyn.jpg)
Cannes 1962 (MM-BB/lettre de Daddy à Norma Jeane)/ JCG - Les Cahiers de l'Égaré
Marilyn après tout, 18F 18H pour les 36 ans de MM au moment de son "suicide" Cannes 1962 La seule fois où je suis allé au Festival de Cannes, c'est en mai 1962. C'était la quinzième édition d...
https://cahiersegare.over-blog.com/2017/12/cannes-1962-mm-bb/lettre-de-daddy-a-norma-jeane/jcg.html
Rencontre avec Joe Black
Rencontre avec Joe Black
3 h à la rencontre de la Mort incarnée en Joe Black
j'avais déjà vu ce film qui m'avait impressionné, il y a deux trois ans; j'avais fait focus sur l'amour entre Susan Parrish et Joe Black
vers 18 H ce 24 décembre 2022, une plage de temps s'est présentée; nous avons donc été 3 à le regarder en home-cinéma (video-projection sur drap blanc) pendant que des cookies au chocolat se préparaient en cuisine, les pâtissiers regardant le film à l'envers comme cela se passe dit-on au moment du passage, nous reverrions à toute vitesse notre film de vie à l'envers
spectateur, j'accepte le film sans esprit critique, vivre cette proposition telle qu'elle est offerte; je ne me laisse pas envahir par clichés, préjugés, genre c'est un film américain avec tous les codes-stéréotypes du genre film romantique-fantastique, musique trop appuyée, scènes convenues, téléphonées, longueurs et dialogues en sourdine sauf rares explosions, valeurs bourgeoises véhiculées...
ce qui m'a retenu dans cette projection, c'est le comportement de la Mort, pas seulement avec Susan mais d'abord avec elle-même qui ne sait rien de la Vie et de l'Amour;
selon Epicure quand la vie est là, la mort n'est pas là; quand la mort est là, la vie n'est plus là; il n'y a donc pas à craindre la mort dont on ne saura jamais rien;
inversement (c'est moi qui produit cet énoncé), la mort ne sait rien de la vie
et c'est cette plongée dans sa découverte de la vie que j'ai trouvé stimulante;
Joe Black goûte, il découvre avec la bouche, comme le nouveau-né, le goût du beurre de cacahuètes, le goût du thé avec un nuage de lait, le goût d'un sandwich à la viande, le goût des lèvres de Susan, c'est un gourmand du stade oral (le contraire du stade anal où l'enfant veut garder pour lui ses déjections, son pipi-caca), un découvreur qui s'émerveille du bon goût de toutes choses goûtées; cette aptitude déconcerte certains puisqu'il semble absent des enjeux de la vie de la famille Parrish; en réalité, chacun se révèle à lui-même au contact de Joe Black (c'est un peu la même chose avec l'ange de Théorême de Pasolini) comme lui se révèle au contact des vivants, il sympathise avec le mari d'Allison, il démolit la taupe qui veut détruire l'empire de Bill Parrish, il renonce à la mort de Susan et lui permet de vivre son amour avec le jeune homme rencontré au café (scène fondatrice méritant bien des développements);
il permet à Bill Parrish de mettre de l'ordre avant de passer et ainsi d'accepter le passage le soir de son anniversaire (65 ans); Bill et Joe tissent entre eux une relation de complicité parfois conflictuelle où la peur n'a plus sa place, Bill sait dire non, se rebiffer, Joe use, abuse un peu de son pouvoir;
ce qui ressort dixit Joe Black, c'est qu'une opinion peut toujours être argumentée de deux façons contraires, que la liberté existe, qu'on a le choix
mais l'essentiel est dit par Bill, une vie sans amour ne vaut pas la peine d'être vécue;
ça la Mort ne peut le dire, elle l'apprend de Bill et de Susan
ce film fut un gros échec au box-office; le directeur des studios Universal Pictures fut licencié
passez un bon Noël, en compagnie du divin enfant, quelles que soient vos croyances et incroyances
complicité parfois conflictuelle entre Joe Black et Bill Parrish / la mort découvre la vie comme le nourrisson, par la bouche, stade oral ou buccal / Là où le psychanalyste tend son oreille, l’hypnotiseur tend sa bouche à la recherche d’une autre bouche qui enfin sort de la plainte.Nous sommes dans le bouche-à-bouche, donc dans la respiration, et non dans un bouche-à-oreille. Nous sommes dans la mélopée amniotique où le sujet reprend des forces, une autre vitalité, une autre disposition. Celui qui revient n’est plus le même. Un ordre s’est reconstruit bien avant la verbalité. Celui qui revient, plus fort, ne sera plus soumis. Thierry Zalic
Une nuit le magnat William Parrish ressent une violente douleur tandis qu'une voix surgissant des tenebres lui annonce sa mort prochaine. A ce moment-là, un jeune inconnu se présente à son domicile pour l'accompagner à son dernier voyage. Ce messager de l'au-delà impose à Parrish de l'heberger chez lui afin de lui donner l'occasion de partager un temps les experiences, les joies, les émotions et les drames des vivants, qui semblent lui être etrangers. En l'espace de trois jours, Joe Black révèlera toute la famille Parrish à elle-même.
- Je sais que ce n'est pas très original... L'amour est passion, obsession... Sa présence est vitale. Je veux dire tombe à la renverse, trouve quelqu'un que tu aimeras à la folie et qui t'aimera de la même manière. Trouver cet homme ? Et bien, laisse de côté ta tête et sois à l'écoute de ton cœur. S'il bat en tout cas je n'entends rien. La vérité ma chérie c'est que sans amour, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Être passé sur cette Terre sans connaître l'amour, le vrai, eh bien, c'est être passé à côté de la vie. Il faut essayer de le trouver, parce que si tu n'as pas essayé, tu n'as pas vécu.
- Bravo.
- Tu es cruelle.
- Excuse-moi. Redis le moi encore mais en version courte cette fois.
- D'accord... Sois prête. Qui sait ? Ça existe les coups de foudre.
la rencontre au café scène fondatrice méritant bien des développements; noter la synchronicité des gestes au moment du café partagé
la rencontre au café et la sortie du café scène fondatrice
la mort, le maître du passage et la vieille dame jamaïquienne qui croit donc aux esprits
le plaisir oral, buccal de Joe Black, découvrir le monde par la bouche / Là où le psychanalyste tend son oreille, l’hypnotiseur tend sa bouche à la recherche d’une autre bouche qui enfin sort de la plainte.Nous sommes dans le bouche-à-bouche, donc dans la respiration, et non dans un bouche-à-oreille. Nous sommes dans la mélopée amniotique où le sujet reprend des forces, une autre vitalité, une autre disposition. Celui qui revient n’est plus le même. Un ordre s’est reconstruit bien avant la verbalité. Celui qui revient, plus fort, ne sera plus soumis. Thierry Zalic
la scène du baiser, toute de retenue et riche de potentialités
Joe Black a renoncé à la mort de Susan et lui permet de vivre son amour avec le jeune homme rencontré au café
/https%3A%2F%2Fexplicationdefilm.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F12%2Fgiphy.gif)
Martin Brest, 1998 La mort a souvent été incarnée comme quelqu'un de sinistre. Une grande faucheuse avec un crâne pour visage, caché par une cape lugubre (cf Monty Python : le sens de la vie)....
https://explicationdefilm.com/2022/12/04/rencontre-avec-joe-black/
Le film agace par ses faiblesses trop voyantes. Il est trop lent (la seule fête finale dure trois quart d'heures, soit un quart du film, alors que son contenu est dramatiquement faible), trop ...
http://pascalide.fr/critique/english-rencontre-avec-joe-black/
Après avoir joué au chat et à la souris avec Bill Parrish en lui parlant sans se montrer ("Ouiii…"), Joe Black se présente enfin et annonce la raison et le but de sa visite : "Depuis peu, vous petites affaires ont piqué mon intérêt. Appelle ça de l'ennui, de la curiosité de ma part. […] Fais-moi visiter. Sois mon guide. […] L'important, c'est que je ne m'ennuie pas."
Joe veut satisfaire ses désirs et ne supporte pas les frustrations. Il a "besoin d'un corps", il le prend. Il manifeste plusieurs fois à William Parrish qu'il est en position dominante ("Cela n'est pas sujet à discussion. Rien ne l'est."), mais contrairement à lui, il exprime cela calmement, sans colère, en énonçant un fait plutôt qu'en se livrant à une épreuve de force. Joe est optimiste : "Dans la vie, il y a toujours des solutions."
Dans le monde des humains, Joe découvre avec ravissement dès le premier soir le moyen d'exercer au sens propre la passion de son type, la gloutonnerie :
|
|
Joe : |
C'est quoi ça ? |
|
|
Maître d'hôtel : |
Ça, vous voulez dire ? |
|
|
Joe : |
Oui. |
|
|
Maître d'hôtel : |
Du beurre de cacahuète, Monsieur. |
|
|
Joe : |
Et vous aimez ça ? |
|
|
Maître d'hôtel : |
Et bien, si vous sollicitez mon opinion, je dirais que c'est à mi-chemin entre la damnation et le paradis. Euh… Vous voulez goûter, Monsieur ? |
|
|
Joe : |
Oui. [Il sourit. C'est la première fois depuis qu'il est sur terre.] |
|
|
Maître d'hôtel : |
Tout de suite. |
|
|
|
[…] |
|
|
Maître d'hôtel : |
Vous voilà dépendant du beurre de cacahuètes, Monsieur. |
|
|
Joe : |
Oui. Je crois bien que oui. Je suis content de connaître le beurre de cacahuètes. |
Le plaisir apporté par le beurre de cacahuètes devient la référence absolue. Quelques instants plus tard, il ne lâche même pas la cuillère pour tendre une serviette à Susan qui sort de la piscine. Il en réclame au repas. Il cherchera à en obtenir à nouveau lors de la réception finale, seule consolation possible à la perte de Susan. Celle-ci d'ailleurs doit affronter la concurrence :
|
|
Susan : |
Tu as aimé faire l'amour avec moi ? |
|
|
Joe : |
Oui. |
|
|
Susan : |
Plus que le beurre de cacahuètes ? |
|
|
Joe : |
Oui. Beaucoup plus. |
Bien entendu, il n'en néglige pas pour autant les autres plaisirs alimentaires. Le sandwich au gigot "est éblouissant". Quant aux réunions du Comité Directeur de Parrish Communication, leur intérêt réside dans les pâtisseries :
|
|
Joe : |
Est-ce que je peux encore avoir de ces délicieux gâteaux ? Ceux à la confiture. Et une tasse de thé… avec un nuage de lait. J'essaye le style anglais. Ouais ! Un thé au lait je vous prie. |
|
|
Drew : |
Ce sera tout, monsieur Black. Un peu d'eau, peut-être ? |
|
|
Joe : |
Oui, avec joie. |
Sa gloutonnerie se manifeste aussi dans ses autres plaisirs. Après que Susan l'ait embrassé pour la première fois, il lui dit : "Vos lèvres sur les miennes, et votre langue… Ça avait un goût vraiment merveilleux."
Bien entendu, du 7 Joe Black a aussi la peur de la souffrance. Il va voir Susan à l'hôpital et elle est surprise de sa venue :
|
|
Susan : |
Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous êtes malade ? |
|
|
Joe : |
Oh ! Dieu merci non ! |
Là, il rencontre une vieille femme jamaïquaine et lui assure : "Je suis désolé. Je n'ai rien à voir avec la douleur." Le spectacle de cette souffrance lui est insupportable et il réalise brusquement que sa "présence [à l'hôpital] n'est pas appropriée" et s'enfuit littéralement. Parce qu'elle souffre, cette femme est le premier être humain pour lequel il ressent une véritable émotion : "C'est quelqu'un qui a très mal." Le soir au dîner, il demande de ses nouvelles : "Je suis très inquiet pour la femme qui est venue vous voir. La douleur s'est-elle calmée ?"
Plus tard, il retourne la voir à l'hôpital et lui amène des fleurs. La vieille femme essaye de le convaincre qu'il n'est "pas à sa place" sur terre. Amoureux et aimé de Susan, il ne veut rien entendre : pourquoi abandonner un plaisir ? La Jamaïquaine perçoit bien ce qu'il y a de puéril dans cette attitude : "C'est plein de gamineries dans ta tête."
Elle lui raconte alors une métaphore, le langage du 7, pour lui faire comprendre que son plaisir va bientôt se changer en souffrance : "C'est joli ce qui a pu t'arriver. Tu sais, c'est comme si tu étais dans les îles en vacances. Le soleil ne te brûle pas rouge-rouge, juste marron, tout doré. Il n'y a pas de moustiques. Mais la vérité, c'est que c'est fatal que ça arrive si tu veux rester trop longtemps. Alors garde les jolies images que t'as dans la tête et retourne chez toi. Mais il faut pas te faire avoir."
Joe change de visage. Il se rend immédiatement chez William Parrish et lui annonce qu'ils vont s'en aller : "J'ai le sentiment que tous comptes faits l'objectif visé par ce voyage est aujourd'hui pleinement atteint." Cette phrase est une rationalisation (le mécanisme de défense du 7) destinée à (se) masquer la raison véritable de son départ.
Plus généralement pour Joe Black, le langage est un outil permettant de justifier n'importe quelle idée : "Quoi que vous disiez, on peut soutenir une opinion de deux façons différentes", explique-t-il à Drew.
Joe pratique volontiers un humour à froid plutôt agressif :
|
|
Bill : |
Vous pensez rester longtemps ? |
|
|
Joe : |
Nous pouvons espérer que ce sera le cas. |
Ou après une colère de Bill : "Du calme, Bill. Tu vas faire une crise cardiaque au beau milieu de mes vacances."
Joe ne sait pas réellement ce qu'est une émotion. Même quand il aime Susan, il est étonnamment froid et distant, plus dans le plaisir que dans l'amour comme le perçoit bien William Parrish :
|
|
Bill : |
Vous prenez ce que vous voulez par simple fantaisie. Ce n'est pas de l'amour. |
|
|
Joe : |
Qu'est-ce que c'est ? |
|
|
Bill : |
[…] Il manque les ingrédients importants. |
|
|
Joe : |
Et quels sont-ils ? |
La fin du film montre un début d'intégration par le renoncement à Susan et en même temps son châtiment : lui qui a joué avec les sentiments des autres et avec leur vie va devoir apprendre à vivre seul… pour l'éternité.
B bbb J / place aux joyeux
/https%3A%2F%2Fwww.radiofrance.fr%2Fs3%2Fcruiser-production%2F2021%2F04%2F92b32528-cb81-4dd4-bcc3-bfba59c98842%2F400x400_le_grand_entretien.jpg)
S'il y a un sale passage après la mort, ce doit être l'entrée du musée de Montpellier. Invité pour une lecture, cueilli à la gare, conduit dans une chambre d'hôtel dont les hautes boiseries ...
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-grand-entretien/christian-bobin-3118673
sur L'Homme-Joie de Christian Bobin, un des joyeux que j'aime lire, écouter et qui me fait rebondir ; l'écriture a à voir avec une guérison
noeuds de Michel Dufresne offert à JCG, vues à 8 H 45 depuis mon poste de travail, le 8 janvier 2023
Αρχαίο κείμενο της Σαπφούς (7ος π. Χ. αιώνας)
Δέδυκε μὲν ἀ Σελάννα καὶ Πληίαδες,
μέσαι δὲ νύκτες,
παρὰ δ’ ἔρχεται ὤρα,
ἔγω δὲ μόνα κατεύδω
Μετάφραση Άκου Δασκαλόπουλου (1937-1998)
Να το φεγγάρι έγειρε,
βασίλεψε και η Πούλια.
Είναι μεσάνυχτα.
Περνά, περνά η ώρα.
Κι εγώ κοιμάμαι μόνη μου.
Μετάφραση Αργύρη Εφταλιώτη (1849-1923)
Το φεγγαράκι εμίσεψε
μεσάνυχτα σημαίνει,
οι ώρες φεύγουν και περνούν
κι εγώ κοιμάμαι μόνη
Texte ancien de Sappho (7e siècle av. J. C.)
Se sont couchées donc la lune et les Pléiades
mais au milieu de la nuit
les heures passent
et moi je dors seule.
Traduction à partir du texte d'Akos Daskalopoulos (1937-1998)
Voici la lune s'est penchée
s'est couchée aussi la Poulia1.
Il est minuit.
Passent, passent les heures.
Et moi je dors seule.
Traduction à partir du texte d'Argyris Eftaliotis (1849-1923)
La petite lune a migré
il se fait minuit
les heures partent et passent
et moi je dors seule.
Le Dhammapadda, chapitre 15
197Ah ! vivons heureux, sans haïr ceux qui nous haïssent ! Au milieu des hommes qui nous haïssent, habitons sans les haïr !
198Ah ! vivons heureux, sans être malades, au milieu de ceux qui le sont ! Au milieu des malades, habitons sans l’être !
199Ah ! vivons heureux, sans avoir de désirs au milieu de ceux qui en ont ! Au milieu des hommes qui ont des désirs, habitons sans en avoir !
200Ah ! vivons heureux, nous qui ne possédons rien ! Nous serons semblables aux dieux Abhâsvaras[1], savourant comme eux le bonheur.
201La victoire engendre la haine, car le vaincu ressent de la douleur. Celui qui vit en paix est heureux, sans plus songer ni à la victoire ni à la défaite.
202Il n’est pas de feu comparable à la passion, de désastre égal à la haine, de malheur tel que l’existence individuelle, de bonheur supérieur à la quiétude.
203La faim est la pire des maladies, les agrégations d’éléments, le plus grand des malheurs. Pour celui qui sait qu’il en est ainsi, le Nirvâna est le bonheur suprême.
204La santé est la meilleure des acquisitions ; le contentement, la meilleure des richesses ; la confiance, le meilleur des parents ; le Nirvâna, le bonheur suprême.
205Après avoir savouré le breuvage de l’isolement, et celui de la quiétude, on ne craint plus rien, on ne pèche plus, et l’on savoure celui de la loi.
206Pleine de charme est la visite aux Aryas, plein de charmes leur commerce. Débarrassé de la vue des sots, on serait à jamais heureux.
207Celui qui marche en compagnie d’un sot souffre tout le long de la route. La société d’un sot est aussi désagréable que celle d’un ennemi ; la société d’un sage, aussi agréable que celle d’un parent.
208Celui qui est un sage, un savant, ayant beaucoup appris, patient comme une bête de somme, et fidèle à ses vœux, un Arya, — ce mortel vertueux, doué d’une heureuse intelligence, suivez-le, comme la lune suit le chemin des étoiles.
Abhâsvara, lumineux, éclatant.
Jésus, à chacun d'imaginer son visage de Jésus qui est le visage de l'amour inconditionnel y compris de ses ennemis, ce qui n'est pas un sentiment naturel; avec Jésus on change de niveau / il y en a qui combattent pour un autre visage du Christ, moins blanc; va-t-on assister à un déferlement wokiste sur comment représenter Jésus ?
A la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. 2 Puis il prit la parole pour les enseigner; il dit:
3 «Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient! 4 Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés! 5 Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre! 6 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés! 7 Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux! 8 Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu! 9 Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu! 10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient! 11 Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toute sorte de mal à cause de moi. 12 Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés.
13 »Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. 14 Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, 15 et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. 16 Que, de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d’agir et qu’ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste.
17 »Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes; je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. 18 En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n’auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. 19 Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux; mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. 20 En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux.
21 »Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens: ‘Tu ne commettras pas de meurtre[a]; celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement.’ 22 Mais moi je vous dis: Tout homme qui se met [sans raison] en colère contre son frère mérite de passer en jugement; celui qui traite son frère d’imbécile[b] mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. 23 Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, 24 laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. 25 Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. 26 Je te le dis en vérité, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime.
27 »Vous avez appris qu'il a été dit: Tu ne commettras pas d'adultère.[c] 28 Mais moi je vous dis: Tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. 29 Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. 30 Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer.
31 »Il a été dit: Que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce.[d] 32 Mais moi, je vous dis: Celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère.
33 »Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens: Tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras ce que tu as promis au Seigneur.[e] 34 Mais moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, 35 ni par la terre, parce que c'est son marchepied,[f] ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. 36 Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu. 37 Que votre parole soit ‘oui’ pour oui, ‘non’ pour non; ce qu'on y ajoute vient du mal[g].
38 »Vous avez appris qu'il a été dit: Œil pour œil et dent pour dent.[h] 39 Mais moi je vous dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. 40 Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. 41 Si quelqu'un te force à faire un kilomètre, fais-en deux avec lui. 42 Donne à celui qui t’adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt.
43 »Vous avez appris qu'il a été dit: ‘Tu aimeras ton prochain[i] et tu détesteras ton ennemi.’ 44 Mais moi je vous dis: Aimez vos ennemis, [bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent] et priez pour ceux [qui vous maltraitent et] qui vous persécutent, 45 afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. 46 Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d’impôts n'agissent-ils pas de même? 47 Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? 48 Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait.
6 »Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu’ils vous regardent; sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. 2 Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. 3 Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, 4 afin que ton don se fasse en secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra [lui-même ouvertement].
5 »Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites: ils aiment prier debout dans les synagogues et aux coins des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. 6 Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra [ouvertement].
7 »En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples: ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles ils seront exaucés. 8 Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez.
9 »Voici donc comment vous devez prier: ‘Notre Père céleste! Que la sainteté de ton nom soit respectée, 10 que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 11 Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien; 12 pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés; 13 ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal[j], [car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen!]’
14 »Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi; 15 mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes.
16 »Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. 17 Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage 18 afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.
19 »Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mites et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler, 20 mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mites et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler! 21 En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.
22 »L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé; 23 mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes!
24 »Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l’argent[k].
25 »C'est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez [et boirez] pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? 26 Regardez les oiseaux du ciel: ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? 27 Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? 28 Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement? Etudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs: elles ne travaillent pas et ne tissent pas; 29 cependant je vous dis que Salomon[l] lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d’aussi belles tenues que l'une d'elles. 30 Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? 31 Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas: ‘Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous?’ 32 En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. 33 Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. 34 Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine.
7 »Ne jugez pas afin de ne pas être jugés, 2 car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servis. 3 Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? 4 Ou comment peux-tu dire à ton frère: ‘Laisse-moi enlever la paille de ton œil’, alors que toi, tu as une poutre dans le tien? 5 Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère.
6 »Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent pour vous déchirer.
7 »Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. 8 En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. 9 Qui parmi vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? 10 Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? 11 Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d’autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent.
12 »Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes[m].
13 »Entrez par la porte étroite! En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là, 14 mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent.
15 »Méfiez-vous des prétendus prophètes! Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups voraces. 16 Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? 17 Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. 18 Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. 19 Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. 20 C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.
21 »Ceux qui me disent: ‘Seigneur, Seigneur!’ n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. 22 Beaucoup me diront ce jour-là: ‘Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom?’ 23 Alors je leur dirai ouvertement: ‘Je ne vous ai jamais connus. Eloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal![n]’
24 »C'est pourquoi, toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. 25 La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison; elle ne s’est pas écroulée, parce qu'elle était fondée sur le rocher. 26 Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. 27 La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison; elle s’est écroulée et sa ruine a été grande.»
28 Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, 29 car il enseignait avec autorité, et non comme leurs spécialistes de la loi.
Très Haut, tout puissant et bon Seigneur,
à toi louange, gloire, honneur,
à toi seul ils conviennent, O Très-Haut,
et nul homme n’est digne de te nommer.
Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures,
spécialement messire frère Soleil,
par qui tu nous donnes le jour, la lumière ;
il est beau, rayonnant d’une grande splendeur,
et de toi, le Très Haut, il nous offre le symbole.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les étoiles :
dans le ciel tu les as formées,
claires, précieuses et belles.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent,
et pour l’air et pour les nuages,
pour l’azur calme et tous les temps :
grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures.
Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur Eau,
qui est très utile et très humble,
précieuse et chaste.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Feu,
par qui tu éclaires la nuit :
il est beau et joyeux,
indomptable et fort.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre,
qui nous porte et nous nourrit,
qui produit la diversité des fruits,
avec les fleurs diaprées et les herbes.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux
qui pardonnent par amour pour toi ;
qui supportent épreuves et maladies :
heureux s’ils conservent la paix,
car par toi, le Très Haut, ils seront couronnés.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour notre sœur la Mort corporelle
à qui nul homme vivant ne peut échapper.
Malheur à ceux qui meurent en péché mortel ;
heureux ceux qu’elle surprendra faisant ta volonté,
car la seconde mort ne pourra leur nuire.
Louez et bénissez mon Seigneur,
rendez-lui grâce et servez-le
en toute humilité.
/image%2F0551669%2F20200719%2Fob_e30811_350px-giotto-legend-of-st-francis.jpg)
François d'Assise / Bobin / Delteil - Blog de Jean-Claude Grosse
en chemin une fontaine-source sur la route de Léca à Corsavy, comme un autel naturel, comme un temple naturel, lieu à contempler, source pour se désaltérer sachant que toute contemplation ne ...
https://les4saisons.over-blog.com/2019/08/francois-d-assise/bobin/delteil.html
PROLOGUE de Gargantua de François Rabelais, 1534
Buveurs très illustres, et vous vérolés très précieux, car c'est à vous, non aux autres, que je
dédie mes écrits, Alcibiade, dans un dialogue de intitulé le Banquet, faisant l'éloge de son
précepteur Socrate, sans conteste le prince des philosophes, déclare entre autres choses
qu'il est semblable aux silènes. Les Silènes étaient jadis de petites boites, comme
celles que nous voyons à présent dans les boutiques des apothicaires, sur
lesquelles étaient peintes des figures drôles et frivoles : harpies, satyres, oisons
bridés, lièvres cornus, canes batées, boucs volants, cerfs attelés, et autres figures
contrefaites à plaisir pour inciter les gens à rire (comme le fut Silène, maitre du
Bacchus). Mais à l'intérieur on conservait les drogues fines, comme le baume,
l'ambre gris, l'amome, la civette, les pierreries et autres choses de prix. Alcibiade
disait que Socrate leur était semblable, parce qu'à le voir du dehors et à l'évaluer par
l'aspect extérieur, vous n'en auriez pas donné une pelure l'oignon, tant il était laid de corps
et d'un maintien ridicule, le nez pointu, le regard d'un taureau, le visage d'un fou, le
comportement simple, les vêtements d'un paysan, de condition modeste, malheureux avec
les femmes, inapte à toute fonction dans l'état ; et toujours riant, trinquant avec chacun,
toujours se moquant, toujours cachant son divin savoir. Mais en ouvrant cette boite, vous y
auriez trouvé une céleste et inappréciable drogue : une intelligence plus qu'humaine, une
force d'âme merveilleuse, un courage invincible, une sobriété sans égale, une égalité
d'âme sans faille, une assurance parfaite, un détachement incroyable à l'égard de tout ce
pour quoi les humains veillent, courent, travaillent, naviguent et bataillent.
A quoi tend, à votre avis, ce prélude et coup d'essai ? C'est que vous, mes bons disciples,
et quelques autres fous oisifs, en lisant les joyeux titres de quelques livres de votre
invention, comme Gargantua, Pantagruel, Fesse pinte. La dignité des braguettes, des pois
au lard avec commentaire, etc., vous pensez trop facilement qu'on n'y traite que de
moqueries, folâtreries et joyeux mensonges, puisque l'enseigne extérieure est sans
chercher plus loin, habituellement reçue comme moquerie et plaisanterie. Mais il ne faut
pas considérer si légèrement les oeuvres des hommes. Car vous-mêmes vous dites que
l'habit ne fait pas le moine, et tel est vêtu d'un froc qui au-dedans n'est rien moins que
moine, et tel est vêtu d'une cape espagnole qui, dans son courage, n'a rien à voir avec
l'Espagne. C'est pourquoi il faut ouvrir le livre et soigneusement peser ce qui y est
traité. Alors vous reconnaitrez que la drogue qui y est contenue est d'une tout autre valeur
que ne le promettait la boite : c'est-à-dire que les matières ici traitées ne sont pas si
folâtre que le titre le prétendait.
Marcel Proust Céleste Albaret Céleste Albaret racontant avec joie, la joie de Marcel Proust lui annonçant qu'il a écrit le mot FIN au bas de tous les feuillets qu'elle avait eu l'ingéniosité de coller, plier... au service de Marcel Proust de 1913 à 1922
« Il y avait déjà bien des années que, de Combray, tout ce qui n'était pas le théâtre et le drame de mon coucher, n'existait plus pour moi, quand un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusai d'abord et, je ne sais pourquoi, me ravisai. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelés Petites Madeleines qui semblent avoir été moulés dans la valve rainurée d'une coquille de Saint- Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portai à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse: ou plutôt cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie? Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle le dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature. D'où venait- elle? Que signifiait-elle? Où l'appréhender? (...)
Et tout d'un coup le souvenir m'est apparu. Ce goût c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray (parce que ce jour-là je ne sortais pas avant l'heure de la messe), quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté; peut-être parce que, en ayant souvent aperçu depuis, sans en manger, sur les tablettes des pâtissiers, leur image avait quitté ces jours de Combray pour se lier à d'autres plus récents; peut-être parce que de ces souvenirs abandonnés si longtemps hors de la mémoire, rien ne survivait, tout s'était désagrégé; les formes - et celle aussi du petit coquillage de pâtisserie, si grassement sensuel, sous son plissage sévère et dévot - s'étaient abolies, ou, ensommeillées, avaient perdu la force d'expansion qui leur eût permis de rejoindre la conscience. Mais, quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seules, plus frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur gouttelette presque impalpable, l'édifice immense du souvenir.
Et dès que j'eus reconnu le goût du morceau de madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante (quoique je ne susse pas encore et dusse remettre à bien plus tard de découvrir pourquoi ce souvenir me rendait si heureux), aussitôt la vieille maison grise sur la rue, où était sa chambre, vint comme un décor de théâtre s'appliquer au petit pavillon, donnant sur le jardin, qu'on avait construit pour mes parents sur ses derrières (ce pan tronqué que seul j'avais revu jusque là) ; et avec la maison, la ville, depuis le matin jusqu'au soir et par tous les temps, la Place où on m'envoyait avant déjeuner, les rues où j'allais faire des courses, les chemins qu'on prenait si le temps était beau. Et comme dans ce jeu où les Japonais s'amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d'eau, de petits morceaux de papier jusque-là indistincts qui, à peine y sont-ils plongés s'étirent, se contournent, se colorent, se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables, de même maintenant toutes les fleurs de notre jardin et celles du parc de M. Swann, et les nymphéas de la Vivonne, et les bonnes gens du village et leurs petits logis et l'église et tout Combray et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité, est sorti, ville et jardins, de ma tasse de thé. »
PROUST Marcel, Du côté de chez Swann, GF Flammarion, Paris, 1987, p. 140-145
Le personnage d'Albertine dans A la recherche du temps perdu
Yves Tanguy / Joseph Delteil / Georges Brassens / Agnès Varda / Christian Bobin / Jean-Yves Leloup / Thierry Zalic / Issâ Padovani
/image%2F0551669%2F20190821%2Fob_28aa4c_h-3000-delteil-joseph-la-deltheillerie.jpg)
La Deltheillerie - Blog de Jean-Claude Grosse
La Deltheillerie Hyacinthe Tranquillin Joseph Delteil Grasset 1968 Une journée grise et fraîche, pluie en attente, ce n'est apparement pas le temps qui convient pour lire La Deltheillerie, livre ...
https://les4saisons.over-blog.com/2019/08/la-deltheillerie.html
/image%2F0551669%2F20221126%2Fob_b724db_317271206-10220834749914400-2283132921.jpg)
la merveille et l'obscur / Christian Bobin - Blog de Jean-Claude Grosse
un envol d'âme-d'ange et l'ange en surplomb sans qu'on s'en aperçoive sauf à lever la tête via a.b., Annie Bergougnous / aujourd'hui 25 novembre - délibérément en voyant l'ombre portée de l...
https://les4saisons.over-blog.com/2019/07/la-merveille-et-l-obscur/christian-bobin.html
l'homme-joie
écoutez le rire de Christian Bobin vers 47-49', voir c'est répondre, écouter c'est aussi répondre...
/image%2F0551669%2F20190725%2Fob_3d1b78_41yrawvha2l.jpg)
l'enseignement de Jean-Yves Leloup - Blog de Jean-Claude Grosse
L'assise et la marche sont deux postures complémentaires face à la vie. Méditer, pour ne pas se laisser disperser, mais rester au contraire en connexion avec soi-même. Marcher, pour ne pas rest...
https://les4saisons.over-blog.com/2019/07/l-enseignement-de-jean-yves-leloup.html
/image%2F0551669%2F20190601%2Fob_415c6f_l-absurde-et-la-grace.jpg)
L'absurde et la grâce/Jean-Yves Leloup - Blog de Jean-Claude Grosse
quelques livres de Jean-Yves leloup magnifique transmission d'une méditation en 7 temps L'absurde et la grâce Jean-Yves Leloup Albin Michel 1991 J'ai fini L'absurde et la grâce (1991, trouvé pa...
https://les4saisons.over-blog.com/2019/06/l-absurde-et-la-grace/jean-yves-leloup.html
/image%2F0551669%2F20200713%2Fob_2e3b21_ob-a7adfa-71ux-qusoyl.jpg)
Hypnose quantique / Thierry Zalic - Blog de Jean-Claude Grosse
Hypnose quantique livre I : le choix d'être bien ou pas Thierry Zalic TZP éditions 2015 A force de lire des messages succulents, excellents, intrigants, déstabilisants de Thierry Zalic sur FB, j'ai
https://les4saisons.over-blog.com/2020/07/hypnose-quantique/thierry-zalic.html
Bienvenue sur la chaîne Au coeur du Vivant, qui diffuse les vidéos d'Issâ Padovani, conférencier, auteur, formateur en Communication NonViolente®, enseignant en Onsei-Do® et Facilitateur cert...
/image%2F0551669%2F20230101%2Fob_5475c1_sablier.jpg)
Voeux anciens conjugués au présent - Blog de Jean-Claude Grosse
sous le sapin, de Noël au 1° de l'an, découverte à l'unité ou par paire / les petites boites qui contiennent tant, tant d'amour et d'habileté, tant de sagesse, tout fabrication main et maison...
voeux anciens conjugués au présent
jeu heureux sur la plage / heureux à corps ça vit / le baiser à Avers sur les eaux / Katia / Cyril / Katia / Cyril Roméo / Rosalie et la mésange
à Lisbonne en conversation avec Fernando Pessoa et ses hétéronymes qui lui dit
"Je ne suis pas pressé. Pressé pour quoi ?
La lune et le soleil ne sont pas pressés : ils sont exacts.
Être pressé, c’est croire que l’on passe devant ses jambes
Ou bien qu’en s’élançant on passe par-dessus son ombre.
Non, je ne suis pas pressé.
Si je tends le bras, j’arrive exactement là où mon bras arrive.
Pas même un centimètre de plus.
Je touche là où je touche, non là où je pense.
Je ne peux m’asseoir que là où je suis.
Et cela fait rire comme toutes les vérités absolument véritables,
Mais ce qui fait rire pour de bon c’est que nous autres nous pensons toujours à autre chose
Et sommes en vadrouille loin d’un corps."
Annie Le Quesnoy 1966 / Avers sur les eaux 25/12/2020 à 00H 00 = naissance de Vita Nova / Rosalie et Katia / Rosalie par Hélène Théret / en conversation avec Pessoa à Lisbonne en août 2022 / Dieu est amour au Christ-Roi à Lisbonne / par la fenêtre du peintre Michel Dufresne / Voeux du peintre JP Grosse
/image%2F0551669%2F20220728%2Fob_d02b23_osons.jpg)
Emmanuelle, nous et moi (nos émois)/J.C.Grosse - Blog de Jean-Claude Grosse
tu as eu une correspondance heureuse avec Emmanuelle Arsan pendant 17 ans, du 19 mars 1988 au 31 mars 2005 tu as édité cette correspondance dans Bonheur et Bonheur 2 après la disparition ...
Bonheur et Bonheur 2, correspondance heureuse entre Emmanuelle Arsan et JCG / la métamorphose de J.C. en Vita Nova le 25/12/2020 à 00H 00
Une histoire de la vraie vie : que faire de l'institution culturelle ?
une "occupation" de 15 jours, révélatrice de fractures idéologiques, de divergences sur les revendications comme sur les formes d'action
L’occupation des théâtres en ce printemps 2021, aussi peu mordante soit-elle vis-à-vis de l’institution, a permis d’ouvrir ces lieux à des débats inédits et une certaine forme d’offensive politique. À Toulon, la récré aura duré moins de deux semaines avant que la préfecture ne renvoie tout le monde à la maison. L’administration du Liberté, avec qui les occupant-e-s n’ont jamais noué des relations de franche camaraderie, est peut-être soulagée. Mais cette assignation à la torpeur réjouit surtout les forces réactionnaires.
Mars 2021. Un collectif s’invite dans le hall du théâtre le Liberté, à Toulon, avec l’approbation circonspecte du directeur Charles Berling. Le mouvement a débuté au théâtre parisien de l’Odéon au début du mois et, depuis, irradie l’Hexagone. Envie de se faire entendre et de faire société. L’occupation du Liberté, épicentre culturel du Var, est stratégique autant que symbolique. Les revendications portent sur la précarité accrue des intermittent-e-s de l’emploi et des privé-e-s d’emploi en général. On exige l’abandon de la réforme de l’assurance chômage et la prolongation de l’année blanche. Faut-il en douter ? Le collectif plaide aussi en faveur de la réouverture de lieux culturels qui restent fermés, pour de nébuleuses raisons, depuis bien trop longtemps.
Dès le premier jour, Charles Berling estime au micro de France 3 que les revendications du collectif sont peut-être «un peu trop larges», et que «politiquement, ce n’est pas forcément une stratégie audible.» Lui se bat, depuis l’automne, pour la réouverture des lieux de culture.
Après une semaine, le collectif d’occupation publie sur Facebook un communiqué virulent, en réaction à une instrumentalisation maladresse de l’administration du théâtre qui, décidément, a bien du mal avec l’extension du domaine de la lutte, puisqu’elle vient d’envoyer une newsletter à ses abonné-e-s réduisant les revendications du collectif à la seule portion qui l’intéresse.
Le texte vengeur ironise sur les missions du Liberté. Les réactions sont vives, souvent indignées. Des artistes, technicien-ne-s, spectateurs-trices se désolidarisent d’un mouvement d’occupation qu’ils-elles n’avaient pas rejoint. L’équipe du Liberté s’estime outragée. On parle de poujadisme. On regrette une division qui ferait le jeu des méchants.
«Le théâtre Liberté est un temple de la culture bourgeoise», affirme le communiqué. La formule ne passe pas. On rejette l’adjectivation du mot culture. Ainsi cette réaction, fort applaudie : «Aujourd’hui il ne s’agit plus de dire ou d’écrire que certains lieux de culture sont bourgeois ou populaires et au final de créer des oppositions là où elles n’ont pas lieu d’être. La culture n’a pas plusieurs vitesses, elle n’a qu’un visage. Le théâtre liberté comme d’autres structures ne sont pas des lieux élitistes mais des espaces culturels heureusement subventionnés.»
Il faudrait donc se contenter de la culture au singulier et sans complément, comme dans «Ministère de la Culture».
Sur le site du ministère, il est écrit : «La mission fondatrice du ministère de la Culture de «rendre accessibles au plus grand nombre les œuvres capitales de l’humanité» s’est traduite à la fois par un soutien à l’offre culturelle, à sa qualité et à sa diversité et par une action en faveur du développement des publics, particulièrement de ceux qui sont le plus éloignés de la culture.» Apprécions l’énoncé aux relents colonialistes qui laisse à penser que des êtres humains peuvent vivre «éloignés de la culture», au seul motif qu’ils ne partagent pas la vôtre. Qui décide de ce qui fait culture, en France ? Un indice : ce n’est peut-être pas cette femme qui nettoie, au petit matin, les locaux de la rue de Valois.
On entend souvent parler du «monde de la culture». L’expression laisse flotter l’idée d’une entité homogène, témoignant d’un même rapport sensible au monde. Pourtant, si on interroge plusieurs personnes sur la signification du mot culture, il est fort probable qu’on obtienne des points de vue divergents. Le territoire semble vaste, à la mesure de la vie de chacun-e. Sauf qu’il est très circonscrit sur le plan institutionnel.
Revenons alors à cette Culture avec un grand C que le ministère entend promouvoir à travers le réseau des «scènes nationales» auquel émarge le théâtre Liberté. Cette «La Culture» se déploie selon un processus de médiation complexe associant air du temps, appropriation, neutralisation, légitimation, valorisation, en prise directe avec les préoccupations sociétales des classes moyennes supérieures qui constituent son ferment …beaucoup moins avec les précarités sociales qui échappent aux mêmes classes moyennes supérieures. L’institution culturelle sera beaucoup plus prompte à s’emparer des questions de genre que du mouvement des Gilets jaunes, par exemple.
Subventionnée d’un côté, mécénée de l’autre, cette Culture se sait fragile et constamment menacée dans la mesure où, derrière son C majuscule, elle reste d’accès minoritaire (aussi prétendument universaliste soit-elle) et s’oppose de plus en plus frontalement à un repli et une atrophie authentiquement réactionnaires, qu’incarnait en son temps le Front national de Jean-Marie Le Chevallier à Toulon, mais que promeut aussi l’actuel ministre de l’Éducation nationale. Voir son usage gourmand de l’expression «islamo-gauchiste», ou la confusion médiatique qu’il entretient entre les «réunions de personnes racisées» et les «réunions racistes». Pourquoi parler spécifiquement de Jean-Michel Blanquer ? Parce que son ministère est historiquement lié à celui de la Culture et que l’action culturelle se fait très souvent par le biais de l’institution scolaire.
Au constat du sort réservé à l’expression artistique à et à la création sous toutes ses formes en période de covid (à l’exclusion notable de la forme numérique), et à l’écoute de la parole gouvernementale, il y a donc objectivement du souci à se faire.
C’est par cette fragilité que s’opère le rejet épidermique de toute critique à l’endroit de la Culture aussitôt perçue, de l’intérieur, comme faisant le jeu des réactionnaires. Il y aurait pourtant urgence à développer cette critique et ouvrir les portes, à revenir sur la notion de culture «élitaire pour tous» et discuter cette émancipation dont la Culture prétend être vectrice, quand les tensions vont croissantes entre des corps sociaux artificiellement montés les uns contre les autres. Et pour bien comprendre les choses, il convient de correctement les nommer.
Alors oui, Le théâtre Liberté est un temple de la culture bourgeoise.
Affirmer cela n’est pas faire injure aux abonné-e-s ni aux personnes qui y travaillent, c’est exposer la réalité des faits. Un temple, en ce sens que la taille du hall et de ses lustres forcent la considération, et qu’on n’entre pas ici comme on pose sa serviette sur la plage. Bourgeois, parce que sa programmation fait le miel de personnes détenant un capital qui les engage dans un rapport de domination, qu’elles l’admettent ou non, vis-à-vis de celles qui n’en disposent pas : le capital culturel passe en particulier par la maîtrise de la langue.
En ces lieux prospère une certaine forme de normalisation sociale, un entre-soi ressenti comme une violence par les personnes qui n’ont pas le bon habitus, le savent et s’auto-excluent a priori malgré toute la «bienveillance» de l’institution. La programmation du Liberté attire ainsi, pour l’essentiel, un public cultivé, vivant d’un travail sans doute plus intellectuel que manuel, aussi des gens moins connaisseurs mais plus friqués, se trouvant légitimes à franchir le seuil du temple puisque l’argent a ce pouvoir magique d’abolir les frontières symboliques.
Car il est bien évident qu’on peut disposer d’un capital culturel et parallèlement crever la dalle. C’est dans ce cas, et dans ce cas seulement, quand on salive devant la vitrine sans avoir les moyens de s’offrir les victuailles, que les fameux billets suspendus peuvent trouver leur destination.
Il y a bien aveuglement, à confondre la nécessaire critique de la domination culturelle avec une pseudo-division autour de revendications catégorielles. Il y a bien funeste repli, à vouloir contenir «l’élargissement» de la lutte, c’est à dire refuser d’associer la crise que traverse «le monde de la culture» à la dynamique systémique qui affecte aussi, entre autres, l’Hôpital et l’Université.
Cet aveuglement vire à la schizophrénie quand la Culture, qui prône «le respect de l’autre dans ses différences» et la «promotion de la diversité sous toutes ses formes», se bouche les oreilles et appelle la Sécurité en renfort parce que ça vocifère un peu trop fort dans le hall du théâtre. Les dernières nuits d’occupation du Liberté, il y avait là autant de vigiles que d’occupants…
La Culture, en son temple, coincée entre ministère et pouvoirs locaux, ayant à cœur d’assumer son cahier des charges et les responsabilités qu’engage un budget très conséquent (très conséquent au regard des budgets des autres lieux culturels du coin, s’entend) doit-elle simplement attendre un hypothétique retour à la normale en se parlant à elle-même, en vase clos ? Est-elle condamnée à penser le désastre comme seul sujet de programmation à l’intention de publics qui échappent au désastre ? Peut-elle continuer de monter Kafka, Orwell, Falk Richter, sans rien dire publiquement sur la loi «Sécurité globale» ? Peut-elle encore danser le multiculturalisme en restant silencieuse devant la stigmatisation culturelle opérée par la loi «Séparatisme» ?
La Culture, en son temple rouvert, une fois sa normalité retrouvée, pourra-t-elle être nuisible au désastre ?
/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FfSEmdkGem0g%2Fhqdefault.jpg)
🚨En exclusivité l'interview de Charles Berling avant l'occupation du Théâtre Liberté de Toulon.
Ce dimanche à 16h, place de la liberté, Charles Berling, le directeur du Théâtre s'est prêté avec courtoisie aux questions posées par , l'envoyé spécial de l...
22 mars 2021
/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2Fabqw594Xrb8%2Fhqdefault.jpg)
Culture : le théâtre Liberté de Toulon, lieu de la contestation
d'infos : https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/var/toulon/le-theatre-liberte-de-toulon-occupe-pour-protester-contre-la-fermet...
23 mars 2021
Merde à la culture institutionnelle qui formate en prétendant former
J'ai lu les déclarations de deux artistes, le directeur du CDN d'Angers (Thomas Jolly jouant à son balcon la scène du balcon de Roméo et Juliette, le 25 mars 2020) et le directeur du Théâtre de la Ville et du Festival d'automne Emmanuel Demarcy-Motta, le 4 septembre 2020
parler depuis les soucis et prérogatives d'un CDN ou d'un Festival donc parler de formes sans pointer le contexte mondial de mise en place d'un contrôle sécuritaire-autoritaire permanent (faisant s'effondrer quelques croyances et illusions: la démocratie comme rempart ou solution, l'état-providence comme garant des communs), sans se placer au niveau des enjeux, connus pourtant, annoncés depuis plus de 60 ans (rapport Meadows, halte à la croissance): il faut changer radicalement nos rapports à la Vie, à la Terre et à l'Univers; il faut se changer soi radicalement (peurs, en particulier la peur de la mort et servitude volontaire; apparemment, il faut beaucoup de temps déjà pour en avoir conscience)
au sortir d'un "grand" spectacle, je suis toujours un soumis; j'ai applaudi par exemple Trintignant habitant la marche à l'amour de Gaston Miron ou Nougaro faisant vivre sa plume d'ange
l'émotion, les larmes sont bâillonnées parce que nous sommes dans la représentation et pas dans la Présence qui pourrait en métamorphoser plus d'un, d'un coup comme une évidence
à méditer cette forte pensée de Jean Giono en préface du Prince, de Machiavel :
"Le pouvoir gouverne toujours comme les gouvernés gouverneraient s'ils avaient le pouvoir."
Où j'en suis, en date du 7 avril 2019 (mouvement des GJ)
pour moi maintenant si on
(on, désignant un passeur, un transmetteur, un partageur, un homme de passion et de bienveillance, un qui a choisi de se tenir le plus possible à l'écart du système marchand)
si on n’a pas pour objectif que tout le monde s’exprime en inventant sa façon de s'exprimer, pas en singeant les formats dominants (clips, shows, gros romans, pièces sur le bruit du monde, chansons et musiques dites actuelles, cirque, jonglage...)
si on n'a pas pour objectif que chacun crée son art de vivre sa vie, avec ses heurs, bonheurs, malheurs, pas en singeant les modèles dominants donnés à imiter, consommer, jeter, renouveler, et rien à voir avec les soi-disant arts de vivre, l'art de vivre méditerranéen, crétois, l'american way of life...
alors merde à l’art, aux artistes qui pullulent, sont en concurrence, mis en concurrence par les gens de culture, et qui ululent, crowdfundinguent, s'auto-produisent et revendiquent leur participation à l'économie, nous représentons 3% du PIB
merde aux gens de culture qui pullulent et pompent le fric, eux qui ont du pouvoir, si peu, si peu mais s'y croient avec de moins en moins d’argent et revendiquent aussi leur participation à l'économie, nous représentons plus que l'industrie automobile
monde de merde à l’image caricaturale du monde de requins et prédateurs de toutes sortes des hautes sphères qui ne tournent pas rond.
La déclaration de Villeurbanne, vous comprenez que je m'en moque.
Ses enjeux même contradictoires ne sont pas à la hauteur.
Mon slogan serait :
Tous artistes, tous écrivains, tous photographes,
chacun son expression, chacun son art de vivre sa vie
pas la vie comme oeuvre d'art
pas l'art pour émanciper, élever, éduquer, éveiller
pas la culture dominante qui ne se reconnaît pas comme telle, alibi de la domination marchande avec son discours émancipateur, démocratisateur et ses pratiques de management à l'américaine, travail en openspace, séparation entre direction, personnel et techniciens, entre gens de culture et artistes
chacun son art de vivre sa vie c'est-à-dire en conscience, y en a, y veulent de la pleine conscience, beaucoup de moments dans le silence, parfois du rire, des sourires tout pleins, des gestes doux et tendres, pas besoin de créativité renouvelable 24 H sur 24, juste de l'attention, là, à 10 cms, regarde et tu déplaces la petite pierre, la brindille, ah, ça fait un cupidon...et t'es frappé en plein coeur par l'amour
mais purée que c'est simple l'amour,
y en a qui aiment compliquer à souhait
y en a qui veulent pas entendre le souffle aimant à côté d'eux, tant pis pour eux
j'aime les bienheureux, les simples d'esprit et de coeur qui ont le coeur net et direct, donc les enfants débiberonnés du cordon médiatique
Maintenant je veux dire où j’en suis en 2019, après avoir joué un rôle public dans les domaines du théâtre, de l’écriture et de l’édition, pendant 22 à 30 ans, tout cela bénévolement (je tiens à le préciser et je tiens à préciser que cette position d'aujourd'hui est en lien avec mon cheminement intellectuel, spirituel et ne vaut que pour moi, autrement dit je trouve normale toute autre position exprimant le vécu, les choix essentiels d'un autre et il ne me viendrait pas à l'esprit de le convaincre ou persuader qu'il se trompe) :
si ce qui se passe (mouvement des GJ) est un moment de changement de paradigme, d'une crise irréversible de la civilisation matérialiste, consumériste (avec crise de régime, crise de la représentation suite à son incapacité à adapter nos modes de vie au nouveau régime climatique et aux autres effondrements ou basculements, à assurer la transition écologique, mot qui parle peu, expression peut-être déjà dépassée) vers une civilisation de la Conscience, alors, ce qui importe est le cheminement de plus en plus conscient de chacun, dans chacun de ses comportements, de l'intime à l'extime; il en va de la responsabilité de chacun et d'un travail sur soi persévérant, exigeant
je me doute bien que les zones de confort des uns et des autres sont un obstacle à cette élévation de conscience individuelle et collective; faudra-t-il donc encore plus de souffrances pour en sortir de cette civilisation mortelle et mortifère ?
à supposer que je sois dans la lumière à un moment parce que proposant une action un peu sensée ou une idée un peu innovante, je dois aussi accepter de ne plus l'être demain
le mouvement fait apparaître, disparaître (plus ample que le seul mouvement des gilets jaunes, beaucoup plus lointain que l’acte I du 17 novembre 2018)
nous sommes à notre place, au bon moment, le temps d'un moment puis on s'efface, on est effacé, remplacé
surtout refuser de garder la main sur un segment, un pré carré, ne pas être dans les entre-soi..., dans les certitudes (rejeter le RIC, être jusqu'au boutiste de la grève générale illimitée qui ne semble pas être à l'ordre du jour, voir les déclarations ignobles sur les GJ de tout un tas de gens qu’on nous vendait comme ouverts, même Patrick Boucheron)
tout accueillir, ne pas faire de tri, comprendre, tenter de comprendre les autres points de vue, surtout ceux qui nous sont les plus étrangers, cela demande de l'empathie, de l'amour, de l'amitié pour l’autre (pas facile du tout de comprendre un Luc Ferry et Macron alors !):
on n'est pas ennemis, on a un commun essentiel, pas seulement d'être Humain, pas seulement d'être Terrien mais d'être des Univers
favoriser les créolisations, le Tout-Monde (lire Edouard Glissant)
Denis Lavant : "L'idéal, c'est d'avoir un rapport poétique à la vie, au quotidien, et de ne pas avoir besoin de scène pour exercer cela"
" Ce qui me tourmente, c’est le point de vue du jardinier. Ce qui me tourmente ce n’est point cette misère, dans laquelle, après tout, on s’installe aussi bien que dans la paresse. Des générations d’orientaux vivent dans la crasse et s’y plaisent. Ce qui me tourmente, les soupes populaires ne le guérissent point. Ce qui me tourmente, ce ne sont ni ces creux, ni ces bosses, ni cette laideur. C’est un peu, dans chacun de ces hommes, Mozart assassiné." Saint-Exupéry
IMAGINONS: 1700 spectacles en Avignon l'été dans le off soit 1700 X 20000 € de location de salle mini = 34.000.000 € dépensés pour une illusion : on va être vu par des directeurs et des critiques et on va tourner. Ô les tristes calculs de jeunes plein d'énergie, aptes au système D et réussissant à survivre, certes souvent dans la galère mais survivre avec le sentiment d'être créatif, créateur ce qui peut donner une saveur sans pareille à l'existence; rien à voir avec l'aliénation des exploités de bas en haut du système productif.
IMAGINONS: 1700 compagnies investissent la France profonde, désertée par les paysans, peu récupérée par les alternatifs et ils construisent leur habitat durable, écolo, leur salle de répétition, leur jardin en permaculture, leurs équipements en énergie géothermique, des oasis donc avec école Montessori, des jardins d'Épicure, le philosophe pour des temps comme le nôtre de fin de civilisation (lire le Sur Épicure de Marcel Conche qui se tient à l'écart du grand tapage médiatique)
IMAGINONS : les musiciens, les écrivains, les plasticiens, les architectes, tous ceux capables de comprendre qu'il n'y a pas d'avenir dans ce monde marchand abandonnent les villes à leur pourrissement et à leur ratisation proliférante et vont retrouver la dure et saine vie dans les collines et les bois comme D.H Thoreau ou comme avait imaginé Jack London
mais ce n'est qu'un rêve
qui dit éducation (y compris artistique donc censé être à l'écoute de l'enfant) dit qu'il y a nécessité à transmettre, quoi ? ce que transmet le maître, l'artiste et même s'il y a grande écoute de l'adolescent, de l'enfant, il y a certitude qu'il y a à transmettre, ça c'est gratifiant et ça peut se rémunérer en plus de la gratification narcissique; et si l'enfant n'était pas à éduquer ? même et surtout sur le plan artistique, créatif ? l'éducation se passe au niveau de la conscience analytique cérébrale, ce que j'appelle la CAC 40, pire que le CAC 40; l'enfant jusqu'à 6-7 ans est spontanément dans la conscience intuitive extra-neuronale (états modifiés de conscience), il a accès à des dimensions que nous perdons avec les apprentissages et l'éducation => une société sans école de Yvan Illich, François Roustang, Jean-Jacques Charbonnier
les programmes qui nous agissent ont été acquis entre le 6° mois de notre état de foetus
et l'âge de 7 ans, sous onde téta, en quasi-hypnose, ce sont des programmes inconscients, subconscients venus de notre milieu familial, socio-culturel, programmes hérités de notre "éducation", de l'éducation reçue, très souvent coercitive, pour notre "bien", éducation à la performance, à toujours se dépasser qui paradoxalement nous apprend à ne pas nous aimer, à nous juger négativement en permanence ;à partir de 7 ans, le néo-cortex ou lobe frontal entre en fonction, sous onde alpha, on pense, réfléchit, évalue, décide éventuellement de modifier le programme ; il se trouve que 95% de nos programmes inconscients nous pilotent quasi- automatiquement, que nous tentons d'agir sur nous avec 5% de conscience ; on ne fait pas le poids ; d'où les thérapies nouvelles à base d'hypnose pour reprogrammer ce qui est inconscient(1- vidéos essentielles de Bruce Lipton sur you tube et pour renouer avec l'animalité en nous, 2- être inspiré par Mister Gaga, Ohad Naharin)1-2-
moi - Rilke parle très bien de l'Ouvert et avant lui Hegel dans le magnétisme animal, hors parole, hors langage; ça ne se pense pas, ça se vit et c'est très difficile à retrouver, à trouver; je n'y suis pas encore arrivé malgré méditation et autres exercices dont atelier de TCH (trans-communication hypnotique)
7 avril 2019, JCG
/image%2F0551669%2F20190201%2Fob_b4d738_opera-de-toulon.jpg)
lettres ouvertes aux directeurs du Liberté et de l'Opéra - Blog de Jean-Claude Grosse
lettre envoyée par mail le 31 janvier, portée en mains propres le 1° février avec une gilette jaune J'ai pris l'initiative de ces deux lettres après celle de Jeanne valérie Held s'adressant a...
j'avais pris l'initiative de ces lettres ouvertes, le 31 janvier 2019, lettres portées sur place le 1° février; deux débats citoyens ont été organisés, présentés comme initiés par le Liberté; ça s'appelle de la récupération
/image%2F0551669%2F20200424%2Fob_c48a71_ob-c46928-img765.jpg)
Débat citoyen au Théâtre Liberté - Blog de Jean-Claude Grosse
articles de Var Matin, le bocal varois de juin 2002 avec des auteurs algériens et des auteurs pieds-noirs, le livre franco-russe né du bocal agité au lac Baïkal en août 2010 pour les 10 ans du...
https://les4saisons.over-blog.com/2019/02/debat-citoyen-au-theatre-liberte.html
débat citoyen au Liberté pendant le mouvement des gilets jaunes, avec des gilets jaunes
/image%2F0551669%2F20190308%2Fob_8cc57c_53423668-10214143945811929-39581266088.jpg)
Débat citoyen à Châteauvallon - Blog de Jean-Claude Grosse
à Châteauvallon, le plateau, place de la Liberté à Toulon, parvis de la gare de Toulon le mercredi 6 mars j'interviens vers 40' pour rappeler le festival des possibles et proposer un genre ...
https://les4saisons.over-blog.com/2019/03/debat-citoyen-a-chateauvallon.html
débat à Châteauvallon pendant le mouvement des gilets jaunes, avec des gilets jaunes
sur la Commune (18 mars 1871-28 mai 1871)
/https%3A%2F%2Fapi-cdn.arte.tv%2Fapi%2Fmami%2Fv1%2Fprogram%2Ffr%2F094482-000-A%2F1920x1080%3Fts%3D1616497542%26watermark%3Dtrue%26text%3Dtrue)
Les damnés de la Commune - Regarder le documentaire complet | ARTE
Du soulèvement du 18 mars 1871 à la "Semaine sanglante" qui s'acheva le 28 mai 1871, Paris fit il y a 150 ans l'expérience d'une insurrection populaire et démocratique. Raphaël Meyssan nous pl...
https://www.arte.tv/fr/videos/094482-000-A/les-damnes-de-la-commune/
/https%3A%2F%2Fstatic.mediapart.fr%2Fetmagine%2Fog%2Ffiles%2F2021%2F03%2F22%2Flouise-michel-sylvie-testud.jpg)
La Commune, entre mémoire et histoire
On l'a tuée à coups de Chassepot A coups de mitrailleuse Et roulée avec son drapeau Tout ça n'empêche pas, Nicolas, Qu'la Commune n'est pas morte! Eugène Pottier (1886) Les témoignages et le...
- Un article de Mediapart du 22 mars :
- https://blogs.mediapart.fr/edition/les-cercles-condorcet/article/220321/la-commune-entre-memoire-et-histoire
- Dans Le Poème des morts (éd. Fata Morgana, 2017), Bernard Noël a consacré le poème n° 16 à la Commune :
- Ce poème est à rapprocher de l'article PENSER du Dictionnaire de la Commune :
/https%3A%2F%2Fmaitron.fr%2Flocal%2Fcache-vignettes%2FL300xH225%2Farton219219-070a8.jpg%3F1615896191)
Le premier volume, passionnant, s'ouvrait déjà sur une sympathique évocation du Maitron. L'auteur y mettait en scène sa volonté de retrouver l'histoire oubliée d'un ancien occupant de son imm...
le Maitron est un dictionnaire essentiel sur le mouvement ouvrier, ses figures, ses tendances ...
2 - pour ceux qui ne connaissent pas Marx
Chapitre 3
À l'aube du 18 mars, Paris fut réveillé par ce cri de tonnerre : Vive la Commune! Qu'est-ce donc que la Commune, ce sphinx qui met l'entendement bourgeois à si dure épreuve ?
Les prolétaires de la capitale, disait le Comité central dans son manifeste du 18 mars, au milieu des défaillances et des trahisons des classes gouvernantes, ont compris que l'heure était arrivée pour eux de sauver la situation en prenant en main la direction des affaires publiques... Le prolétariat... a compris qu'il était de son devoir impérieux et de son droit absolu de prendre en main ses destinées, et d'en assurer le triomphe en s'emparant du pouvoir.
Mais la classe ouvrière ne peut pas se contenter de prendre tel quel l'appareil d'État et de le faire fonctionner pour son propre compte.
Le pouvoir centralisé de l'État, avec ses organes, partout présents : armée permanente, police, bureaucratie, clergé et magistrature, organes façonnés selon un plan de division systématique et hiérarchique du travail, date de l'époque de la monarchie absolue, où il servait à la société bourgeoise naissante d'arme puissante dans ses luttes contre le féodalisme. Cependant, son développement restait entravé par toutes sortes de décombres moyenâgeux, prérogatives des seigneurs et des nobles, privilèges locaux, monopoles municipaux et corporatifs et Constitutions provinciales. Le gigantesque coup de balai de la Révolution française du XVIIIe siècle emporta tous ces restes des temps révolus, débarrassant ainsi, du même coup, le substrat social des derniers obstacles s'opposant à la superstructure de l'édifice de l'État moderne. Celui-ci fut édifié sous le premier Empire, qui était lui-même le fruit des guerres de coalition de la vieille Europe semi-féodale contre la France moderne. Sous les régimes qui suivirent, le gouvernement, placé sous contrôle parlementaire, c'est-à-dire sous le contrôle direct des classes possédantes, ne devint pas seulement la pépinière d'énormes dettes nationales et d'impôts écrasants; avec ses irrésistibles attraits, autorité, profits, places, d'une part il devint la pomme de discorde entre les factions rivales et les aventuriers des classes dirigeantes, et d'autre part son caractère politique changea conjointement aux changements économiques de la société. Au fur et à mesure que le progrès de l'industrie moderne développait, élargissait, intensifiait l'antagonisme de classe entre le capital et le travail, le pouvoir d'État prenait de plus en plus le caractère d'un pouvoir publie organisé aux fins d'asservissement social, d'un appareil de domination d'une classe. Après chaque révolution, qui marque un progrès de la lutte des classes, le caractère purement répressif du pouvoir d'État apparaît façon de plus en plus ouverte. La Révolution de 1830 transféra le gouvernement des propriétaires terriens aux capitalistes, des adversaires les plus éloignés des ouvriers à leurs adversaires les plus directs. Les républicains bourgeois qui, au nom de la Révolution de février, s'emparèrent du pouvoir d'État, s'en servirent pour provoquer les massacres de juin, afin de convaincre la classe ouvrière que la république « sociale », cela signifiait la république qui assurait la sujétion sociale, et afin de prouver à la masse royaliste des bourgeois et des propriétaires terriens qu'ils pouvaient en toute sécurité abandonner les soucis et les avantages financiers du gouvernement aux « républicains » bourgeois. Toutefois, après leur unique exploit héroïque de juin, il ne restait plus aux républicains bourgeois qu'à passer des premiers rangs à l'arrière-garde du « parti de l'ordre », coalition formée par toutes les fractions et factions rivales de la classe des appropriateurs dans leur antagonisme maintenant ouvertement déclaré avec les classes des producteurs. La forme adéquate de leur gouvernement en société par actions fut la « république parlementaire », avec Louis Bonaparte pour président, régime de terrorisme de classe avoué et d'outrage délibéré à la « vile multitude ». Si la république parlementaire, comme disait M. Thiers, était celle qui « les divisait [les diverses fractions de la classe dirigeante] le moins », elle accusait par contre un abîme entre cette classe et le corps entier de la société qui vivait en dehors de leurs rangs clairsemés. Leur union brisait les entraves que, sous les gouvernements précédents, leurs propres dissensions avaient encore mises au pouvoir d'État. En présence de la menace de soulèvement du prolétariat, la classe possédante unie utilisa alors le pouvoir de l'État, sans ménagement et avec ostentation comme l'engin de guerre national du capital contre le travail. Dans leur croisade permanente contre les masses productrices, ils furent forcés non seulement d'investir l'exécutif de pouvoirs de répression sans cesse accrus, mais aussi de dépouiller peu à peu leur propre forteresse parlementaire, l'Assemblée nationale, de tous ses moyens de défense contre l'exécutif. L'exécutif, en la personne de Louis Bonaparte, les chassa. Le fruit naturel de la république du « parti de l'ordre » fut le Second Empire.
L'empire, avec le coup d'État pour acte de naissance, le suffrage universel pour visa et le sabre pour sceptre, prétendait s'appuyer sur la paysannerie, cette large masse de producteurs qui n'était pas directement engagée dans la lutte du capital et du travail. Il prétendait sauver la classe ouvrière en en finissant avec le parlementarisme, et par là avec la soumission non déguisée du gouvernement aux classes possédantes. Il prétendait sauver les classes possédantes en maintenant leur suprématie économique sur la classe ouvrière; et finalement il se targuait de faire l'unité de toutes les classes en faisant revivre pour tous l'illusion mensongère de la gloire nationale. En réalité, c'était la seule forme de gouvernement possible, à une époque où la bourgeoisie avait déjà perdu, - et la classe ouvrière n'avait pas encore acquis, - la capacité de gouverner la nation. Il fut acclamé dans le monde entier comme le sauveur de la société. Sous l'empire, la société bourgeoise libérée de tous soucis politiques atteignit un développement dont elle n'avait elle-même jamais eu idée. Son industrie et son commerce atteignirent des proportions colossales; la spéculation financière célébra des orgies cosmopolites; la misère des masses faisait un contraste criant avec l'étalage éhonté d'un luxe somptueux, factice et crapuleux. Le pouvoir d'État, qui semblait planer bien haut au-dessus de la société, était cependant lui-même le plus grand scandale de cette société et en même temps le foyer de toutes ses corruptions. Sa propre pourriture et celle de la société qu'il avait sauvée furent mises à nu par la baïonnette de la Prusse, elle-même avide de transférer le centre de gravité de ce régime de Paris à Berlin. Le régime impérial est la forme la plus prostituée et en même temps la forme ultime de ce pouvoir d'État, que la société bourgeoise naissante a fait naître, comme l'outil de sa propre émancipation du féodalisme, et que la société bourgeoise parvenue à son plein épanouissement avait finalement transformé en un moyen d'asservir le travail au capital.
L'antithèse directe de l'Empire fut la Commune. Si le prolétariat de Paris avait fait la révolution de Février au cri de « Vive la République sociale », ce cri n'exprimait guère qu'une vague aspiration à une république qui ne devait pas seulement abolir la forme monarchique de la domination de classe, mais la domination de classe elle-même. La Commune fut la forme positive de cette république.
Paris, siège central de l'ancien pouvoir gouvernemental, et, en même temps, forteresse sociale de la classe ouvrière française, avait pris les armes contre la tentative faite par Thiers et ses ruraux pour restaurer et perpétuer cet ancien pouvoir gouvernemental que leur avait légué l'empire. Paris pouvait seulement résister parce que, du fait du siège, il s'était débarrassé de l'armée et l'avait remplacée par une garde nationale, dont la masse était constituée par des ouvriers. C'est cet état de fait qu'il s'agissait maintenant de transformer en une institution durable. Le premier décret de la Commune fut donc la suppression de l'armée permanente, et son remplacement par le peuple en armes.
La guerre civile en France - Essai de Marx sur la Commune de Paris et l'histoire politique et sociale de la France au XIXe Siècle, chapitre 3
La Commune fut composée des conseillers municipaux, élus au suffrage universel dans les divers arrondissements de la ville. Ils étaient responsables et révocables à tout moment. La majorité de ses membres était naturellement des ouvriers ou des représentants reconnus de la classe ouvrière. La Commune devait être non pas un organisme parlementaire, mais un corps agissant, exécutif et législatif à la fois. Au lieu de continuer d'être l'instrument du gouvernement central, la police fut immédiatement dépouillée de ses attributs politiques et transformée en un instrument de la Commune, responsable et à tout instant révocable. Il en fut de même pour les fonctionnaires de toutes les autres branches de l'administration. Depuis les membres de la Commune jusqu'au bas de l'échelle, la fonction publique devait être assurée pour un salaire d'ouvrier. Les bénéfices d'usage et les indemnités de représentation des hauts dignitaires de l'État disparurent avec ces hauts dignitaires eux-mêmes. Les services publics cessèrent d'être la propriété privée des créatures du gouvernement central. Non seulement l'administration municipale, mais toute l'initiative jusqu'alors exercée par l'État fut remise aux mains de la Commune.
Une fois abolies l'armée permanente et la police, instruments du pouvoir matériel de l'ancien gouvernement, la Commune se donna pour tâche de briser l'outil spirituel de l'oppression, le pouvoir des prêtres; elle décréta la dissolution et l'expropriation de toutes les Églises dans la mesure où elles constituaient des corps possédants. Les prêtres furent renvoyés à la calme retraite de la vie privée, pour y vivre des aumônes des fidèles, à l'instar de leurs prédécesseurs, les apôtres. La totalité des établissements d'instruction furent ouverts au peuple gratuitement, et, en même temps, débarrassés de toute ingérence de l'Église et de l'État. Ainsi, non seulement l'instruction était rendue accessible à tous, mais la science elle-même était libérée des fers dont les préjugés de classe et le pouvoir gouvernemental l'avaient chargée.
Les fonctionnaires de la justice furent dépouillés de cette feinte indépendance qui n'avait servi qu'à masquer leur vile soumission à tous les gouvernements successifs auxquels, tour à tour, ils avaient prêté serment de fidélité, pour le violer ensuite. Comme le reste des fonctionnaires publics, magistrats et juges devaient être élus, responsables et révocables.
La Commune de Paris devait, bien entendu, servir de modèle à tous les grands centres industriels de France. Le régime de la Commune une fois établi à Paris et dans les centres secondaires, l'ancien gouvernement centralisé aurait, dans les provinces aussi, dû faire place au gouvernement des producteurs par eux-mêmes. Dans une brève esquisse d'organisation nationale que la Commune n'eut pas le temps de développer, il est dit expressément que la Commune devait être la forme politique même des plus petits hameaux de campagne et que dans les régions rurales l'armée permanente devait être remplacée par une milice populaire à temps de service extrêmement court. Les communes rurales de chaque département devaient administrer leurs affaires communes par une assemblée de délégués au chef-lieu du département, et ces assemblées de département devaient à leur tour envoyer des députés à la délégation nationale à Paris; les délégués devaient être à tout moment révocables et liés par le mandat impératif de leurs électeurs. Les fonctions, peu nombreuses, mais importantes, qui restaient encore à un gouvernement central, ne devaient pas être supprimées, comme on l'a dit faussement, de propos délibéré, mais devaient être assurées par des fonctionnaires de la Commune, autrement dit strictement responsables. L'unité de la nation ne devait pas être brisée, mais au contraire organisée par la Constitution communale; elle devait devenir une réalité par la destruction du pouvoir d'État qui prétendait être l'incarnation de cette unité, mais voulait être indépendant de la nation même, et supérieur à elle, alors qu'il n'en était qu'une excroissance parasitaire. Tandis qu'il importait d'amputer les organes purement répressifs de l'ancien pouvoir gouvernemental, ses fonctions légitimes devaient être arrachées à une autorité qui revendiquait une prééminence au-dessus de la société elle-même, et rendues aux serviteurs responsables de la société. Au lieu de décider une fois tous les trois ou six ans quel membre de la classe dirigeante devait « représenter » et fouler aux pieds le peuple au Parlement, le suffrage universel devait servir au peuple constitué en communes, comme le suffrage individuel sert à tout autre employeur en quête d'ouvriers, de contrôleurs et de comptables pour son affaire. Et c'est un fait bien connu que les sociétés, comme les individus, en matière d'affaires véritables, savent généralement mettre chacun à sa place et, si elles font une fois une erreur, elles savent la redresser promptement. D'autre part, rien ne pouvait être plus étranger à l'esprit de la Commune que de remplacer le suffrage universel par une investiture hiérarchique.
C'est en général le sort des formations historiques entièrement nouvelles d'être prises à tort pour la réplique de formes plus anciennes, et même éteintes, de la vie sociale, avec lesquelles elles peuvent offrir une certaine ressemblance. Ainsi, dans cette nouvelle Commune, qui brise le pouvoir d'État moderne, on a voulu voir un rappel à la vie des communes médiévales, qui d'abord précédèrent ce pouvoir d'État, et ensuite en devinrent le fondement. - La Constitution communale a été prise à tort pour une tentative de rompre en une fédération de petits États, conforme au rêve de Montesquieu et des Girondins, cette unité des grandes nations, qui, bien qu'engendrée à l'origine par la violence, est maintenant devenue un puissant facteur de la production sociale. - L'antagonisme de la Commune et du pouvoir d'État a été pris à tort pour une forme excessive de la vieille lutte contre l'excès de centralisation. (...) La Constitution communale aurait restitué au corps social toutes les forces jusqu'alors absorbées par l'État parasite qui se nourrit sur la société et en paralyse le libre mouvement. Par ce seul fait, elle eût été le point de départ de la régénération de la France. La classe moyenne des villes de province vit dans la Commune une tentative de restaurer la domination que cette classe avait exercée sur la campagne sous Louis-Philippe, et qui, sous Louis-Napoléon, avait été supplantée par la prétendue domination de la campagne sur les villes. En réalité, la Constitution communale aurait soumis les producteurs ruraux à la direction intellectuelle des chefs-lieux de département et leur y eût assuré des représentants naturels de leurs intérêts en la personne des ouvriers des villes. L'existence même de la Commune impliquait, comme quelque chose d'évident, l'autonomie municipale; mais elle n'était plus dorénavant un contre-poids au pouvoir d'État, désormais superflu. (...) La Commune a réalisé ce mot d'ordre de toutes les révolutions bourgeoises, le gouvernement à bon marché, en abolissant ces deux grandes sources de dépenses : l'armée et le fonctionnarisme d'État. Son existence même supposait la non-existence de la monarchie qui, en Europe du moins, est le fardeau normal et l'indispensable masque de la domination de classe. Elle fournissait à la république la base d'institutions réellement démocratiques. Mais ni le « gouvernement à bon marché », ni la « vraie république » n'étaient son but dernier; tous deux furent un résultat secondaire et allant de soi de la Commune.
La multiplicité des interprétations auxquelles la Commune a été soumise, et la multiplicité des intérêts qu'elle a exprimés montrent que c'était une forme politique tout à fait susceptible d'expansion, tandis que toutes les formes antérieures de gouvernement avaient été essentiellement répressives. Son véritable secret, le voici : c'était essentiellement un gouvernement de la classe ouvrière, le résultat de la lutte de la classe des producteurs contre la classe des appropriateurs, la forme politique enfin trouvée qui permettait de réaliser l'émancipation économique du travail .
Sans cette dernière condition, la Constitution communale eût été une impossibilité et un leurre. La domination politique du producteur ne peut coexister avec la pérennisation de son esclavage social. La Commune devait donc servir de levier pour renverser les bases économiques sur lesquelles se fonde l'existence des classes, donc, la domination de classe. Une fois le travail émancipé, tout homme devient un travailleur, et le travail productif cesse d'être l'attribut d'une classe.
C'est une chose étrange. Malgré tous les discours grandiloquents, et toute l'immense littérature des soixante dernières années sur l'émancipation des travailleurs, les ouvriers n'ont pas plutôt pris, où que ce soit, leur propre cause en main, que, sur-le-champ, on entend retentir toute la phraséologie apologétique des porte-parole de la société actuelle avec ses deux pôles, capital et esclavage salarié (le propriétaire foncier n'est plus que le commanditaire du capitaliste), comme si la société capitaliste était encore dans son plus pur état d'innocence virginale, sans qu'aient été encore développées toutes ses contradictions, sans qu'aient été encore dévoilés tous ses mensonges, sans qu'ait été encore mise à nu son infâme réalité. La Commune, s'exclament-ils, entend abolir la propriété, base de toute civilisation. Oui, messieurs, la Commune entendait abolir cette propriété de classe, qui fait du travail du grand nombre la richesse de quelques-uns. Elle visait à l'expropriation des expropriateurs. Elle voulait faire de la propriété individuelle une réalité, en transformant les moyens de production, la terre et le capital, aujourd'hui essentiellement moyens d'asservissement et d'exploitation du travail, en simples instruments d'un travail libre et associé. Mais c'est du communisme, c'est l' « impossible» communisme! Eh quoi, ceux des membres des classes dominantes qui sont assez intelligents pour comprendre l'impossibilité de perpétuer le système actuel - et ils sont nombreux - sont devenus les apôtres importuns et bruyants de la production coopérative. Mais si la production coopérative ne doit pas rester un leurre et une duperie; si elle doit évincer le système capitaliste; si l'ensemble des associations coopératives doit régler la production nationale selon un plan commun, la prenant ainsi sous son propre contrôle et mettant fin à l'anarchie constante et aux convulsions périodiques qui sont le destin inéluctable de la production capitaliste, que serait-ce, messieurs, sinon du communisme, du très « possible » communisme ?
La classe ouvrière n'espérait pas des miracles de la Commune. Elle n'a pas d'utopies toutes faites à introduire par décret du peuple. Elle sait que pour réaliser sa propre émancipation, et avec elle cette forme de vie plus haute à laquelle tend irrésistiblement la société actuelle en vertu de son propre développement économique, elle aura à passer par de longues luttes, par toute une série de processus historiques, qui transformeront complètement les circonstances elles-mêmes. Elle n'a pas à réaliser d'idéal, mais seulement à libérer les éléments de la société nouvelle que porte dans ses flancs la vieille société bourgeoise qui s'effondre. Dans la pleine conscience de sa mission historique et avec la résolution héroïque d'être digne d'elle dans son action, la classe ouvrière peut se contenter de sourire des invectives grossières des laquais de presse et de la protection sentencieuse des doctrinaires bourgeois bien intentionnés qui débitent leurs platitudes d'ignorants et leurs marottes de sectaires, sur le ton d'oracle de l'infaillibilité scientifique.
Quand la Commune de Paris prit la direction de la révolution entre ses propres mains; quand de simples ouvriers, pour la première fois, osèrent toucher au privilège gouvernemental de leurs « supérieurs naturels», les possédants, et, dans des circonstances d'une difficulté sans exemple, accomplirent leur oeuvre modestement, consciencieusement et efficacement (et l'accomplirent pour des salaires dont le plus élevé atteignait à peine le cinquième de ce qui, à en croire une haute autorité scientifique, le professeur Huxley, est le minimum requis pour un secrétaire du conseil de l'instruction publique de Londres), le vieux monde se tordit dans des convulsions de rage à la vue du drapeau rouge, symbole de la République du travail, flottant sur l'Hôtel de Ville.
Et pourtant, c'était la première révolution dans laquelle la classe ouvrière était ouvertement reconnue comme la seule qui fût encore capable d'initiative sociale, même par la grande masse de la classe moyenne de Paris - boutiquiers, commerçants, négociants - les riches capitalistes étant seuls exceptés. La Commune l'avait sauvée, en réglant sagement cette cause perpétuelle de différends à l'intérieur même de la classe moyenne : la question des créanciers et des débiteurs. Cette même partie de la classe moyenne avait participé à l'écrasement de l'insurrection ouvrière en juin 1848; et elle avait été sur l'heure sacrifiée sans cérémonie à ses créanciers par l'Assemblée constituante. Mais ce n'était pas là son seul motif pour se ranger aujourd'hui aux côtés de la classe ouvrière. Cette fraction de la classe moyenne sentait qu'il n'y avait plus qu'une alternative, la Commune ou l'empire, sous quelque nom qu'il pût reparaître. L'Empire l'avait ruinée économiquement par Bon gaspillage de la richesse publique, par l'escroquerie financière en grand, qu'il avait encouragée, par l'appui qu'il avait donné à la centralisation artificiellement accélérée du capital, et à l'expropriation corrélative d'une grande partie de cette classe. Il l'avait supprimée politiquement, il l'avait scandalisée moralement par ses orgies, il avait insulté à son voltairianisme en remettant l'éducation de ses enfants aux frères ignorantins, il avait révolté son sentiment national de Français en la précipitant tête baissée dans une guerre qui ne laissait qu'une seule compensation pour les ruines qu'elle avait faites : la disparition de l'Empire. En fait, après l'exode hors de Paris de toute la haute bohème bonapartiste et capitaliste, le vrai parti de l'ordre de la classe moyenne se montra sous la forme de l' « Union républicaine » qui s'enrôla sous les couleurs de la Commune et la défendit contre les falsifications préméditées de Thiers. La reconnaissance de cette grande masse de la classe moyenne résistera-t-elle à la sévère épreuve actuelle ? Le temps seul le montrera.
La Commune avait parfaitement raison en disant aux paysans : « Notre victoire est votre seule espérance ». De tous les mensonges enfantés à Versailles et repris par l'écho des glorieux journalistes d'Europe à un sou la ligne, un des plus monstrueux fut que les ruraux de l'Assemblée nationale représentaient la paysannerie française. Qu'on imagine un peu l'amour du paysan français pour les hommes auxquels après 1815 il avait dû payer l'indemnité d'un milliard . A ses yeux, l'existence même d'un grand propriétaire foncier est déjà en soi un empiètement sur ses conquêtes de 1789. La bourgeoisie, en 1848, avait grevé son lopin de terre de la taxe additionnelle de 45 centimes par franc; mais elle l'avait fait au nom de la révolution; tandis que maintenant elle avait fomenté une guerre civile contre la révolution pour faire retomber sur les épaules du paysan le plus clair des cinq milliards d'indemnité à payer aux Prussiens. La Commune, par contre, dans une de ses premières proclamations, déclarait que les véritables auteurs de la guerre auraient aussi à en payer les frais. La Commune aurait délivré le paysan de l'impôt du sang, elle lui aurait donné un gouvernement à bon marché, aurait transformé ses sangsues actuelles, le notaire, l'avocat, l'huissier, et autres vampires judiciaires, en agents communaux salariés, élus par lui et devant lui responsables. Elle l'aurait affranchi de la tyrannie du garde champêtre, du gendarme et du préfet; elle aurait mis l'instruction par le maître d'école à la place de l'abêtissement par le prêtre. Et le paysan français est, par-dessus tout, homme qui sait compter. Il aurait trouvé extrêmement raisonnable que le traitement du prêtre, au lieu d'être extorqué par le libre percepteur, ne dépendit que de la manifestation des instincts religieux des paroissiens. Tels étaient les grands bienfaits immédiats dont le gouvernement de la Commune - et celui-ci seulement - apportait la perspective à la paysannerie française. Il est donc tout à fait superflu de s'étendre ici sur les problèmes concrets plus compliqués, mais vitaux, que la Commune seule était capable et en même temps obligée de résoudre en faveur du paysan : la dette hypothécaire, qui posait comme un cauchemar sur son lopin de terre, le prolétariat rural qui grandissait chaque jour et son expropriation de cette parcelle qui s'opérait à une allure de plus en plus rapide du fait du développement même de l'agriculture moderne et de la concurrence du mode de culture capitaliste.
Le paysan français avait élu Louis Bonaparte président de la République, mais le parti de l'ordre créa le Second Empire. Ce dont en réalité le paysan français a besoin, il commença à le montrer en 1849 et 1850, en opposant son maire au préfet du gouvernement, son maître d'école au prêtre du gouvernement et sa propre personne au gendarme du gouvernement. Toutes les lois faites par le parti de l'ordre en janvier et février 1850 furent des mesures avouées de répression contre les paysans. Le paysan était bonapartiste, parce que la grande Révolution, avec tous les bénéfices qu'il en avait tirés, se personnifiait à ses yeux en Napoléon. Cette illusion, qui se dissipa rapidement sous le second Empire (et elle était par sa nature même hostile aux « ruraux »), ce préjugé du passé, comment auraient-ils résisté à la Commune en appelant aux intérêts vivants et aux besoins pressants de la paysannerie ?
Les ruraux (c'était, en fait, leur appréhension maîtresse) savaient que trois mois de libre communication entre le Paris de la Commune et les provinces amèneraient un soulèvement général des paysans; de là leur hâte anxieuse à établir un cordon de police autour de Paris comme pour arrêter la propagation de la peste bovine.
Si la Commune était donc la représentation véritable de tous les éléments sains de la société française, et par suite le véritable gouvernement national, elle était en même temps un gouvernement ouvrier, et, à ce titre, en sa qualité de champion audacieux de l'émancipation du travail, internationale au plein sens du terme. Sous les yeux de l'armée prussienne qui avait annexé à l'Allemagne deux provinces françaises, la Commune annexait à la France les travailleurs du monde entier.
Le second Empire avait été la grande kermesse de la filouterie cosmopolite, les escrocs de tous les pays s'étaient rués à son appel pour participer à ses orgies et au pillage du peuple français. En ce moment même le bras droit de Thiers est Ganesco, crapule valaque, son bras gauche, Markovski, espion russe. La Commune a admis tous les étrangers à l'honneur de mourir pour une cause immortelle. - Entre la guerre étrangère perdue par sa trahison, et la guerre civile fomentée par son complot avec l'envahisseur étranger, la bourgeoisie avait trouvé le temps d'afficher son patriotisme en organisant la chasse policière aux Allemands habitant en France. La Commune a fait d'un ouvrier allemand son ministre du Travail. - Thiers, la bourgeoisie, le second Empire avaient continuellement trompé la Pologne par de bruyantes professions de sympathie, tandis qu'en réalité ils la livraient à la Russie, dont ils faisaient la sale besogne. La Commune a fait aux fils héroïques de la Pologne l'honneur de les placer à la tête des défenseurs de Paris. Et pour marquer hautement la nouvelle ère de l'histoire qu'elle avait conscience d'inaugurer, sous les yeux des Prussiens vainqueurs d'un côté, et de l'armée de Bonaparte, conduite par des généraux bonapartistes de l'autre la Commune jeta bas ce colossal symbole de la gloire guerrière, la colonne Vendôme.
La grande mesure sociale de la Commune, ce fut sa propre existence et son action. Ses mesures particulières ne pouvaient qu'indiquer la tendance d'un gouvernement du peuple par le peuple. Telles furent l'abolition du travail de nuit pour les compagnons boulangers; l'interdiction, sous peine d'amende, de la pratique en usage chez les employeurs, qui consistait à réduire les salaires en prélevant des amendes sur leurs ouvriers sous de multiples prétextes, procédé par lequel l'employeur combine dans sa propre personne les rôles du législateur, du juge et du bourreau, et empoche l'argent par-dessus le marché. Une autre mesure de cet ordre fut la remise aux associations d'ouvriers, sous réserve du paiement d'une indemnité, de tous les ateliers et fabriques qui avaient fermé, que les capitalistes intéressés aient disparu ou qu'ils aient préféré suspendre le travail.
Les mesures financières de la Commune, remarquables par leur sagacité et leur modération, ne pouvaient être que celles qui sont compatibles avec la situation d'une ville assiégée. Eu égard aux vols prodigieux commis aux dépens de la ville de Paris par les grandes compagnies financières et les entrepreneurs de travaux publics sous le régime d'Haussmann, la Commune aurait eu bien davantage le droit de confisquer leurs propriétés que Louis Napoléon ne l'avait de confisquer celles de la famille d'Orléans. Les Hohenzollern et les oligarques anglais, qui, les uns et les autres, ont tiré une bonne partie de leurs biens du pillage de l'Église, furent bien entendu, grandement scandalisés par la Commune qui, elle, ne tira que 8.000 francs de la sécularisation.
Alors que le gouvernement de Versailles, dès qu'il eut recouvré un peu de courage et de force, employait les moyens les plus violents contre la Commune; alors qu'il supprimait la liberté d'opinion par toute la France, allant jusqu'à interdire les réunions des délégués des grandes villes; alors qu'il. soumettait. Versailles, et le reste de la France, à un espionnage qui surpassait de loin celui du second Empire; alors qu'il faisait brûler par ses gendarmes transformés en inquisiteurs tous les journaux imprimés à Paris et qu'il décachetait toutes les lettres venant de Paris et destinées à Paris; alors qu'à l'Assemblée nationale les essais les plus timides de placer un mot en faveur de Paris étaient noyés sous les hurlements, d'une façon inconnue même à la Chambre introuvable de 1816; étant donné la conduite sanguinaire de la guerre par les Versaillais hors de Paris et leurs tentatives de corruption et de complot dans Paris, - la Commune n'aurait-elle pas honteusement trahi sa position en affectant d'observer toutes les convenances et les apparences du libéralisme, comme en pleine paix ? Le gouvernement de la Commune eût-il été de même nature que celui de M. Thiers, il n'y aurait pas eu plus de motif de supprimer des journaux du parti de l'ordre à Paris, que de supprimer des journaux de la Commune à Versailles.
Il était irritant, certes, pour les ruraux, que dans le moment même où ils proclamaient le retour à l'Église comme le seul moyen de sauver la France, la mécréante Commune déterrât les mystères assez spéciaux du couvent de Picpus et de l'église Saint-Laurent . Et quelle satire contre M. Thiers : tandis qu'il faisait pleuvoir des grands-croix sur les généraux bonapartistes, en témoignage de leur maestria à perdre les batailles, à signer les capitulations et à rouler les cigarettes à Wilhelmshoehe, la Commune cassait et arrêtait ses généraux dès qu'ils étaient suspectés de négliger leurs devoirs, L'expulsion hors de la Commune et l'arrestation sur son ordre d'un de ses membres qui s'y était faufilé sous un faux nom et qui avait encouru à Lyon une peine de six jours d'emprisonnement pour banqueroute ,simple, n'était-ce pas une insulte délibérée jetée à la face du faussaire Jules Favre, toujours ministre des Affaires étrangères de la France, toujours en train de vendre la France à Bismarck et dictant toujours ses ordres à la Belgique, ce modèle de gouvernement ? Mais, certes, la Commune ne prétendait pas à l'infaillibilité, ce que font sans exception tous les gouvernements du type ancien. Elle publiait tous ses actes et ses paroles, elle mettait le public au courant de, toutes ses imperfections.
Dans toute révolution, il se glisse, à côté de ses représentants véritables, des hommes d'une tout autre trempe; quelques-uns sont des survivants des révolutions passées dont ils gardent le culte; ne comprenant pas le mouvement présent, ils possèdent encore une grande influence sur le peuple par leur honnêteté et leur courage reconnus, ou par la simple force de la tradition; d'autres sont de simples braillards, qui, à force de répéter depuis des années le même chapelet de déclamations stéréotypées contre le gouvernement du jour, se sont fait passer pour des révolutionnaires de la plus belle eau. Même après le 18 mars, on vit surgir quelques hommes de ce genre, et, dans quelques cas, ils parvinrent à jouer des rôles de premier plan. Dans la mesure de leur pouvoir, ils gênèrent l'action réelle de la classe ouvrière, tout comme ils ont gêné le plein développement de toute révolution antérieure. Ils sont un mal inévitable; avec le temps on s'en débarrasse; mais, précisément, le temps n'en fut pas laissé à la Commune.
Quel changement prodigieux, en vérité, que celui opéré par la Commune dans Paris! Plus la moindre trace du Paris dépravé du second Empire. Paris n'était plus le rendez-vous des propriétaires fonciers britanniques, des Irlandais par procuration, des ex-négriers et des rastaquouères d'Amérique, des ex-propriétaires de serfs russes et des boyards valaques. Plus de cadavres à la morgue, plus d'effractions nocturnes, pour ainsi dire pas de vols; en fait, pour la première fois depuis les jours de février 1848, les rues de Paris étaient sûres, et cela sans aucune espèce de police. « Nous n'entendons plus parler, disait un membre de la Commune, d'assassinats, de vols, ni d'agressions; on croirait vraiment que la police a entraîné avec elle à Versailles toute sa clientèle conservatrice ». Les cocottes avaient retrouvé la piste de leurs protecteurs, - les francs-fileurs, gardiens de la famille, de la religion et, par-dessus tout, de a propriété. A leur place, les vraies femmes de Paris avaient reparu, héroïques, nobles et dévouées, comme les femmes de l'antiquité. Un Paris qui travaillait, qui pensait, qui combattait, qui saignait, ou liant presque, tout à couver une société nouvelle, les cannibales qui étaient à ses portes, -radieux dans l'enthousiasme de son initiative historique!
En face de ce monde nouveau à Paris, voyez l'ancien monde à Versailles, - cette assemblée des vampires de tous les régimes défunts, légitimistes et orléanistes, avides de se repaître du cadavre de la nation, - avec une queue de républicains d'avant le déluge, sanctionnant par leur présence dans l'Assemblée la rébellion des négriers, s'en remettant pour maintenir leur république parlementaire à la vanité du vieux charlatan placé à la tête du gouvernement, et caricaturant 1789 en se réunissant, spectres du passé, au Jeu de Paume. C'était donc elle, cette Assemblée, la représentante de tout ce qui était mort en France, que seul ramenait à un semblant de vie l'appui des sabres des généraux de Louis Bonaparte! Paris toute vérité, Versailles tout mensonge; et ce mensonge exhalé par la bouche de Thiers !
Thiers dit à une députation des maires de Seine-et-Oise : «Vous pouvez compter sur ma parole, je n'y ai jamais manqué ». Il dit à l'Assemblée même « qu'elle était la plus librement élue et la plus libérale que la France ait jamais eue»; il dit à sa soldatesque bigarrée qu'elle était « l'admiration du monde et la plus belle armée que la France ait jamais eue »; il dit aux provinces, qu'il ne bombardait pas Paris, que c'était un mythe. « Si quelques coups de canon ont été tirés, ce n'est pas par l'armée de Versailles, mais par quelques insurgés, pour faire croire qu'ils se battent quand ils n'osent même pas se montrer». Il dit encore aux provinces que l' « artillerie de Versailles ne bombardait pas Paris, elle ne faisait que le canonner ». Il dit à l'archevêque de Paris que les prétendues exécutions et représailles ( !) attribuées aux troupes de Versailles n'étaient que fariboles. Il dit à Paris qu'il était seulement désireux « de le délivrer des hideux tyrans qui l'opprimaient », et, qu'en fait, « le Paris de la Commune n'était qu'une poignée de scélérats».
Le Paris de M. Thiers n'était pas le Paris réel de la « vile multitude », mais un Paris imaginaire, le Paris des francs fileurs, le Paris des boulevardiers et des boulevardières, le Paris riche, capitaliste, doré, paresseux, qui encombrait maintenant de ses laquais, de ses escrocs, de sa bohème littéraire et de ses cocottes, Versailles, Saint-Denis, Rueil et Saint-Germain; qui ne considérait la guerre civile que comme un agréable intermède, lorgnant la bataille en cours à travers des longues-vues, comptant les coups de canon et jurant sur son propre honneur et sur celui de ses prostituées que le spectacle était bien mieux monté qu'il l'avait jamais été à la Porte-Saint-Martin. Les hommes qui tombaient étaient réellement morts; les cris des blessés étaient des cris pour de bon; et, voyez-vous, tout cela était si intensément historique !
Tel est le Paris de M. Thiers; de même l'émigration de Coblence était la France de M. de Calonne.
/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2F5NrDXZ78oCU%2Fhqdefault.jpg)
Henri Guillemin - La commune de Paris (Intégral)
Henri Guillemin - La commune de Paris (Intégral)Notre chaîne : https://www.youtube.com/channel/UCjW02v1A0VO_XdILloMMgpw?Merci à TF1, RTS et EditeurAnonyme po...
l'indispensable Henri Guillemin
Méphisto Rhapsodie / Samuel Gallet
/https%3A%2F%2Fapi-cdn.arte.tv%2Fimg%2Fv2%2Fimage%2FoPMBSVGpqnihkHSVirccgC%2F1920x1080%3Ftype%3DTEXT%26watermark%3Dtrue)
Mephisto - Regarder le film complet | ARTE
Dans les années 1930 en Allemagne, Hendrik Höfgen, un acteur ambitieux, se soucie uniquement de sa carrière et profite de la prise du pouvoir des nazis... Première collaboration de Klaus Maria ...
à voir jusqu'au 28/2/2023
![" Méphisto [Rhapsodie] ", de Samuel Gallet, Théâtre national de Bretagne à Rennes](https://image.over-blog.com/rqlu-XMkYLBKmuMT4DCmw_hWM-w=/170x170/smart/filters:no_upscale()/https%3A%2F%2Flestroiscoups.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2FMEPHISTO_%E2%88%8FGWENDAL-LEFLEM-28.jpg)
" Méphisto [Rhapsodie] ", de Samuel Gallet, Théâtre national de Bretagne à Rennes
Par Olivier Pansieri Les Trois Coups Jean-Pierre Baro met en scène " Mephisto " de Samuel Gallet, très vaguement inspiré du roman de Klaus Mann. Une litanie, qui se veut un cri, contre la monté...
une critique de Méphisto Rhapsodie de Samuel Gallet mis en scène par Jean-Pierre Baro
A quoi bon faire du théâtre quand l’extrême droite frappe aux portes du pouvoir ? Mephisto {rhapsodie} traverse les petitesses de la scène pour donner à penser l’avenir brûlant.
C’est la première création de Jean-Pierre Baro mise à l’affiche du Théâtre des Quartiers d’Ivry, CDN qu’il dirige depuis le mois de janvier. Mephisto {rhapsodie} raconte l’ascension d’un comédien arriviste, ses compromissions pour accéder au succès, jusqu’à sa nomination à la tête d’un théâtre, dans un contexte de montée de l’extrême droite. Fruit d’une commande passée à Samuel Gallet, auteur dramaturge avec lequel Jean-Pierre Baro travaille pour la seconde fois, Mephisto (rhapsodie) est inspiré d’un roman de Klaus Mann, fils de Thomas, qui, à partir d’une histoire vraie, développe cette trame du carriérisme à tout prix dans le contexte de l’Allemagne nazie. Parallèlement à l’intrigue, au cœur de ce spectacle d’envergure porté par huit comédiens aux multiples rôles, une question taraude les personnages : « Pourquoi faire du théâtre aujourd’hui ? ». On aimerait bien le savoir, en effet. Pour tenter de trouver des réponses, suivons donc l’action de Mephisto se déployer à Balbek, imaginaire petite ville de province, rampe de lancement de la carrière d’Aymeric Dupré, cet acteur obsédé par le nombre de rappels qu’opère le public à l’issue de la représentation. Autour de lui, une directrice vieillissante ne jure que par Tchekhov, un comédien cherche à articuler son travail avec le territoire qui l’entoure, et un apprenti du cru, lui, est tenté par l’idéologie des « Premières lignes », groupe fasciste à l’irrésistible ascension. Pendant ce temps, à la capitale, se déploie le territoire bourgeois, mondain et décadent du show business et des pouvoirs.
Pourquoi faire du théâtre aujourd’hui ?
Il y a des éléments agaçants dans cette pièce. Des personnages caractérisés à l’excès. Des dilemmes rebattus. Des morceaux de bravoure un peu bavards. Une association du peuple à l’extrême droite potentiellement simpliste. Et le risque du propos endogame, d’une pièce qui ambitionne d’ouvrir le théâtre au monde mais parle avant tout du monde du théâtre. Néanmoins, convenons-en, le texte de Gallet, très bien servi par la mise en scène simple, fluide et rythmée de Jean-Pierre Baro, et par un jeu aux multiples couleurs, emporte le morceau. Sans concession sur le narcissisme de l’artiste, le surplomb moralisateur du monde du théâtre et son asthénie tchekhovienne d’univers moribond, Mephisto n’épargne rien à une société du spectacle qu’il griffe de partout – son propos mordant jusqu’au public même. Mais il porte en même temps une véritable tendresse pour le théâtre, un attachement, un amour. Avec ses personnages complexes et profonds, pris dans leurs contradictions, cherchant la meilleure façon d’agir, avec ou sans le théâtre, face aux dangers qui menacent, Mephisto rend de plus plausible, présente, là, véritablement devant nous, cette dystopie malheureusement de plus en plus probable d’un monde où s’imposera l’extrême droite. Quels choix cette situation nous demandera-t-elle d’opérer ? Préparons-nous à cet avenir brûlant, propose Méphisto. De réponse définitive on ne trouvera pas dans le théâtre. Mais en s’aidant du théâtre, peut-être.
Eric Demey La Terrasse, 23 octobre 2019, N° 281
/https%3A%2F%2Fwww.toutsanary.fr%2Fhistoire%2Fexile.jpg)
Histoire de la Ville de Sanary-sur-Mer
Les intellectuels allemands exilés à Sanary, par Christian Soleil Origine: PlumArt N°25 (janvier 2001) www.plumart.com (reproduit avec autorisation) Plutôt que de frémir et de s'attrister de l...
https://www.toutsanary.fr/histoire3/les-intellectuels-allemands-exiles-a-sanary/
les exilés allemands, à Sanary sur-Mer, dont Klaus Mann, l'auteur de Méphisto
Méphisto de Klaus Mann vu dans la mise en scène d'Ariane Mnouchkine
Mephisto, Le roman d'une carrière 1979 De Klaus Mann
Traduction et adaptation Ariane Mnouchkine
Le roman Méphisto pose la question du rôle et de la responsabilité des intellectuels à la naissance du Troisième Reich. La fable qui, pour nous, s’est dégagée du roman pourrait se formuler ainsi : le spectacle serait l’histoire de deux comédiens, liés par l‘amitié, également passionnés de théâtre, également talentueux, également préoccupés de la fonction politique, voire révolutionnaire, de leur art, dans l’Allemagne de 1923. « Pour qui est-ce que j’écris ? Qui me lira ? Qui sera touché ? Où se trouve la communauté à laquelle je pourrais m’adresser ? Notre appel lancé vers l’incertain tombe-t-il toujours dans le vide ? Nous attendons quand même quelque chose comme un écho, même s’il reste vague et lointain. Là où on a appelé si fort, il doit y avoir au moins un petit écho. » Klaus Mann
Tous les clowns ne sont pas des monstres
Charlie Rivel est mon clown préféré. La 1ère fois que je l'ai vu, c'était en 1973, au concours de l'Eurovision où il avait fait une apparition pour faire passer le temps aux téléspectateurs...
https://www.attentionfragile.net/post/tous-les-clowns-ne-sont-pas-des-monstres
Edito septembre 2020 de Gilles Cailleau, compagnie Attention fragile : “De 1935 jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Charlie Rivel embrasse le nazisme, travaillant pour le ministère de la Propagande du Troisième Reich. Dans cette situation, il entretient des relations amicales avec Adolf Hitler et Joseph Goebbels. Après la guerre, Charlie demande de l’aide au général Franco, qui lui fournit un passeport et lui accorde l’entrée en Espagne. En 1954, il revient en Espagne où il devient une star du Circo Price de Madrid.” J’ai vérifié, croisé les sources, regardé un documentaire catalan très sérieux – El Pallasso i el Führer, lu des télégrammes envoyés par le clown au dictateur… Il faut se rendre à l’évidence, ce type mon héros, qui semblait à deux doigts de se briser dès qu’il déplaçait un pouce, avait été copain, copain au sens propre du terme de Hitler et de Goebbels, ils avaient rigolé ensemble, s’étaient sans doute tapés sur les cuisses et avant que ses deux acolytes se tirent une balle dans la tempe, voyant que ça sentait le roussi à Berlin, il avait demandé à Adolf (il devait trouver que c’était le plus cool des deux) de lui faire une fleur et de téléphoner à Franco pour faciliter son retour en Espagne, vu qu’il y était né.
Mes nouvelles convictions politiques
J'ai assisté samedi 4 octobre 2020 à 17 H à une lecture d'une durée d'1 H à la Bibliothèque Armand Gatti à La Seyne sur Mer dans le cadre de la résidence d'écriture de Samuel Gallet accueilli pour un mois par la Saison Gatti-Le Pôle, lecture d'entrée de résidence, à 8 voix, d'un découpage de son dernier texte Méphisto Rhapsodie, inspiré du Méphisto de Klaus Mann. Lecture puissante qui m'a interpellé.
J'ai pu mesurer à cette occasion combien j'avais évolué.
Le combat politique mondial (un certain combat politique, au minimum à gauche, plus souvent à l'extrême-gauche, pro-révolution tendance trotskyste, PCI, anti-stalinien, anti-social-démocrate, anti-capitaliste, anti-impérialiste / jugement de François Mauriac dans ses Mémoires intérieures : « Du point de vue de l'Europe libérale, il était heureux que l'apôtre séduisant de la révolution permanente ait été remplacé par l'horreur stalinienne : la Russie est devenue une nation puissante, mais la Révolution (en Europe) a été réduite à l'impuissance. Plus j'y songe et plus il apparaît qu'un Trotsky triomphant eût agi sur les masses socialistes de l’Europe libérale et attiré à lui tout ce que le stalinisme a rejeté dans une opposition irréductible : Staline fut à la lettre " repoussant ". Mais c'est là aussi qu'il fut le plus fort, et les traits qui nous rendent Trotsky presque fraternel sont les mêmes qui l'ont affaibli et perdu et de mettre Trotsky au niveau de Tolstoï et Gorki) qui me paraissait nécessaire il y a peu encore, jusqu'à l'épuisement du mouvement des Gilets Jaunes quand le mouvement syndical a repris la main avec le combat pour la défense des retraites (décembre 2019), entraînant confusion et collusion a cessé de me paraître nécessaire avec la crise de la Covid 19 et la sortie partielle du confinement (quelle aubaine pour un pouvoir déliquescent de pouvoir faire ramper des millions de gens à coups de mensonges et manipulations médiatiques !). Dès octobre 2019, je participais à un groupe Penser l'avenir après la fin des énergies fossiles (en lien avec la collapsosophie de Pablo Servigne) tout en continuant à participer à un groupe Colibris (faire sa part). J'avais renoncé à assister à des assemblées citoyennes de Gilets Jaunes tant à Toulon qu'à Sanary dès juillet 2019.
Le combat politique local que j'ai aussi mené comme conseiller municipal d'une majorité (1983-1995) puis comme tête de liste d'une opposition éco-citoyenne (2008) me paraît encore jouable. Encore faut-il gagner les élections municipales ? Dans l'opposition, on ne change pas les choses.
Où en suis-je aujourd'hui, à quelques jours de mes 80 ans, le jour de la révolution d'octobre (sans doute un coup d'état de Lénine, mensonge inaugural du régime soviétique), le même jour que Pablo ?
J'ai enfin décidé que personne ne peut se substituer à nous pour prendre conscience de sa place et de sa mission de vie (qui est autre chose que vivre comme feuilles au vent selon l'image d'Homère). Aucun porte-voix, aucune instance dite représentative ne peut (ne doit) parler et agir à ma place. Décision : je ne voterai plus. Abstention.
La démocratie représentative ne représente que les intérêts du pouvoir en place (république bananière, corrompue jusqu'à la moelle) et des rapaces qu'il représente pour l'avoir mis en place (cette prise de conscience est essentielle, la démocratie représentative n'est pas la démocratie, il m'a fallu 60 ans pour l'admettre). La démocratie représentative est le leurre savamment entretenu nous faisant croire qu'en changeant de gouvernement par les élections - qui sont la dépossession de nos voix, un vol de voix - (nous perdons notre pouvoir constituant, Octave Mirbeau, Etienne Chouard, et quelques autres sont indispensables à lire), que passer de droite à gauche, de gauche à l'extrême-centre puis un jour à l'extrême-droite, on va changer les choses. Mais il est possible de savoir maintenant, par expérience depuis 40 ans avec la pensée unique, le TINA thatchérien (There is no alternative) que droite, gauche, extrême-gauche, extrême-droite, extrême-centre n'ont qu'un objectif : arriver au pouvoir et le garder. Il est possible de se convaincre aussi que les gens au pouvoir savent depuis relativement peu (20 ans) qu'en cas de mouvements profonds, durables, pacifiques ou révolutionnaires, insurrectionnels, il ne faut surtout pas lâcher le pouvoir, le quitter comme de Gaulle ou Jospin. Il faut le garder coûte que coûte par la répression, la négociation. Il faut s'accrocher, laisser passer la colère. Il faut en conclure que tout affrontement frontal n'a aucune chance d'aboutir, de changer l'ordre des choses (le mouvement des GJ autour des ronds-points fut une forme géniale; les GJ manifestant sur les Champs-Elysées, inaccessibles jusqu'à eux aux mouvements revendicatifs ou insurrectionnels, ce fut un sacré challenge réussi mais un échec).
Il faut aussi constater que dans le cadre des nations, la politique ne peut défendre que les intérêts particuliers de la nation. Et ce particularisme ne change pas avec les entités supra-nationales comme l'UE, qui ne sont pas mondiales. L'ONU elle-même ne peut être le lieu d'une politique universelle.
Deux paradoxes sont à signaler. Le 1° paradoxe c'est que les GAFA (les géants du web, américains et chinois) ont une politique mondiale, une visée de domination mondiale, haïssant la démocratie (c'est le libertarianisme anglo-saxon d'une part et l'autoritarisme bureaucratique chinois d'autre part). Le 2° paradoxe, c'est que pour les révolutionnaires, la révolution est toujours imminente alors que la réalité montre depuis 40 ans que comme le dit un ultra-riche Warren Buffet : « il existe bel et bien une guerre des classes mais c'est ma classe, la classe des riches qui fait la guerre et c'est nous qui gagnons".
Seule peut-être une politique universelle en vue du Bien serait souhaitable, en vue du Bien c'est-à-dire satisfaisant la nourriture, la santé, l'instruction et le divertissement de tous. À ce niveau universel, souhaitable ? nécessaire ? la question démographique est peut-être la plus difficile à aborder : ne sommes-nous pas trop sur une terre aux ressources limitées. Déjà Lévi-Strauss le pensait et avant lui, Malthus.
Individu n'ayant qu'un peu de pouvoir sur moi, ne croyant qu'au travail sur soi pour devenir meilleur, j'ai fait choix de ne pas écouter les informations, de ne pas regarder la télé, de ne pas aller sur les réseaux sociaux. Finie la pollution anxiogène, finie la manipulation par les fake news, dont la plupart sont distillées par les médias et le pouvoir.
Quant à toi qui es au pouvoir, tu veux y rester, tu n'y es que pour un temps, tu passeras de toute façon, tu es déjà passé. Il en sera de même pour tes successeurs. Tchao, pantins et magiciens.
Vous êtes au pouvoir, vous prenez des mesures, vous légiférez à tour de bras mais votre pouvoir sur moi est réduit à quasiment rien, j'ignore par ignorance 99% de vos lois qui ne modifient quasiment rien à mes conditions de vie. Je respecte le minimum, je porte un masque, je respecte les règles du savoir-vivre, du code de la route.
Je m'invisibilise de vos systèmes de contrôle, je suis cosmopoli avec ce qui existe, minéraux, faune, flore, vivants. Je choisis qui je fréquente (quelques amis), je travaille sur moi (à gérer mes émotions souvent archaïques, mes pulsions souvent excessives). Je n'ai plus d'ennemis; même les adversaires politiques, je les ignore dorénavant. Cette affirmation n'est pas à prendre comme un constat mais comme un processus vivant (quand je me découvre un ennemi, y compris moi-même, je m'observe, je me mets à distance, je me nettoie de l'agressivité avec une technique de clown s'ébrouant, se débarrassant de sa poussière jusqu'à ce que l'indifférence me gagne). Je n'ai plus de boucs émissaires (processus vivant avec nettoyage, dépoussiérage) : les arabes et musulmans pour les racistes (dont je suis parfois), les blancs pour les ex-colonisés (dont je suis parfois), les machistes pour les féministes (dont je suis parfois), les putes pour les machistes (dont je suis souvent). Ces binarisations du monde sont toutes douteuses : elles nous font croire que nous sommes du bon côté, du côté de la justice, de la vérité. Par exemple, la théorie du Grand Remplacement justifie les mouvements néo-fascistes. Inversement, le refus de toute relation avec la Haine du FN et du RN justifie l'extrême-gauche et l'islamo-gauchisme.
Qui aura raison, Michel Houellebecq avec Soumission, Boualem Sansal avec 2084, Alain Damasio avec Les furtifs... ?
J'ai vu au tout début des GJ (novembre 2018), le rejet de ceux-ci par tout un tas de gens bien-pensants (tous bords politiques) qui n'ont même pas compris que ceux qu'ils appelaient des bruns, venaient de la périphérie, les petits blancs invisibilisés par la société marchande et touristique, la société des bobos. Ce que j'ai compris et accepté, c'est que tout ça existe, co-existe, s'affronte et que c'est en moi, potentiellement, réellement. J'ai vu des GJ aux idées racistes être changés en deux, trois discussions. Cela veut dire que prendre pour du dur, des opinions de circonstances, en lien avec un mal-être, un mal-vivre est préjudiciable à la recherche de la paix, civile et sociale. Rien de pire qu'une guerre civile, qu'une société qui se délite, les uns dressés contre les autres.
Cela dit, nos opinions de circonstances peuvent tenir longtemps. Nous les faisons nôtres comme si le monde allait s'effondrer si on cessait de les croire nôtres. 60 ans pour moi de fidélité imbécile aux valeurs "humanistes" de la gauche radicale. C'est cette fidélité toxique aux "convictions politiques" d'à peine plus de 50% des électeurs (qui faisait que rien ne changeait si ce n'est l'alternance des couleurs politiques) qui a expliqué la montée de plus en plus massive de l'abstention pendant une vingtaine d'années, phénomène repéré mais pas pris au sérieux (c'étaient les déçus de la politique, les pêcheurs à la ligne du dimanche, les traîtres au devoir électoral, au droit de vote arraché de haute lutte par nos anciens) et qui explique en 2017, le dégagisme qui a frappé à droite, à gauche, a vu sortir du chapeau une bulle de savon miroitante.
Avec ces nouvelles convictions (plus question d'être fidèle sur le plan des soi-disant convictions politiques, ce ne sont qu'opinions largement induites par le milieu, l'époque et on les prétend siennes, c'est "mon" opinion et on s'y accroche, 60 ans durant comme moi), je n'attends plus du théâtre qu'il donne de la voix, qu'il m'ouvre la voie, une voie. J'ai fait partie du milieu, bénévolement, pendant 22 ans, créateur du festival de théâtre du Revest puis directeur des 4 Saisons du Revest dans la Maison des Comoni (1983-2004). J'ai cru par passion à la nécessité de soutenir la création artistique, de l'écriture à la mise en scène, de soutenir et susciter des formes innovantes, de soutenir et susciter l'émergence de jeunes créateurs. Ce fut une période passionnante que je ne renie pas. Mais j'ai pris conscience progressivement vers 2017-2019 que le "vrai" travail est à faire sur soi et par soi. Pas d'agir sur les autres, d'influencer les autres. Pas d'être agi par les autres, influencé par les autres.
Au théâtre, au spectacle, on est dans la représentation, pas dans la présence, pas dans le présent (le moment et le cadeau), je suis spectateur, spectacteur pour certains, je ne suis pas acteur de mon destin, de mes choix de vie à mes risques et périls. Le théâtre, lieu de représentation est comme la politique représentative. Enjeux de pouvoir, luttes de pouvoir, narcissisme exacerbé, carriérisme, opportunisme, compromissions, monde de petits requins persuadé d'avoir une mission de "création" et d'éducation (en fait, de formatage des goûts selon les critères de l'administration qui subventionne), se comportant comme le monde des grands requins (le marché de l'art est particulièrement instructif à cet égard).
Quand je vois l'éclectisme des programmations actuelles, quand je vois la pléthore de propositions faites par les lieux, je pourrais être au théâtre, au concert tous les soirs, si les moyens suivent, le cul dans un fauteuil, à applaudir ou à bouder, comme si je passais ma soirée devant la télé. Je suis un consommateur culturel et je perds mon temps, je me distrais. On sait ce que reproche Pascal au divertissement.
Impossible d'aller à l'essentiel : je suis mortel, le monde s'effondre peut-être, l'humanité va peut-être se suicider. En quoi puis-je me mettre au service de plus grand que moi, de quelle mission de vie ? Pour un autre et même pour moi, à mon insu ou consciemment car nous sommes tous complices du système, ce sera : en quoi puis-je profiter un max de ce système ?
Pour moi aujourd'hui après 60 ans de fixation, de fixette idéologique : Contemplation des beautés de la nature. Action personnelle sur soi par la méditation en particulier. Actions d'harmonie, d'harmonisation, d'élévation. Ne pas ajouter la guerre à la guerre, ne pas faire le jeu du conflit, de la mort, même si je sais que l'inhumanité a encore de très beaux jours devant elle.
Dernier point : il est évident que l'on sait, si on le veut, reconnaître ce qui est inhumain en soi, en autrui. On sait que c'est possible, que c'est réel, on ne juge pas, c'est dégueulasse, injuste, à combattre. On fait choix tant que faire se peut de l'amour de la vie, de la Vie.
Bémol de taille : ce que j'ai écrit vaut pour les "démocraties" à l'occidentale (je peux l'écrire, le publier). Je ne sais comment je me comporterais tant en Chine qu'en Russie, en Arabie saoudite ou en Turquie.
Merci à cette lecture de m'avoir permis de faire le point sur moi, être changeant et sur mes "engagements" changeants.
Jean-Claude Grosse, 6 octobre 2020
/https%3A%2F%2Fi.vimeocdn.com%2Fvideo%2F909333254_1280.jpg)
Krystian Lupa Les acteurs et leur rêve
"KRYSTIAN LUPA, LES ACTEURS ET LEUR RÊVE" CONCEPTION Agnieszka Zgieb RÉALISATION Denis Guéguin MUSIQUE Bogumił Misala DESSINS Krystian Lupa Lors du confinement, en avril et en mai 2020, les ...
magnifique documentaire illustrant ce que peut être un théâtre de vérité ou du lent, déréglé travail d'apprivoisement par l'acteur du personnage et réciproquement; on est indéniablement dans une conception quantique du travail sur soi, avec soi, par le corps, par le langage de l'émotion
Antigone aujourd’hui ?
Antigone, dans la tradition venue de la mythologie et du théâtre grecs, est celle qui dit NON à une loi inique de la cité, Thèbes, gouvernée par le tyran Créon et lui oppose une loi universelle, au-dessus de la loi d’état, une loi dite de droit naturel pouvant être opposée au droit positif. À la loi écrite, édictée par le tyran lui interdisant de donner sépulture à son frère Polynice, elle oppose la loi non écrite mais s’imposant à elle et à tous que tout défunt doit avoir une sépulture digne et non être livré aux chiens.
Enterrés, incinérés comme des « chiens », ce fut le sort des décédés par la Covid 19 dans les EPHAD pendant le confinement du printemps 2020. Quelles Anti- gones ont bravé l’ignominie des directives gouvernementales ?
Dans les sociétés modernes, on a tendance à considérer que le concept de droit naturel doit servir de base aux règles du droit objectif. Kant (1785) et la révo- lution française (la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789) ont donc participé au progrès moral de l’humanité (en droit, mais pas dans les faits). Le droit naturel s’entend comme un comportement rationnel qu’adopte tout être humain à la recherche du bonheur (le droit au bonheur est inscrit dans la déclaration d’indépendance des Etats-Unis du 4 juillet 1776 : Nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes : tous les hommes sont créés égaux ; ils sont doués par le Créateur de certains droits inalié- nables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur). Le droit naturel présente un caractère universel dans la mesure où l’homme est capable de le découvrir par l’usage de sa raison, en cherchant à établir ce qui est juste. L’idée est qu’un ensemble de droits naturels existe pour chaque être humain dès sa naissance (comme le droit à la dignité ou le droit à la sécurité) et que ces droits ne peuvent être remis en cause par le droit positif. Le droit naturel est ainsi considéré comme inné et inaltérable, valable partout et tout le temps, même lorsqu’il n’existe aucun moyen concret de le faire respecter. Les droits naturels figurent aujourd’hui dans le préambule de la Constitution française et dans les fondements des règles européennes. Le droit à la vie et le droit au respect pour tous ne sont cependant pas reconnus partout sur le globe. Pensons aux fous de Dieu. Le droit naturel selon cette conception s’impose moralement et en droit à tous. Dans les faits, ces droits naturels sont souvent bafoués, par des individus, des sociétés, des états. Ce qui fait que le droit naturel n’est pas universellement appliqué dans les faits c’est l’existence du mal radical, du mal absolu, injustifiable (la souffrance des enfants pour Marcel Conche, la souffrance des animaux d’élevage et de consommation pour d’autres), du mal impossible à éradiquer parce que si l’homme est un être de raison, il est aussi un être de liberté et c’est librement que l’on peut choisir le mal plutôt que le bien.
Le problème du mal radical et de la liberté de l’homme a conduit Kant à écrire les Fondements de la métaphysique des mœurs (1785). Selon Kant, la loi morale n’est imposée par personne. Elle s’impose d’elle-même, par les seuls concepts de la raison pure. Tout être raisonnable, du simple fait de sa liberté, doit respecter les deux impératifs, le catégorique et le pratique
Impératif catégorique de Kant : «Agis uniquement d’après la maxime qui fait que tu peux aussi vouloir que cette maxime devienne une loi universelle. »
Impératif pratique de Kant : «Agis de telle sorte que tu traites l’humanité comme une fin, et jamais simplement comme un moyen. »
Un principe mauvais, que le sujet se donne librement à lui-même, corrompt à la racine le fondement de toutes nos maximes : le mal radical.
L’intérêt commun pour le beau dans l’art ne prouve aucun attachement au bien moral, tandis qu’un intérêt à contempler les belles formes de la nature témoigne d’une âme bonne
Ces considérations m’amènent à tenter de dire ce que serait Antigone aujourd’hui. Antigone pourra aussi bien être une femme qu’un homme, un jeune, adolescent, adolescente, enfant même. Devant les atteintes massives, permanentes aux droits universels de l’Homme (de la Femme, de l’Enfant, des Animaux, des Végétaux, de la Terre, de la Mer, de l’Air, de l’Eau...) partout dans le monde, individuellement comme collectivement, devant cette insistance de la barbarie, du mal partout dans le monde, j’en arrive à penser que dire NON à tout cela, à cette barbarie, à tel ou tel aspect de ce mal sciemment infligé (l’exci- sion, le viol comme arme de guerre par exemple) n’est plus la seule attitude que devrait avoir l’Antigone d’aujourd’hui. Les résistants à la barbarie, celles et ceux qui disent NON servent souvent d’exemple. Leurs méthodes comme leurs buts, leurs champs d’action sont variés, de la désobéissance civile à la lutte armée, de la non-violence à l’appel insurrectionnel, des semences libres à l’abolition de la peine de mort ou de l’esclavage, de la lutte contre l’ignorance à la lutte contre le viol. D’une action à grande échelle, internationale à une action locale.
Sappho, Marie Le Jars de Gournay, Olympe de Gouges, Louise Michel, Vandana Shiva, Angela Davis, Naomi Klein, Gisèle Halimi, Audrey Hepburn, Simone Veil, Simone Weil, Emma Goldmann, Ada Lovelace, Marie Curie, Margaret Hamilton, Germaine Tillon, Rosa Parks, Rosa Luxemburg, Joan Baez, Lucie Aubrac, Frida Khalo, George Sand, Anna Politkovskaïa, Anna Akhmatova, Sophie Scholl, Aline Sitoé Diatta, Brigitte Bardot, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Greta Thunberg, Carola Rackete, Weetamoo, Solitude, Tarenorerer, Gabrielle Russier // Gandhi, Luther King, Trotsky, Che Guevara, Lumumba, Sankara, Nelson Mandela, Soljenitsyne, Vaclav Havel, Jean Jaurès, Victor Hugo, Victor Jarra, Victor Schoelcher, Aimé Césaire, Pablo Neruda, Jacques Prévert, Primo Levi, Janusz Korczac, Federico Garcia Lorca, Emile Zola, Joseph Wresinski, le dominicain Philippe Maillard, Charles de Gaulle, François Tosquelles, Malcolm X, Célestin Freinet, Jacques Gunzig, Stéphane Hessel, Marcel Conche, Jean Cavaillès, Muhammad Yunus, Socrate, Siddhārtha Gautama, Jésus
Le mal radical étant l’expression de la liberté de l’homme, un choix donc (même si les partisans de l’inconscient freudien et jungien posent que la « mons- truosité » n’est pas choisie mais causée), une attitude possible d’Antigone aujourd’hui serait de dire OUI à tout ce qui existe, y compris le mal radical. Antigone en disant OUI à tout ce qui existe n’extérioriserait pas sa responsabi- lité (c’est la faute de l’autre, de Créon). Tout ce qui existe est en elle et donc elle est co-responsable de tout ce qui existe et co-créatrice de tout ce qui s’essaie. C’est à un travail sur soi qu’Antigone s’attelle pour mettre en lumière dans sa conscience, ses peurs, ses envies, ses jalousies, ses espoirs, ses rêves, ses désirs. Antigone tente de se nettoyer, d’élever sa conscience, de gérer ses émotions (c’est autre chose que de les contrôler, il s’agit de les laisser émerger mais sans y adhérer, en témoin). La méditation est un puissant outil pour ce travail sur soi. À partir de ce travail personnel, spirituel, Antigone agit comme le formulent les deux impératifs kantiens (« agis »). Elle agira sous l’horizon de l’universalité de son action, animée par l’amour inconditionnel de tout ce qui existe, sans jugement. Elle sera animée plus par son devoir concret à accomplir (sa mission de vie exercée avec passion, enthousiasme) que par la défense abstraite du droit naturel.
Elle saura prendre la défense du « monstre » (comme l’avocat Jacques Vergès).
Elle, Il saura proposer des actions « bigger than us ». Elle s’appelle Melati, Indo- nésienne de 18 ans, et agit depuis 6 ans pour interdire la vente et la distribution de sacs en plastique à Bali. Il s’appelle Mahamad Al Joundé du Liban, 18 ans, créateur d’une école pour 200 enfants réfugiés syriens. Elle s’appelle Winnie Tushabé d’Ouganda, 25 ans et se bat pour la sécurité alimentaire des commu- nautés les plus démunies. Il s’appelle Xiuhtezcatl Martinez des USA, 19 ans, rappeur et voix puissante de la levée des jeunes pour le climat. Elle s’appelle Mary Finn, anglaise, 22 ans ; bénévole, elle participe au secours d’urgence des réfugiés en Grèce, en Turquie, en France et sur le bateau de sauvetage Aqua- rius. Il s’appelle René Silva du Brésil, 25 ans, créateur d’un média permettant de partager des informations et des histoires sur sa favela écrite par et pour la communauté, « Voz das Comunidades ». Elle s’appelle Memory du Malawi, 22 ans, figure majeure de la lutte contre le mariage des enfants. Il s’appelle le docteur Denis M., il est gynécologue au Congo, surnommé l’homme qui répare les femmes, Nobel de la paix, menacé de mort. Elle s’appelle Malala Y., à 17 ans elle obtient le Nobel de la Paix pour sa lutte contre la répression des enfants ainsi que pour les droits de tous les enfants à l’éducation. Elle s’appelait Wangari M., surnommée la femme qui plantait des arbres, Nobel de la paix 2004.
Elle s’appelle Michelle du Revest, anime un groupe colibri et un groupe penser l’avenir après la fin des énergies fossiles. Il s’appelle Norbert du Mourillon et Gilet jaune, il anime un atelier constituant (RIC et Constitution). Elle s’appelle Marie de La Seyne, a écrit sur José Marti, soigne des oiseaux parasités par la trichomonose. Il s’appelle Guillaume et après 17 ans dans la rue, il œuvre pour un futur désirable quelque part. Elle s’appelle Chérifa de Marrakech et s’oc- cupe de 47 chats SDF dans sa résidence à Targa Ménara. Il s’appelle Alexandre, a créé son univers auto-suffisant, Le Parédé, et a rendu perceptible le Chant des Plantes au Grand Rex en 2015. Ils s’appellent Aïdée et Stéphane de Puisser- guier et créent un collectif gardien d’un lieu de vie, à Belbèze en Comminges, organisme vivant à part entière, bulle de résistance positive.
Jean-Claude Grosse, Corsavy, 9/9/2020
/image%2F0551669%2F20201029%2Fob_19b481_quiniou-critique-materialisme.jpg)
Le matérialisme en questions / dialogue critique - Blog de Jean-Claude Grosse
Le matérialisme en questions Dialogue critique Yvon Quiniou Nikos Foufas L'Harmattan, 2020 Voilà un livre important, si on est marxiste, marxien, si on l'a été, pas si on le devient (on semble ...
http://les4saisons.over-blog.com/2020/10/le-materialisme-en-questions/dialogue-critique.html
une note approfondissant mes nouvelles convictions politiques
/image%2F0552430%2F20200718%2Fob_d846ba_1706-049-vol-voix-couv.jpg)
Vols de voix (farce sur la présidentielle 2017) / É Say Salé - Les Cahiers de l'Égaré
couverture de Vols de voix, farce pestilentielle sur la présidentielle 2017 Farce pestilentielle à l'occasion de la présidentielle 2017 mettant en jeu insoumis, patriotes, girouettes merdre, c'e...
la propriété c'est le vol, toutes les répliques de cette farce sur la présidentielle ont été volées sur Facebook
De quoi parler au théâtre aujourd'hui ?
D’autres mondes (Science frictions)
NOUS SOMMES tout ce que nous n’avons pas fait. Notre vie est faite de tout ce que nous n’avons pas vécu. Tous les possibles, toutes les variantes, tous les chemins pas empruntés, toutes les virtualités, toutes les bifurcations. Non seulement un autre monde est possible, mais il est probable. Peut-être même qu’un autre monde, que d’autres mondes, que des infinités d’autres mondes sont bel et bien là, qui coexistent avec le nôtre, lui sont à la fois parallèles, et superposés, et même perpendiculaires, on ne sait pas bien. Houlà. Comment faire une pièce de théâtre avec tout ça ? Avec le principe d’indétermination d’Heisenberg, la physique quantique, les particules élémentaires, le chat de Schrödinger (remplacé ici par un lapin blanc tout droit jailli du pays des Merveilles), les doutes et les tremblements et la magie que la science jette sur notre connaissance du monde, mais aussi le présentisme, qui nous fait ignorer le passé et nous rend aveugles aux multiples possibles que recèle l’avenir ?
L’auteur et metteur en scène Frédéric Sonntag a pris toutes ces questions, et même plus, à bras-le-corps, et cela donne un spectacle qui déborde de partout, plein de vie et d’élans, de chausse-trappes et de prestidigitation, d’acteurs (ils sont jusqu’à neuf sur scène, plus un enfant) et de musique (les neuf acteurs jouent de la guitare, de la trompette, du piano, de la batterie, de l’accordéon, etc.), terriblement bavard (en français et en russe) mais jamais ennuyeux, avec même quelques écrans télé et cinéma en prime (heureusement, pas trop).On y suit les trajectoires entrecroisées de deux hommes, le physicien Jean-Yves Blan-chot (l’épatant Florent Guyot) et le romancier Alexei Zinoviev (l’excellent Victor Ponomarev), qui sont censés avoir travaillé tous deux, dans les années 60, dans leur coin et à leur façon, sur les univers parallèles. Ces deux personnages imaginaires, Sonntag leur construit des biographies plus que plausibles, et les incruste astucieusement dans notre réel. C’est ainsi qu’on pourra assister à une émission d’« Apostrophes » consacrée à la nouvelle science-fiction, avec le vrai Bernard Pivot de 1978, mais avec le faux Zinoviev. Lequel sidère les participants avec cette sortie : « L’un d’entre vous se souvient-il, même confusément, d’une Terre, aux alentours de 1978, qui soit pire que celle-ci ? Moi, oui. » Une scène qui ravira tous les amateurs de science-fiction, lesquels n’ont pas l’habitude de voir leur genre de prédilection ainsi honoré sur scène.Tout ça pour quoi ? Pour nous rouvrir l’imaginaire, combattre l'« atrophie de l’imagination utopique » qui est la nôtre, ridiculiser le très dominant « Tina » (There is no alternative). Ouf, de l’air !
Jean-Luc Porquet• Le Canard enchaîné. 30 septembre 2020.
Au Nouveau Théâtre de Montreuil
1- un retour de Samuel G
Merci Jean-Claude pour cet article
2 - un retour de Philippe C
Beau texte camarade Jean Claude, très stimulant ! bon ça t’arrive à 80 ans c’est pas un hasard …
Plaisanterie mise à part, ce retrait du monde que tu prônes et que tu t’appliques, de plus en plus de gens se l’appliquent aussi je pense, ou commencent à y penser…. C’est dans l’air du temps je crois. Mais je reconnais que ta lucidité fait du bien : que tu te résolves après 60 ans d’activisme à lâcher prise dans une forme de bonheur et de détermination est tout à fait salutaire !
J’ai commencé à lire Tocqueville « de la démocratie en Amérique », il dit une chose au début du bouquin que la démocratie est un mouvement qui a commencé et qui ne peut plus s’arrêter, qui va tout emporter sur son passage. Il parle du temps long et entend la démocratie par l’affirmation de chacun, si j’ai bien compris.
Et donc si l’affirmation de chacun est, aujourd’hui, à notre niveau d’évolution démocratique de se retirer de cette grande mascarade, parce qu’il considère qu’on est arrivé à un stade qui ne correspond plus à l’idée qu’on se fait de la démocratie, il se pourrait bien que le système actuel s’effondre tout seul sans combat, ni révolution.
De la casse, ça il va y en avoir, c’est sûr ! mais n’est-on pas arrivé au bout ?
Bien sûr il y a la Chine et tous les nouveaux impérialistes et les grandes multinationales ; mon optimisme tendrait à me faire penser qu’ils sont des colosses aux pieds d’argile, vivant uniquement de nos superficialités (consommation, bavardage sur les réseaux, etc…). Et donc si les gens se retirent c’est la fin, et leur stratégie sera bonne pour la poubelle.
3 -
un échange avec le maire du Revest informé de la démarche d'harmonie effectuée à Corsavy.
- c'est une démarche intéressante. Dommage que ça ne mobilise pas davantage
- dans l'état actuel des consciences, ça ne peut pas mobiliser beaucoup, ça mobilise au mieux les créatifs culturels, les cellules imaginatives
- ça a au moins eu le mérite de décrisper la situation provoquée par l'emplacement de la 4G ; avec la 5G, on va être confronté à un sacré problème ; comme les antennes font moins de 15 m, les fournisseurs n'auront pas besoin de demander une autorisation ; la seule façon que nous aurons de réagir sera d'empêcher le raccordement sur le réseau électrique; action en justice du fournisseur...
- quand tu penses que ça sera pour voir des films, des séries, du porno sur son smartphone
- oui et pour jouer; plus de vie sociale, le confinement permanent dans sa bulle virtuelle
questionner le travail / Gilles TK
le travail, questionnement pertinent dans ces 3 articles de l'APC (assemblée populaire et citoyenne) grand Toulon
/https%3A%2F%2Fwww.apc-creonsnosutopies.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F08%2Fdebord-816x500.jpg)
Le travail, à l'intersection de toutes nos colères
Questionner le travail #1 Le travail, en tant que tel, reste dans l'angle mort des luttes sociales et sociétales. Il s'impose à tout le monde, affecte nos vies au plus haut point, mais n'intéres...
https://www.apc-creonsnosutopies.org/2020/08/29/le-travail-a-lintersection-de-toutes-nos-coleres/
quand un site de lutte GJ est aussi un site d'analyses puissantes et analyse le travail
/https%3A%2F%2Fwww.apc-creonsnosutopies.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F09%2Fblack-juvenile-chain-gang-816x519.jpg)
Comment l'idée du travail est venue à ceux qui l'imposent aux autres
Questionner le travail #2 L'être humain peut-il se passer de travail ? Le travail est-il dans sa nature ? A-t-il toujours existé ? Pourquoi travaille-t-on ? Pour qui travaille-t-on ? La morale du...
2° partie de l'analyse du travail
/https%3A%2F%2Fwww.apc-creonsnosutopies.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F09%2Fgreve-816x722.jpg)
Centralité et disparition du travail
Questionner le travail #3 On te parle sans arrêt du travail, on le sacralise, on te dit que tu ne peux pas faire sans, et pourtant tu n'en trouves pas. Il n'y a plus de travail ? Tu devras malgré...
https://www.apc-creonsnosutopies.org/2020/09/21/centralite-et-disparition-du-travail/
3° et dernière partie de l'analyse du travail
3 contributions de Gilles TK sur le site de l'APC grand Toulon (assemblée populaire et citoyenne)
Questionner le travail #1
Le travail, en tant que tel, reste dans l’angle mort des luttes sociales et sociétales. Il s’impose à tout le monde, affecte nos vies au plus haut point, mais n’intéresse les débats qu’en termes de modalités sectorielles.
Pourtant, l’extension de nos analyses à la critique fondamentale du travail permettrait peut-être de connecter les luttes en bousculant la fatalité de l’isolement militant (méchante « dépolitisation », méchant « individualisme »), vers l’invention collective de nouveaux modes de production et pour un vrai changement de société.
Questionner le travail #2
L’être humain peut-il se passer de travail ? Le travail est-il dans sa nature ? A-t-il toujours existé ? Pourquoi travaille-t-on ? Pour qui travaille-t-on ?
Questionner le travail #3
On te parle sans arrêt du travail, on le sacralise, on te dit que tu ne peux pas faire sans, et pourtant tu n’en trouves pas. Il n’y a plus de travail ? Tu devras malgré tout travailler davantage. Tes enfants ne sont pas encore nés ? Qu’ils aillent bosser quand même !
/https%3A%2F%2Fapi-cdn.arte.tv%2Fapi%2Fmami%2Fv1%2Fprogram%2Ffr%2F083305-001-A%2F940x530)
Travail, salaire, profit - Travail - Regarder le documentaire complet | ARTE
Gérard Mordillat et Bertrand Rothé interrogent des chercheurs internationaux sur les concepts fondamentaux de l'économie. Une plongée passionnante, à l'heure où le néolibéralisme traverse u...
https://www.arte.tv/fr/videos/083305-001-A/travail-salaire-profit-travail/
1 des 6 documentaires sur travail, salaire, profit

/image%2F0555840%2F20240412%2Fob_3d8592_despentes-v.png)
/image%2F0555840%2F20240119%2Fob_1d9056_image-0555840-20231226-ob-7d1903-captu.png)
/image%2F0555840%2F20240128%2Fob_523ad1_mary-magdalen-donatello.jpg)
/image%2F0555840%2F20231203%2Fob_f3ec3d_img-20231203-145238.jpg)
/image%2F0555840%2F20231117%2Fob_f1f9c7_img-1703-2.jpg)
/image%2F0555840%2F20231116%2Fob_e7e572_le-o-ferre.png)
/image%2F0555840%2F20231115%2Fob_6c57cd_couverture-boix.jpg)
/image%2F0555840%2F20231007%2Fob_befe09_29-9-terrasse.jpg)
/image%2F0555840%2F20230905%2Fob_45068f_affiche-poesie.jpg)
/image%2F0555840%2F20230807%2Fob_7c0da1_img-20230720-094806.jpg)
/image%2F0555840%2F20230626%2Fob_75b15b_capture-d-ecran-2023-06-26-a-09-01.png)
/image%2F0555840%2F20230626%2Fob_a1ffc3_capture-d-ecran-2023-06-26-a-09-02.png)
/image%2F0555840%2F20230626%2Fob_6f97cc_capture-d-ecran-2023-06-26-a-09-03.png)
/image%2F0555840%2F20230626%2Fob_8d07f2_343059140-735464354933407-208358544549.jpg)
/image%2F0555840%2F20230626%2Fob_1a81ed_capture-d-ecran-2023-06-26-a-09-23.png)
/image%2F0555840%2F20230626%2Fob_78d8f3_capture-d-ecran-2023-06-26-a-11-36.png)
/image%2F0555840%2F20230626%2Fob_976c6a_capture-d-ecran-2023-06-26-a-11-24.png)
/image%2F0555840%2F20230626%2Fob_9b136a_d6d5cb9c-3744-468a-b41b-846370b7c92e.jpg)
/image%2F0555840%2F20230626%2Fob_d3d267_img-2602-scaled.jpg)

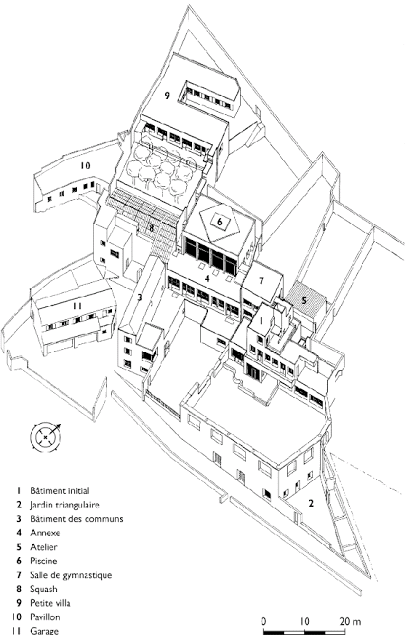







/image%2F0555840%2F20230624%2Fob_0c1436_montsegur.jpg)
/image%2F0555840%2F20230624%2Fob_57cf2e_montsegur-photo-ab-8-janvier.jpg)
/image%2F0555840%2F20230624%2Fob_9ce39a_csm-umwelteinfluesse-gr-fr-066c982c8d.jpg)
/image%2F0555840%2F20230624%2Fob_215a09_347266038-6355256264509544-43832391194.jpg)
/image%2F0555840%2F20230624%2Fob_4290d1_347260634-274599121605585-532749697497.jpg)
/image%2F0555840%2F20230624%2Fob_e5ea90_347247416-6355248871176950-31356488979.jpg)
/image%2F0555840%2F20230624%2Fob_4d0583_347595033-568960355379080-766849874218.jpg)
/image%2F0555840%2F20230624%2Fob_fcda5a_349000908-2254889094711568-85904952118.jpg)
/image%2F0555840%2F20230624%2Fob_c16475_capture-d-ecran-2023-06-24-a-07-27.png)
/image%2F0555840%2F20230624%2Fob_78c017_matador012-830x475.jpg)
/image%2F0555840%2F20230613%2Fob_63516a_353635767-2047405318934579-35138131892.jpg)
/image%2F0555840%2F20230613%2Fob_48af77_eugenie-bachelot-prevert-jacques-preve.png)
/image%2F0555840%2F20230613%2Fob_c4c986_le-radeau-scaled.jpg)
/image%2F0555840%2F20230613%2Fob_b90a1e_74-thickbox-default.jpg)
/image%2F0555840%2F20230613%2Fob_629eb2_diego-l-ane-reve.jpg)
/https%3A%2F%2Fi0.wp.com%2Fdiacritik.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F08%2F2_couv_all_fr.jpg%3Ffit%3D1200%2C896%26ssl%3D1)
/https%3A%2F%2Fimages.midilibre.fr%2Fapi%2Fv1%2Fimages%2Fview%2F6485c8c9cdac0150d61d83b0%2Flarge%2Fimage.jpg%3Fv%3D1)
/http%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FKjVy_c8HW04%2Fhqdefault.jpg)
/image%2F0555840%2F20230613%2Fob_9f179d_diego-l-ane-reve.jpg)
/image%2F0555840%2F20230613%2Fob_e4e5a4_diego-l-ane-reve.jpg)
/image%2F0555840%2F20230613%2Fob_9f2e1e_352017959-276822521410584-315202359996.jpg)
/image%2F0555840%2F20230613%2Fob_59c45c_352414930-1696925017395397-20799422116.jpg)
/image%2F0555840%2F20230613%2Fob_d29dd0_352632743-986151906156997-818215428196.jpg)
/image%2F0555840%2F20230613%2Fob_9bb7e4_352346462-266440569206982-296921605621.jpg)
/image%2F0555840%2F20230613%2Fob_8c0210_351145663-954755178979940-223593048978.jpg)
/image%2F0555840%2F20230613%2Fob_e0d82a_352220966-124785020603199-889535778852.jpg)
/image%2F0555840%2F20230613%2Fob_0e2e7d_352748306-1211299619565253-22550917061.jpg)
/image%2F0555840%2F20230613%2Fob_0e7a19_352233098-556515210028999-642177349363.jpg)
/image%2F0555840%2F20230613%2Fob_c4faac_351505776-282337647577014-118960146792.jpg)
/image%2F0555840%2F20230619%2Fob_55a15b_diego-l-ane-reve.jpg)
/image%2F0555840%2F20230619%2Fob_690e57_diego-l-ane-reve.jpg)
/image%2F0555840%2F20230317%2Fob_38ffb0_capture-d-e-cran-2023-03-17-a-19.png)
/https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fd%2Fd1%2FSophie_Robert.jpg)
/image%2F0555840%2F20230317%2Fob_46d808_elle-s-appelait-agnes-couv.jpg)
/image%2F0555840%2F20230317%2Fob_30ba05_1502-013-battement-couv.jpg)
/image%2F0555840%2F20230317%2Fob_37a1e3_eternite-couv.jpeg)
/image%2F0555840%2F20230317%2Fob_63b125_couverture-et-ton-livre-d-e-ternite.PNG)
/image%2F0555840%2F20230206%2Fob_4f43d7_rencontre-avec-joe-black.jpeg)
/image%2F0555840%2F20230207%2Fob_55f253_joe-black6.jpeg)
/image%2F0555840%2F20230207%2Fob_ea2482_joe-black1.jpg)
/image%2F0555840%2F20230207%2Fob_1f6342_joe-black5.jpg)
/image%2F0555840%2F20230207%2Fob_afdf8d_joe-black2.jpg)
/image%2F0555840%2F20230207%2Fob_76107d_joe-black3.jpg)
/image%2F0555840%2F20230207%2Fob_ce096e_joe-black1-1.jpg)
/image%2F0555840%2F20230207%2Fob_3ec925_joe-black4.jpg)
/http%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FoFfvYfilGQk%2Fhqdefault.jpg)
/http%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FQ-1-C2LeyeY%2Fhqdefault.jpg)
/http%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2Fl56i2xZDrZM%2Fhqdefault.jpg)
/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2Fk98JC_WjvG4%2Fhqdefault.jpg)
/http%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FgzShZj391lM%2Fhqdefault.jpg)
/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FWtn8D5QMPF8%2Fhqdefault.jpg)
/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FZ9sSdYNg0GA%2Fhqdefault.jpg)
/image%2F0555840%2F20230109%2Fob_c20ac7_322551014-462830359362992-150888202961.jpg)
/image%2F0555840%2F20230109%2Fob_8f1075_324474626-571857537731220-426850038526.jpg)
/image%2F0555840%2F20230109%2Fob_c439fb_324574299-744913006789056-359107117290.jpg)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_b42b4c_buste-sappho.png)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_e3eaf9_sappho.png)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_dc796d_budai-temple-chine.jpg)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_12f7b6_statue-bouddha-rieur.jpg)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_b1d15e_jesus-rieur-blanc.png)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_f2613c_jesus-cuivre.jpg)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_bde413_francois-assise.jpg)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_665360_gravure-rabelais.png)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_0e730e_proust.png)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_1310f6_celeste-albaret.png)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_016166_le-monde-de-marcel-prouust.png)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_d66797_le-temps-retrouve-raoul-ruiz.png)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_934404_yves-tanguy.jpg)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_5373d1_delteil.jpg)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_410de7_brassens.jpg)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_0df847_agnes-varda.jpg)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_db0372_bobin-aux-eclats.jpg)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_e06571_jean-yves-leloup.jpg)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_1bd6b1_zalic.png)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_b2463f_padovani.png)
/https%3A%2F%2Fwww.radiofrance.fr%2Fs3%2Fcruiser-production%2F2022%2F12%2Fcb972058-ee04-48c1-b1ef-a068daa6fc5a%2F1200x680_2222222222christian-bobin-043-aur-aurimages-0032933-132.jpg)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_b2344d_lucy.jpg)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_b8dbf9_marie-morel.png)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_5366bf_joie-a-mirepoix.jpg)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_225490_rachel.jpg)
/https%3A%2F%2Fgalerie.mariemorel.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F01%2Fmarie-morel-dans-atelier.jpg)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_9e8c75_eric-borgniet.jpg)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_75436f_annie-bergou.jpg)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_9245d2_sur-la-plage.png)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_1c02ab_annie-jc-corps-ca-vit.jpg)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_58a589_le-baiser.jpg)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_f79f0d_katia.jpg)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_c8f95a_cyril.png)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_e5d841_katia.png)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_ff5e6d_cyril-romeo.JPG)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_bf066b_rosalie-et-la-me-sange.jpg)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_578ea0_annie-le-quesnoy.jpg)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_c9cc5a_jc-doigt-leve-copie.jpg)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_7b3c5e_rosalie.jpg)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_4487a5_rosalie-helene-theret.jpg)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_e93331_avec-pessoa.jpg)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_79c535_jc-dieu-est-amour.jpg)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_1c5f16_par-la-fenetre-du-peintre.jpg)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_e6decf_voeux-2023.jpg)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_fadc39_bonheur.png)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_3cb2f0_couv-bonheur-2.png)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_a40e26_le-livre-des-cendres-couv.jpg)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_22d12a_couverture-et-ton-livre-d-eternite2.PNG)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_6bccc3_322227263-564781505503878-914798003550.jpg)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_9f788f_324075329-821492438948697-879528600391.jpg)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_0ae075_324088071-696566942117329-773369284923.jpg)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_439323_323866164-560301382348864-149907155656.jpg)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_28b5e3_324087772-501740262028991-178812222945.jpg)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_5345cd_324241515-3287787604769686-62685999832.jpg)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_389818_322476862-480479874039174-530740247234.jpg)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_4c374a_324072619-1647276785691617-55129005185.jpg)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_ece7af_324017862-3435130220104877-26662274476.jpg)
/image%2F0555840%2F20230108%2Fob_cc49e7_324016063-530534142361521-293386968255.jpg)
/image%2F0555840%2F20210417%2Fob_26f9dd_22occupation-22-du-liberte.jpg)
/image%2F0555840%2F20210324%2Fob_cdebb3_dictionnaire-recto.jpg)
/image%2F0555840%2F20201006%2Fob_abddff_21482-2020-09-19-nouveautheatremontreu.jpg)
/image%2F0555840%2F20201006%2Fob_310663_21482-2020-09-19-nouveautheatremontreu.jpg)
/image%2F0555840%2F20201006%2Fob_f002b6_21482-2020-09-19-nouveautheatremontreu.jpg)
/image%2F0555840%2F20201006%2Fob_117971_21482-2020-09-19-nouveautheatremontreu.jpg)
/image%2F0555840%2F20200922%2Fob_2c369b_greve-816x722.jpg)
/image%2F0555840%2F20200922%2Fob_ff63ff_black-juvenile-chain-gang-816x519.jpg)
/image%2F0555840%2F20200922%2Fob_17630f_debord-816x500.jpg)
